Trois scènes de la catastrophe
"Viol" de Botho Strauss
"Ce qui évolue, ce qui demeure" et "Graves Épouses / animaux frivoles" de Howard Barker
Pour Delphine, le théâtre
La catastrophe nomme un tournant (strophê), le grand renversement la tête en bas (cata). Les catastrophes s'accumulent aujourd'hui tellement, elles saturent tant notre actualité qu'elles font époque – qu'elles sont l'époque. Être à la hauteur de la catastrophe qui nous renverse la tête consiste d'abord dans la saisie qu'il y a plus d'une catastrophe, ensuite dans la relève de son sens sans dissiper ses effets sensibles au nom du signifiant, enfin dans le tracé d'un chemin éclairant malgré l'obscurcissement la possibilité d'une orientation nouvelle.
Le théâtre contemporain offre ainsi des scènes pour accueillir et penser la catastrophe d'une modernité qui s'engorge d'elle-même jusqu'à se rendre insupportable, intolérable : catastrophe d'une violence antique dont la perpétuation intègre les effets de désensibilisation paradoxaux de la compréhension analytique et du spectacle médiatique (Viol de Botho Strauss) ; catastrophe du progrès technique qui programme l'obsolescence éthique (Ce qui évolue, ce qui demeure de Howard Barker) ; catastrophe du déjà-là post-apocalyptique et des relations nouvelles qu'il fait naître malgré tout (Graves épouses / animaux frivoles de Howard Barker).
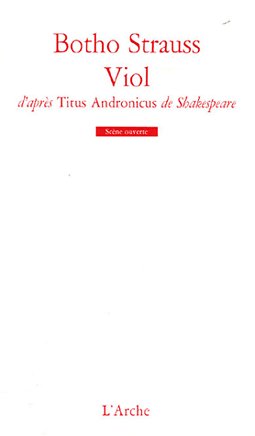
"Viol" de Botho Strauss
Épouvantable indifférence
Né en 1944 à Naumburg en Allemagne nazie puis occupée avant que cette partie orientale du pays ne devienne en 1949 la RDA, l'ancien critique de la revue Theater Heute devient en 1970 collaborateur à la Schaubühne de Berlin dirigée alors par son ami Peter Stein. Après quelques adaptations (La Cagnotte d'Eugène Labiche, Les Estivants de Maxime Gorki), Botho Strauss s'attelle rapidement à l'écriture de ses propres pièces, Hypocondres (1971), Visages connus, sentiments mêlés (1974), la Trilogie du revoir (1976) et Grand et petit (1977), des succès en Allemagne comme à l'étranger. Devenu aujourd'hui l'auteur allemand le plus joué au monde avec Heiner Müller, mis en scène en France par Claude Régy et Alain Françon, Patrice Chéreau et Luc Bondy, adapté par Michel Vinaver, Botho Strauss est le dramaturge d'une modernité qui se retourne contre elle-même comme un serpent et, comme le motif ouroborique, s'épuise à tourner autour du noyau d'absence de son destin – moins un astre radieux qu'un désastre obscur.
La réflexivité, arme critique privilégiée par la modernité, est un pharmakon tout en duplicité à l'époque où la modernité se divise en postmodernité cynique et en hypermodernité critique. En ce sens que la réflexivité rend à la fois plus heureux quand on gagne en lucidité sur ce qui nous arrive, et plus malheureux quand la lucidité, en dissociant la compréhension de la catastrophe de la possibilité d'en interrompre le cours, produit une nouvelle fatalité paradoxalement appareillée aux exigences de la rationalité. La violence, à force d'être analysée et représentée, commentée et disséquée, réfléchie et publicisée, aurait ainsi perdu sa force de scandale et de soulèvement. Et nous serions plus impuissants encore à subir la violence qui nous accable d'autant plus qu'elle est devenue transparente à elle-même. Et si incessante que l'explication nous la rendrait indifférente. La lucidité pave nos pessimismes qui, en cessant d'être critiques, matelassent nos fatalismes.
Ne plus seulement subir l'impuissance mais en être capable, pouvoir sa propre impuissance comme le pense Giorgio Agamben est l'horizon éthique d'un théâtre plus fort que les stéréotypes auxquels on le réduit par réflexes critiques (solitude et absurde, enfermement et incommunicabilité).
En 1983, Botho Strauss crée Le Parc, une recréation du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare imaginé dans un parc berlinois, avec le comédien Bruno Ganz dans le rôle d'Obéron. Le roi des elfes décidant avec ses grandes ailes noires d'aller à la rencontre des êtres humains pour satisfaire leurs désirs apparaît aujourd'hui comme le négatif de l'ange des Ailes du désir (1987) de Wim Wenders. Deux décennies plus tard, le dramaturge allemand en repasse à nouveau par Shakespeare avec Viol, une pièce exceptionnellement représentée en France avant d'être jouée en Allemagne, créée le 6 octobre 2005 par Luc Bondy au Théâtre de l'Odéon.
Profanation. La pièce originale de William Shakespeare s'intitule Titus Andronicus, une œuvre de jeunesse datant de 1589 et peut-être même s'agit-il de sa toute première pièce. Cinq siècles plus tard, sa variation moderne ou sa recréation moderniste par Botho Strauss a Viol pour titre français. En allemand, le titre original fait entendre, avec la honte (Schande), la violation et la profanation (Schändung). On verra alors que si le viol a pour champ d'exercice le corps de l'autre dont l'outrage a pour origine une passion vengeresse et rageuse, le viol se fait violation quand la profanation atteint le seuil critique de l'indifférenciation des violences et de la déresponsabilisation des actions, autant par rivalité mimétique que par représentation anesthésique.
Si le théâtre moderne désire être également une critique radicale de la représentation perçue à l'heure du spectacle intégral comme séparation, désensibilisation et désintégration, il doit alors mettre en crise la représentation elle-même, de la blesser en la fendant pour pouvoir ainsi interroger ce qui rend la violence plus épouvantable encore d'être banalisée, amortie et neutralisée.
Terra Secura. Terre Sereine, îlot résidentiel préservé et réservé pour élites ségréguées aux portes de Rome : ce n'est pas que la publicité moderne pour un projet immobilier étouffe les bruits antiques de la politique et de la la guerre, c'est qu'elle les précède en claironnant que le capitalisme est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Titus le fait savoir, d'emblée : « La victoire porte le deuil » (éd. L'Arche, 2005, p. 12). Les Romains passés et présents ont gagné et leur victoire est notre deuil en effet. « Suum cuique » : « à chacun ce qui lui appartient » est une morale connue d'eux et si elle s'écrit en latin, elle aura cependant réussi à traverser les âges, intacte de valoir comme le viatique continué de la loi du plus fort, loi de la prédation qui est celle de la déprédation. L'antiquité c'est aujourd'hui, l'antiquité c'est déjà demain. Les prédateurs qui sont toujours des déprédateurs ont de l'avenir mais l'avenir est celui que leur ménage un furieux désir d'apocalypse à l'ère de l'anthropocène et toutes ses scènes de la catastrophe qui le sont de l'entropie généralisée.
Le général victorieux Titus a beau jurer encore et encore qu'il est le meilleur défenseur des us et coutumes de l'empire, qu'il est le grand protecteur des formes et des traditions, des manières et des civilités de Rome. Il n'empêche, l'antiquité de Rome la civilisée est plus barbare que les peuples autres dont elle a barbarisé l'altérité pour mieux cultiver l'impérialisme de son identité. Justement, qu'est-ce que la barbarie ? On se méfie du terme depuis Claude Lévi-Strauss puisque, à juste titre, l'anthropologue a rappelé au moment de Race et histoire (1951) que « le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit en la barbarie ». La barbarie est peut-être la croyance la plus répandue parmi les civilisés, avec la croyance parfaitement complémentaire que ces derniers le sont davantage que les barbares qu'ils ont culturellement pour vocation de mépriser. Une croyance parfaitement complémentaire comme on dit d'un crime dont l'auteur a effacé ses traces qu'il est parfait.
Dans l'antiquité romaine dont notre contemporanéité serait comme la parodie désenchantée, avec la Pax Romana relocalisée en Terra Secura, les fils ne cessent pas d'être sacrifiés par les pères qui sacrifient ceux des ennemis qu'ils ont défaits dans le rituel mécanique d'une compensation symbolique qui, diaboliquement, confond annulation et accumulation. Sans avoir besoin d'être poussé beaucoup, Titus l'admet volontiers, éclair de lucidité qui ne lui sera évidemment d'aucune utilité : « Nous n'agissons plus comme nous devrions. Nous agissons sans nécessité comme nous n'aurions agi par nécessité que dans le pire des cas. Et ainsi, inopinément, le pire arrive » (p. 23).
Représentation. Le deuxième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent) d'une pièce plutôt courte qui en comporte cependant dix-sept a pour titre « Making-of » (p. 27). Le terme emprunté au vocabulaire de cinéma, en faisant lien avec le fondu enchaîné coiffant l'acte suivant, ouvre l'art du théâtre sur celui du cinéma et de la télévision qu'elle relaie et parodie en interviewant les comédiens de la pièce. L'ouverture est une parenthèse critique expérimentant avec l'emboîtement des formes de représentation les limites d'une réflexivité qui se retourne contre elle-même à l'image d'une maladie auto-immune. La prose du quotidien remplace aussi les beaux restes de la langue classique, avant que les deux registres de langue ne s'imbriquent en s'altérant réciproquement dans les actes suivants. La mise en abyme n'est pas qu'un rituel moderniste avec lequel fait joujou le carnaval postmoderne, c'est ici le test décisif avérant qu'à l'ère du spectacle médiatique et du fait divers qui fait diversion, le théâtre shakespearien se retrouve étouffé, assourdi, évidé. Sa jeunesse barbare naguère incarnée par Titus Andronicus comme normalisée et la normalisation est un anéantissement symbolique.
Aaron, amant maure de Tamora la reine des Goths, prévient de ceci : « Les divertissements sanguinolents, ça lasse. La violence est un amuse-gueule pour spectateurs blasés » (p. 28). Le réel de la violence s'est donc éloigné dans l'indifférenciation marchande des représentations équivalentes et c'est à cet art de la représentation privilégié qu'est le théâtre depuis l'antiquité de restaurer un accès à ce réel-là qui est celui de l'antiquité dont nous ne sommes pas encore sortis. C'est là que s'origine sa profonde mélancolie saturnienne. Saturnin (forcément), fils de l'empereur de Rome défunt, de son côté renchérit : « Supporter l'insupportable nous rend tous ridicules. Bouffer des images de guerre tous les soirs, s'empiffrer d'horreurs fait de nous des pantins devant l'histoire mondiale » (p. 29).
Scandale. Le troisième acte de Viol (ou scène ou tableau, c'est indifférent) porte le titre de la pièce, dédié à un premier scandale : le maure Aaron saute Tamora. Autrement dit, un « nègre » se tape la reine barbare, le plus beau trophée de Titus rapporté de la guerre contre les Goths. Bassian, frère de Saturnin, crie au scandale avant d'être tué par les fils de Tamora, Chiron et Demetrius, qui vengent dans la foulée Alarbus, leur frère assassiné. Le scandale ouvre à la vérité cachée dans l'antique fondation des violences réciproques, des rivalités cumulatrices et des passions mimétiques : les hommes s'entre-déchirent le corps au nom d'une appropriation du corps des femmes et si la race est l'un des grands séparateurs modernes avec la classe, il n'en est pas moins un opérateur qui s'accouple avec le sexe pour organiser la modernisation de la distribution des rapports de violence.
Indifférence. Le quatrième acte de la pièce de Botho Strauss (ou scène ou tableau, c'est indifférent) s'intitule quant à lui « Description d'images ». Les à-plats de la mise en abyme ont les bords qui frisent. Le méta voisine alors avec le gore et le porno. Le rire postmoderne est carnassien jusqu'à l'obscénité. C'est pourquoi il y a urgence à créer au théâtre, surtout quand aujourd'hui les salles sont vides pour des raisons sanitaires incompréhensibles, les scènes qui rendent compte de l'obscénité tout en construisant le désœuvrement de ses effets de contagion et d'addiction. Les descriptions sont alors lacunaires, un côté dans la métaphore (« Ils me détruisent la tulipe », p. 40), un autre dans le littéral (« Ils mutilent mon vagin », idem). En faisant pièce à la monstration afin de pousser hors-champ l'horreur des actes représentés, les descriptions peuvent ainsi délivrer l'horrible vérité de l'indifférence du regard contemporain, repu gavé à force d'en avoir consommés. L'indifférence est une autre monstruosité, typiquement moderne, dont les symptômes « sont déposés dans les cellules grises de votre écorce cérébrale. Quelqu'un s'est branché dessus » (p. 41).
Indécidable. Le cinquième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent) se ramasse dans le torse de la fille mutilée de Titus. Lavinia a eu en effet la langue arrachée et les mains coupées par les fils de Tamora qui l'ont violée. La mutilation est monstration en empêchant la victime d'accéder à la description de son malheur. Qui pour témoigner quand la victime manque en raison du crime perpétré d'accéder à la parole qui en témoignerait ? Exhibition et mutisme : l'horreur est monstrueuse en coupant la parole. Depuis Méduse, l'horreur laisse sans voix, bouche bée. Pour vaincre la gorgone il faut qu'Athéna vienne en aide à Persée en lui confiant son bouclier qui est le miroir réfléchissant l'épouvante en parant à ses effets de sidération. Ce que peuvent au théâtre les scènes, ce que peuvent ailleurs les images, peinture et littérature, musique et cinéma. Autre paradoxe, non moins cruel que les précédents : la parole ne peut revenir que dans la bouche du témoin de l'horreur mais l'horreur s'accentue quand le témoin, ici Titus le père de Lavinia, joue très mal son rôle en témoignant surtout de son impuissance qui est sa bêtise à ne pas comprendre l'énigme de l'autre qui lui renvoie en miroir la sienne.
Le corps démembré de Lavinia expose ainsi la vérité d'un délitement et d'une fragmentation généralisées en atteignant à la parole déliée de sa puissance de faire entendre au milieu du chaos le juste et le vrai : « Mais quand ce qui a commencé à découdre se découd de plus en plus, quand chaque être humain se délie de l'autre, il n'y a plus que méfiance et abjection » (p. 45). Le hochement de tête de la muette Lavinia est l'indécidable sur lequel se clôt le cinquième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent). Pour Titus, en trancher le sens, qui devrait rester ouvert à l'inépuisable moisson de ses restes bons pour la rumination – restance –, se branche sur le mauvais infini de la vengeance qui est une passion du mimétisme pour le pire : le frère qui imite le frère pour profaner l'enfant du général qui les a défaits, le père qui les imite pour venger sa fille, et cætera, ad nauseam.
Pythonisse. Le septième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent) voit Lavinia affublée de prothèses d'argent et, accompagnée d'une interprète prénommée Monica, elle essaie entre deux râles de lire les Métamorphoses d'Ovide. En particulier le mythe de Philomèle violée par son beau-frère Térée qui lui coupe la langue afin qu'elle ne puisse pas raconter à sa sœur Progné le crime perpétré sur elle. Ce qu'elle réussira cependant à faire à l'aide d'une broderie avant de se transformer en rossignol. La lecture du mythe de Philomèle par Lavinia/Monica représente une maigre consolation face à la fureur aveugle et vengeresse du père qui voudrait forcer la dissipation de sa responsabilité dans l'outrage subi par sa fille. En passant, l'articulation des récits (mythe d'Ovide héritant de Hésiode, récit historique retraduit en théâtre par Shakespeare) constitue une généalogie rappelant à l'art du théâtre le noyau mythique d'une parole fondamentalement inaudible. Et pas qu'au théâtre puisqu'une série comme The Leftovers (2014-2017) de Tom Perrotta et Damon Lindelof a eu la bonne idée de citer dans sa deuxième saison (et l'épisode « No Room at the Inn ») un passage significatif de la pièce de Shakespeare, raccord avec un monde peuplé de femmes qui ont dans la bouche un silence de cendre et d'hommes rivalisant dans le plus grand vacarme d'être des prophéties de l'apocalypse.
Lavinia et Monica composent par ailleurs une étrange machine avec le branchement du torse de l'une et de la bouche de l'autre. Un sorte d'agencement machinique quasiment lynchien dédié aux morcellements masculins du féminin. Comme une pythonisse à deux têtes parce que la Pythie officiant au temple de Delphes délivrait les oracles au nom d'Apollon surnommé le « Pythien » après avoir tué Python le serpent mythique. Titus décrit ainsi la nouvelle pythonisse : « Vous deux, et vos mystères ! Sphinx à deux têtes ! Je souffre. L'outrage que j'ai subi n'a pas suffi, il faut maintenant que je supporte ce tandem à cervelle fendue. Lavinia et son ombre. La fille et sa bouche portable » (p. 50-51). Plus tard, Titus admettra dans un sarcasme qui crève pour lâcher comme une flatulence un gaz de vérité : « Ses râles, pour moi, c'est du portugais. Mon enfant tout entière est une langue étrangère » (p. 61).
La machine féminine est une pythonisse qui délivre une variation circonstanciée de l'énigme sphingique : si les femmes sont pour les hommes des monstres, c'est que les seconds coupent les premières en deux en suivant le fil du python qui se cache dans le creux de leur pantalon.
Viande. Dans le huitième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent), Chiron avoue à sa mère Tamora, alors en train d'accoucher de l'enfant conçu avec Aaron, qu'il est amoureux de Lavinia. « L'aimer s'exclame-t-elle ? Es-tu tombé sur la tête ? Tu veux sauter ce bout de viande ? Baiser une bouche sans langue ? N'es-tu pas un homme ? » (p. 52). La proximité refusée par Tamora parturiente entre elle et Lavinia mutilée appartient pourtant à la viande humaine et ses divisions, toutes ses divisions, ses diviseurs masculins et ses femmes divisées, ses séparations internes comme externes. D'ailleurs, les hommes peuvent former aussi des « duovidus » monstrueux pour reprendre un néologisme de Serge Daney. Ainsi, dans le neuvième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent), Chiron confesse son amour à Lavinia en croyant se défausser de sa responsabilité dans l'abomination commise avec son frère Demetrius, autre monstre à deux têtes, autre machine infernale : « Mon amour fou pour toi a fait de moi un monstre » (p. 56).
Haineuse, Lavinia lui répond au-delà de toute fermeté, dans la violence de son affection sèche comme un coup de trique. La mutilée tranche en séparant l'amour qui promet le pardon entre les deux familles du désir qui brûle et se consume dans la jouissance insensée de l'impardonnable : « Ton cœur, je n'en ai rien à foutre, sale roquet. Seules des nuits d'amour accordent le pardon. Seule la jouissance efface la peine. Tu ne m'aimes pas. Mais je t'attends. Rends-moi visite sans que personne ne te voie » (p. 58). Dans le dixième acte (ou scène ou tableau, c'est indifférent), Titus invite sa fille Lavinia à écrire dans la poussière de la terre, une cuillère dans la bouche, le nom de son bourreau. Lui penche du côté de l'amant noir de Tamora, Aaron. La réponse de sa fille ne consiste cependant pas dans un nom mais dans l'énigme de son désir, délirante et cryptique : « Le désir torture Lavinia. Lavinia veut vivre » (p. 63). La déclaration est incompréhensible, c'est une autre énigme de sphinx pour le père dont l'obsession vengeresse consiste à s'anesthésier en évitant d'entendre et ainsi reconnaître l'ardent désir de vivre de sa fille, malgré tout.
Pricks. Le onzième acte de Viol (ou scène ou tableau, c'est indifférent) est celui de l'enfant que Tamora vient d'avoir avec Aaron et, pour la femme parturiente, le bébé est une autre abomination à éliminer. Une « bestiole noire » aussi répugnante que la mouche écrabouillée sur la table dans l'acte précédent (p. 64). « Est-ce que le noir serait une vilaine couleur ? » demande Aaron (idem). Ce dernier a la réponse : « Noir, noir comme le charbon, couleur absolue. Qui ne se laisse couvrir par aucune autre. Donnez-moi toute l'eau du vaste océan, elle ne suffirait pas pour blanchir les pattes noires d'un cygne » (p. 65). Le noir est la couleur absolue en tant qu'elle est, ambivalente, à la fois celle de la race qui fait de la couleur un stigmate et la non couleur valant pour l'abolition de toutes les couleurs. Si le sexe est le grand séparateur des êtres humains, la race opère autrement, non pas de l'extérieur (la nature et la biologie) mais de l'intérieur (la culture et l'histoire).
Le douzième acte de la pièce de Botho Strauss (ou scène ou tableau, c'est indifférent) est celui de la mort promise au nourrisson ainsi qu'à son géniteur décrétée par Titus vengeant Lavinia qui, évidemment, n'a rien demandé. Dans l'acte suivant, sommet horrible d'absurdité, la mort de Chiron par Titus précède le moment où le fils de Tamora tente de violer Monica afin de s'exciter suffisamment pour parvenir à passer ensuite sur le corps de Lavinia. Monica en profite alors pour citer deux vers d'un dramaturge contemporain de Shakespeare, Thomas Lodge, auteur d'un recueil poétique intitulé Scillaes Metamorphosis (1589) que Shakespeare aurait d'ailleurs plagié : « Pricks do make bird sing, / But pricks in ladies' bosom often sting ». On traduira les vers ainsi : si les piqûres font chanter les oiseaux, les bites dans le sein des femmes les piquent plus qu'elles ne les font chanter. Piqûres et bites s'ajoutent ainsi aux serpents et épées pour rejouer les divisions humaines qui se jouent et se rejouent dans tous les sens, diviseurs masculins et femmes divisées, séparations intrinsèques et extrinsèques.
Cadavres. Le quatorzième acte de Viol (ou scène ou tableau, c'est indifférent) s'encombre du cadavre de Chiron étripé par Titus et Monica, et de celui de Lavinia qui s'est embrochée dans l'épée de son père, tandis qu'Aaron agonise, enterré jusqu'au cou. À côté de lui, son bébé a survécu à la mort promise par Titus, tenu dans les bras d'un garçon prénommé Lukas. C'est l'enfant qui ouvre la pièce et elle se referme avec lui quand à la fin il joue à l'empereur de Rome. Et le petit garçon s'y croit parce qu'en puissance n'importe qui en est devenu un aujourd'hui, à l'époque catastrophique de la modernité catastrophée par la production massive de narcissismes apocalyptiques.
Le maure a cependant encore le temps d'indiquer la nouvelle horreur en laquelle consiste la compréhension de l'épouvante qui, décortiquée par l'analyse rationnelle et sa mise en spectacle, serait privée de toute force de scandale, de sidération avant la rébellion comme il faut à Persée le bouclier d'Athéna pour vaincre la Méduse. Autrement dit, l'horreur dénuée de pathos et phobos qui sont les affects propres à la tragédie se verrait livrée à la publicité mais, loin de rendre la honte plus honteuse encore afin de nourrir la colère et la révolte comme le préconisait Karl Marx, elle entretient le lit d'une indifférence vérifiant notre moderne anesthésie, cynique hébétude. Ainsi, quand Tamora découvre que Titus lui a préparé comme repas son fils Chiron, celle-ci n'a rien d'autre à lui opposer que ceci : « Bon, bon. Le repas était mon fils. Il n'était pas léger, mais bien assaisonné. Pourquoi me fixez-vous, hébétés ? » (p. 83).
« Intus habes, quem poscis ». « Tu as en toi celui que tu cherches » (idem) : c'est ce que dit Progné, sœur de Philomèle, à son mari Térée quand il découvre que sa compagne, pour venger le viol et la mutilation de sa sœur, lui a préparé à manger la tête de leur fils Ithys. C'est aussi ce que dit Titus à Tamora, sa meilleure rivale et ennemie intime. C'est enfin ce que, au terme éprouvant de Viol, souffle Botho Strauss à son spectateur. Celui qui, même replié derrière les grilles de sa résidence fermée, et même adepte de la plus impériale des modernités, a en lui les monstres qui lui font voir les autres comme des barbares, comme il possède l'explication rationnelle qui ne l'empêche en rien de céder à leur antique appel.
28 décembre 2020

Deux pièces dyadiques de Howard Barker
Dans le silence qui dure, l'éternité gravée des mots
Né en 1946 à Dulwich, issu d'un milieu ouvrier, le dramaturge anglais Howard Barker appartient à la même génération que Edward Bond et Harold Pinter sans être pour autant aussi connu et reconnu qu'eux. Peintre et metteur en scène, poète et théoricien du théâtre, Howard Barker travaille au Royal Court de Londres où il croise Edward Bond et David Edgar avant de créer en 1987 sa propre compagnie avec des amis comédiens et metteurs en scène, « The Wrestling School », qui est dédiée à monter ses pièces.
On découvre tardivement en France son « théâtre de la Catastrophe » ainsi que Howard Barker le théorise lui-même, seulement à partir des années 2000. Ce qui le caractérise en quelques mots, c'est son écriture ciselée sur la meule d'un style compact et condensé et ce sont ses figures sans psychologie et épurées, presque des silhouettes qui expérimentent l'épreuve d'une catastrophe fracassant la hiérarchie morale des valeurs. Ce sont encore ses scènes où l'abstraction des concepts est soumise à l'épreuve concrète des corps irrationnels, de leurs passions comme de leurs pulsions et ce sont ses tableaux, enfin, qui rappellent à l'histoire qu'elle est celle des catastrophes insensées comme au présent qu'il est celui de leur accumulation critique.
C'est pourquoi Howard Barker se reconnaît davantage dans les œuvres de William Shakespeare et Bertolt Brecht en s'opposant au consensus psychologique du théâtre classique. Son refus de l'identification participe cependant à la construction d'une autre voie, moins intellectuelle que mystérieuse, moins analytique qu'allégorique. Une voie alternative permettant au spectateur d'accéder à l'intime compréhension de ce qui demeure encore possible à l'endroit même du désastre qui, réel à l'excès, est celui de l'impossible réalisé.
Ce qui évolue, ce qui demeure (publiée à l'origine en 2004, la pièce a été créée en France par Fanny Mentré au Théâtre National de Strasbourg le 11 octobre 2011) : l'arrivée de l'imprimerie est un désastre pour Hoik, le jeune moine copiste qui se croyait hautement méritant avant de découvrir avec quelle rapidité son art se trouve dévalorisé, ringardisé au point d'apparaître déjà comme une antiquité ; mais la modernité est une machine de duplicité dont témoigne aux côtés de l'imprimerie le crime de Hoik, la main outillée d'une autre invention meurtrière, l'arme à feu contemporaine de l'imprimerie ; l'assassinat du rival copiste Slee qui a ri de ses infortunes a pour auteur un être gonflé de l'orgueil délirant du méritant qui, trahi par l'ignominie monstrueuse de son époque, témoigne cependant d'un narcissisme aussi monstrueux, à la fois fratricide et déicide.
Graves Épouses / animaux frivoles (publiée à l'origine en 2007, la pièce a été créée en France par Guillaume Dujardin au Théâtre de l'Atalante le 5 novembre 2009) : la fin du monde est la fin d'un monde, celui des rapports de domination, de domesticité et de hiérarchie entre deux femmes, Card et Strassa, qui se retrouvent comme elles ne se sont jamais rencontrées, rivales longeant face à face ou côte à côte la frontière longtemps indiscernable de l'inimitié héritée et de l'amitié sororale malgré l'obscurité ; la fin du monde est le début d'un autre, nouveau monde difficile et précaire qui est celui d'un nouvel agencement du désir et de la relation entre deux femmes qui consentent laborieusement à se donner ensemble la fiction constituante d'une masculinité absente ; c'est ainsi qu'aussi impuissantes qu'elles sont, elles peuvent cependant recomposer une alliance des vivants plutôt que des survivants, toujours déjà indiquée par quelques ritournelles animales, un chien et des oiseaux.
Dyade. On note tout de suite la structure dyadique des titres, Ce qui évolue, ce qui demeure (en version originale, The Moving and The Still) et Graves Épouses / animaux frivoles (Still Wives / Shallow Animals en v.o.). Virgule ou barre oblique, la dyade est partagée, qui se retrouve ailleurs chez Howard Barker : Gertrude – The Cry, Knowledge and a Girl (The Snow White Case), N/A (Sad Kissing), (Uncle) Vanya, Two Skulls ou encore Gary the Thief / Gary Upright, un recueil de poésie publié en 1987. Un se divise en deux et deux est le chiffre originaire, celui qui divise les genèses et les multiplie, deux fois deux, en rappelant à l'origine qu'elle est, ainsi que l'a montré Walter Benjamin, un tourbillon dans le flux du devenir.
Un se divise en deux pour indiquer non seulement la duplicité de la modernité dont les utopies immunitaires ont une tendance critique à se renverser souvent en violences auto-immunes, mais également la puissance critique d'un geste théâtral qui se retourne sur ses propres bases littéraires et scénographiques afin d'excéder ses propres limites, et ainsi faire sortir les spectateurs des gonds classiques de la représentation et de l'identification. Un se divise en deux, une origine dyadique pour une pensée dialectique à l'épreuve du négatif et sa nécessité exige d'en affronter l'inquiétude afin de retrouver avec le sens du réel, qui est l'impossible même, le sens du possible demeurant possible.
Still. Un se divise en deux, encore, quand un même mot qui se retrouve d'un titre à l'autre (still) est un terme polysémique qui, comme adverbe, veut dire toujours, encore, quand même, tout de même quand, comme adjectif, still signifie autant silencieux qu'immobile, à la fois fixe, calme et tranquille (en anglais still frame signifie cadre fixe). En français, cela donnerait la fourche suivante : il y a The Still au sens de ce qui demeure et il y a Still (Wives) au sens de graves épouses. Ce qui dure a la dureté exigée par la gravité mais la gravité invite aussi à descendre dans les souterrains du silence et de l'immobilité.
Durer c'est graver dans le silence l'éternité des mots qui ne le rompent ni ne l'épuisent.
Fixité, silence, immobilité caractérisent en effet le théâtre de Howard Barker dédié à la grande solitude quasi-photographique de paysages dépeuplés. Des paysages saisis dans l'imminence de la catastrophe ou bien dans le moment d'après qui dure d'une durée sans mesure, aux limites d'un mutisme essentiel à la langue qui se donne en faisant entendre ce qui s'entend difficilement quand cela ne s'entend pas. On retient ainsi des choix de ponctuation qui font sens à la lecture en indiquant des possibilités de mise en scène pour le lecteur s'imaginant metteur en scène : absence de ponctuation à l'exception de quelques points de suspension et d'interrogation dans Ce qui évolue, ce qui demeure ; dans Graves Épouses / animaux frivoles la ponctuation est entièrement ramassée sous la condition de la barre oblique ; mots en gras et que le gras isole dans les deux cas.
La langue est ainsi stylisée en invitant à inventer des scansions qui sont des respirations essayées, des respirations expérimentées en étant raccords avec les contradictions de la modernité : celle qui produit avec ses nouvelles inventions techniques les sujets nouveaux de sa détestation archaïque (Ce qui évolue, ce qui demeure) ; celle qui s'est épuisée en accouchant d'une catastrophe sans épuiser cependant la possibilité d'une réinvention des relations entre les humains et les vivants qui restent (Graves Épouses / animaux frivoles).
Crise. La modernité d'un auteur comme Howard Barker s'évalue alors à la façon dont la création d'une langue, d'une dramaturgie et d'une scénographie, frottée à la manière de quelques maîtres pas si anciens comme Samuel Beckett et Marguerite Duras, est appareillée à une critique radicale des impasses de la modernité, ses apories qui sont des désastres immunitaires, des catastrophes comme autant de retournements auto-immunitaires. La modernité est la crise en tant qu'elle est instituée et généralisée, c'est pourquoi elle n'aurait au fond pas d'autre fonction que de mettre en crise tous les systèmes techniques, économique et politique, culturel et scientifique, symbolique et biologique. Moyennant quoi, répondre à la crise ne peut se faire qu'à partir d'une critique.
La modernité critique de Howard Barker est plus rigoureuse, elle est plus incisive, compacte et ramassée que celle de Botho Strauss, un auteur néo-baroque qui est plus bruyant et dès lors moins disposé à faire entendre le silence consubstantiel de la langue. C'est une modernité qui n'a pas besoin de recourir aux excès hyperboliques de l'hypermodernité pour se prémunir en effet des séductions de la postmodernité qui est cette machine à laver plus blanc la modernité en faisant du ludisme référentiel le moyen dandy et cynique de l'expurger de toute critique politique. Avec Ce qui évolue, ce qui demeure, on croit deviner une proximité esthétique avec Les Aveugles (1891) de Maurice Maeterlinck, pièce de la cécité comme expérience sensible avant que d'être symbolique, pièce aussi de la communauté désorientée, pièce encore d'un autre cénobitisme à inventer. Avec Graves Épouses / animaux frivoles, on ne serait pas loin des propositions radicales du dramaturge japonais contemporains, Oriza Hirata comme Sayônara ver.2 et Les Trois Sœurs version Androïde. Il s'agit de deux pièces traduites en français en 2013 dans lesquelles le destin de l'humanité se joue en s'envisageant dans la perspective du robot domestique qui restera pour témoigner de sa fin comme de son enfance, joué sur scène par l'androïde Geminoid-F conçu par le roboticien Hiroshi Ishiguro.
Dans les deux pièces de Howard Barker, on vérifiera ainsi toujours ceci : la modernité qui est la crise de tout y compris de la fin met en crise le théâtre lui-même ; c'est dès lors une tâche urgente pour son art que d'inventer avec des formes nouvelles des esthétiques susceptibles de rendre compte de façon critique de la modernité et cela pour y répondre en effet, en relevant ce qui peut nous sauver d'elle et qui ne viendra pas ailleurs que d'elle.
Ressentiment. Hoik est une moine copiste du Moyen-Âge et il a 17 ans. Contrairement à un fameux poème de jeunesse d'Arthur Rimbaud, 17 ans n'est pas l'âge des jeunes gens qui jouissent encore de n'être pas obligés d'être sérieux. Hoik a 17 ans et, sérieux comme un pape, il ne sait pas qu'il est déjà plus moderne que la machine moderne de l'imprimerie. Hoik est si sérieusement moderne parce que, très jeune pourtant, il est une figure déjà accomplie du ressentiment. Le ressentiment est une passion caractéristique de la modernité. C'est une passion triste considérée philosophiquement par Friedrich Nietzsche et suivi par Max Scheler dans un registre plus psychologique et sociologique. La ressentiment est une passion triste parce qu'elle est réactive. S'il a l'injustice pour motivation et la colère pour affection privilégiées, le ressentiment nourrit les actions destructrices des sujets d'une anti-politique vécue à l'extrême et qui n'est autre qu'un nihilisme.
Le grand romancier moderne qui nous a alertés sur les ravages contagieux du ressentiment reste Fiodor Dostoïevski, par exemple avec L'Adolescent (1875). Et il y a en effet de l'adolescent dostoïevskien en Hoik, ce moine si fier de ses talents de copiste, si jeune et tellement orgueilleux quand il en discute avec ses pairs qu'il pourrait reprendre à son compte ce que dit le jeune Arkadi Makarovitch Dolgorouki : « La conscience secrète qu'on a de sa puissance est infiniment plus agréable qu'une domination manifeste ». Le mot de ressentiment est si important qu'il apparaît dans la bouche même de Hoik quand il discute avec son camarade moine et future victime Slee : « La mort d'un individu si lui-même acceptait cette mort sans ressentiment susciterait à peine la compassion n'est-ce pas ? » (éditions Théâtrales, 2011, p. 37).
L'imprimerie est une machine moderne en tant qu'elle égalise les conditions en mettant fin aux distinctions. Les talentueux et les méritants sont des modes subjectifs fragilisés par la machine égalitaire qui subordonne la fonction de reproduction des écritures saintes, longtemps dévolue à la corporation ecclésiastique des moines copistes, à des mécanismes à la fois plus productifs et complètement impersonnels. Nuremberg devient la nouvelle Jérusalem pour ceux qui en acceptent les augures et Milan en est une autre quand de la cité marchande italienne vient l'arme à feu. Et, avec elle, une nouvelle façon de donner la mort qui, elle, ne change pas. Du scriptorium à l'étable où Hoik est envoyé pour le punir de son orgueil et des toilettes à la cellule où l'attend l'exécution par crémation, le jeune moine accomplit la trajectoire moderne par excellence, celle qui consiste à jouer une nouvelle technique contre une autre au nom d'une tradition menacée qui n'est telle qu'en étant subordonnée sur l'ego de son défenseur s'engorgeant d'un narcissisme outrancier.
Lumières. « En présence des autres on ne peut pas être soi-même l'être est menacé par cette crainte écœurante de la différence » avoue Hoik à son supérieur, l'abbé November. L'aristocrate de la copie qui se fantasme le plus singulier parmi les singularités quelconques, qui serait l'incomparable incarné, va pourtant à la fin se reconnaître un double dans l'être le moins digne d'être aimé et le plus éloigné de lui. C'est le vagabond beckettien nommé Light, celui qui n'a eu de cesse de lui répéter tout le long de la pièce cette seule phrase : « C'est toi que je préfère » (p. 28). Et Hoik sur le bûcher de réussir à lâcher avant que le feu ne le consume tout entier : « Vraiment ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce moi que tu préfères ? (…) C'EST MOI QU'IL PRÉFÈRE (…) ET MOI C'EST TOI OUI (il crie) MOI TOI » (p. 81).
Le vagabond Light est cette lueur indiquant que la lumière n'est plus celle de la haine qui aveugle jusqu'à la détonation, mais la lumière de la reconnaissance de l'autre qui est le faible, le paria, l'opprimé, le sans part et le sans espoir sans qui l'on ne saurait s'échapper de la prison infernale du moi haïssable. L'âge des métamorphoses n'est pas clos avec la suprématie du monothéisme sur le polythéisme, un exemplaire des Métamorphoses d'Ovide entre deux évangiles à recopier y insiste (décidément, la référence est partagée par Botho Strauss et Howard Barker). Dans la double reconnaissance de Hoik et Light, dans cette alliance fraternelle surgie à l'arrachée du bûcher, on reconnaîtra entre autres la contradiction interne à la modernité dont les Lumières ont hérité, à savoir que les éclaircissements induisent autant d'obscurcissements, dialectiquement.
L'art du théâtre, quand il sait si loin pousser sa pensée critique de la modernité comme crise de tout, autrement dit comme panique, représente en soi une éclaircie tirée de la balance même de l'éclaircissement et de l'obscurcissement, dialectique irrésolue.
Master and Servant. Ce qu'il reste du monde d'avant, c'est une domesticité obsolète. Ce qui a réchappé dans la cendre d'une grande maison brûlée, incendie vaste et sans explication donnée, c'est la ruine même des rapports de domination qui, jusqu'à présent, s'incarnaient traditionnellement dans les figures respectives de la maîtresse de maison et de sa domestique, bonne ou servante. La vieille dialectique du maître et de l'esclave est une autre antiquité, désormais abandonnée à la pente de son plus grand désœuvrement, livrée à une obsolescence imprévisible et, au-delà toute programmation, sans durée fixée ni déterminée.
Le monde d'après est, littéralement, celui d'après les fictions de Harold Pinter, les pièces comme Le Monte-plats (1957), Hot House et Le Gardien (1959) et les scénarios pour le cinéma comme The Servant (1963) de Joseph Losey d'après un roman de Robin Maugham. S'il y a encore des automatismes de classe qui occupent la jointure des corps en parasitant les gestes et les paroles, il y a place, même a minima, pour que monte et brille l'étoile d'un nouvel orient, l'astre d'une orientation neuve tracée à la surface cendreuse et poussiéreuse d'un désastre sans nom. Une place qui se dit d'emblée dans les premiers mots de la pièce, premières paroles que Card adresse à Strassa, anciennes domestique et maîtresse qui ne le sont plus que par réflexes intermittents qui sont les courts-circuits d'un habitus hystérique, qui ne le sont plus que par hystérésis : « Mon mari doit vous posséder / il peut ? / il peut vous posséder ? / Ne répondez pas maintenant / (pause) Ne répondez pas maintenant / » (p. 85).
Reprise. Strassa en convient mais ce à quoi elle consent mérite autant d'être dialectisé : « Les choses changent indéniablement / mais ce changement / aussi inexorable qu'il soit / n'a rien qui puisse nous forcer à nous y soumettre / » (p. 86). Le paysage a changé et il ne cesse pas de changer. Pour qu'il y ait métamorphose (Ovide encore), il doit y avoir pour le sujet de l'événement une décision consistant à hasarder un destin face à ce qui se présente et qui apparaît dans la plus extrême des contingences. C'est-à-dire la plus totale absence de nécessité, la plus grande nudité qui se vit et comprend d'abord comme un dénudement. Dans la balance des transformations et des immobilités, il y a des devoirs qui font place à des puissances, il y a des impératifs catégoriques qui n'empêchent pas malgré leur caractère injonctif de faire entendre l'ouvert tout en suspension des interrogations – il y a dialectisation : « Mon mari doit vous posséder / il peut ? / il peut vous posséder ? / Ne répondez pas maintenant / » (p. 117).
La reprise n'advient que parce qu'il y a eu trouée : trou de l'événement obscur qui délivre un paysage de dévastation post-apocalyptique ; tunnel emprunté à deux afin d'accoucher des restes du vieux rapport de domesticité livré à son antiquité de la relation nouvelle, aussi neuve que la vita est nuova pour Dante poétisant le souvenir de Béatrice. Comment y parvenir dans un monde qui, pour paraphraser Stéphane Mallarmé, a fait de la destruction sa Béatrice ? Par un fantasme partagé en toute connaissance de cause. Autrement dit par la fiction ainsi avérée dans sa dimension symbolique et constituante, de surcroît essayée à l'endroit même où le désastre a emporté avec lui toutes les institutions héritées.
La fiction constituante invite déjà épuiser d'anciennes narrations frappées d'obsolescence. Le triangle de la maîtresse, de la domestique et de son mari, qui articule la vieille triangulation géométrique du désir biaisé par le positionnement hiérarchique des deux femmes, glisse progressivement vers un autre triangle qui est l'étoile même d'un autre désir, étoile du matin qui est celle d'une orientation nouvelle – Vénus. Le mari est la figure d'une masculinité absente, autrement dit il indique le hors-champ et son désir, le désir d'un vide qui ne sera jamais occupé ni comblé, d'un vide demeurant tel pour accueillir en toute hospitalité la nouvelle relation féminine, relation vénusienne.
Image. Après les machines infernales à deux têtes de Viol de Botho Strauss, à l'exemple du couple Lavinia/Monica qui allégorise les divisions humaines distribuées en diviseurs masculins et femmes divisées, le couple formé par Card et Strassa dans la pièce de Howard Barker expérimente, entre résistance, répétitions symptomatiques et lâcher prise, une manière éthique nouvelle d'être deux femmes qui font un monde accordé à leur désir en tant qu'il est polarisé par l'absence radicale du représentant de la masculinité. On pense à nouveau à David Lynch parce que l'on songe en fait et plus précisément à Ingmar Bergman. À Persona (1966) en particulier où le récit d'une semblable scène de masturbation fait jonction entre deux femmes liées déjà par un rapport de soin et de domesticité, la comédienne Elizabeth Vogler (Liv Ullmann) abandonnée à son mystérieux mutisme et l'infirmière bavarde, Alma (Bibi Andersson) qui prend soin d'elle en reconnaissant dans son silence celui de l'analyste pour l'analysant.
La fiction d'une scène de masturbation fantasmée est constituante de la levée stellaire du désir pour deux femmes de faire monde. Un monde vénusien né, accouché dans la ruine achevée de tout rapport de domination. La quête avec laquelle on pourra symboliser ce qu'il n'y a pas et dont le vide constitue le noyau induit la reconnaissance réciproque du désir en tant qu'il est celui de l'énigme de l'autre toujours déjà en soi. Comme toute procédure de vérité la quête est une construction laborieuse. La question répétée « QU'EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ? » de Strassa l'exprime clairement (p. 110). D'autant que l'expression rend grâce au souvenir d'Anna Karina dans Pierrot le fou (1965) de Jean-Luc Godard dont le cinéma se concevait alors comme une discussion serrée avec le cinéma de ses maîtres et de ses pairs à l'image d'Ingmar Bergman.
La dimension expérimentale de leurs films est partagée par la pièce d'un auteur qui montre comment deux femmes échouées sur l'île déserte d'un monde en ruines essaient puis échouent, réessaient puis ratent encore pour mieux tenir à la difficile entreprise de faire naître un monde accordé au désir vénusien d'une double présence féminine et d'une absence masculine. « Tout jadis. Jamais rien d’autre. D'essayé. De raté. N'importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux » ainsi que Samuel Beckett l'a écrit dans Cap au pire (1982).
Alors survient un miracle quand « la loi de l'inversion des rapports / et ensuite » reproduit moins la la structure des rapports qu'elle en avère la faillite (p. 115). Alors arrive l'épiphanie, celle d'un monde sans dieu ni volonté ni injonction ni maîtrise : le chien qui va, vient et revient incarne la ritournelle de la vie nouvelle qui, toujours déjà là, s'émancipe de l'ordre du discours quand il se contracte et se réduit à n'être que celui de l'obéissance impérative : « REVIENS / REVIENS / L'animal ignore le commandement » (p. 114). Et le chien n'est pas rien pour l'auteur du Pouvoir du chien (1985) dont le nom même, Barker, signifie celui qui aboie.
Puissance. On se souvient de la parabole du chameau, du lion et de l'enfant racontée par Friedrich Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra (1885). Trois êtres allégorisent autant de verbes modaux : le chameau est l'animal qui allégorise le devoir, avec sa faute qu'il lui faut porter et assumer comme un fardeau, une charge douloureuse ; le lion est l'animal de la volonté, celui qui commande farouchement au monde de s'accorder à ses désirs. Reste l'enfant qui est l'incarnation du « je peux », non pas du pouvoir parce que le pouvoir n'a pas d'autre désir que de passer à l'acte en livrant ses sujets à l'impouvoir, mais de la puissance qui dit oui au monde en n'oubliant pas de respecter sa propre impuissance. Le désir de l'enfant est celui du désœuvrement en redonnant au monde l'aurore qui lui fait perdre le crépuscule des nations et des civilisations.
Alors que le monde sentait le brûlé, cramé d'avoir été dévasté par le devoir et la volonté de le dominer, alors qu'il apparaissait totalement épuisé, le voilà qui renaît. Le monde fini n'est pas achevé quand il recommence entre une dyade féminine, un chien et quelques oiseaux. Une constellation précaire et fragile de formes de vie qui restent en faisant le nouveau monde délivré des devoirs, des volontés et des impératifs.
Un monde en puissance est toujours celui des possibles qui nous redonnent à respirer quand le monde actuellement livré aux plus incessants et frénétiques des activismes est devenu impossible, n'étant plus que le lieu clos et saturé des ravages de l'immonde et ses paniques.
3 janvier 2021
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...

