Ma ville est le plus beau park : revoir Playtime de Jacques Tati (II)
A l'occasion en cette fin du mois de juillet de la resssortie en version numérique de Playtime ainsi que de tous les autres films de Jacques Tati, voici un article en deux parties édité le 10 juillet 2002 par Objectif-cinéma :
NO PARKING
« Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société, et comme instrument d’unification (qui est en fait) le langage officiel de la séparation généralisée » (Guy Debord, La Société du Spectacle, éd. Gallimard, 1992)
|
|
|
On pourrait aussi maintenant s’atteler à la tâche d’analyser de façon plus précise et plus profonde à l’œuvre dans Play Time quatre couples ou binômes réflexifs, chacun(s) doté(s) d’un espace de travail ouvert par la mise en scène, et créateur d’une unité maîtrisable d’observation et d’investigation comme l’écrivait l’anthropologue Marc Augé dans notre précédente exergue, et dont les agencements ou emboîtements donnent au film sa configuration. C’est-à-dire quatre lignes de force complémentaires et combinables qu’accompagne le motif de la vitre comme principe de factorisation de ces couples et d’échange de leurs énergies esthétiques et critiques.
Totalisation-dissémination (centralisation-périphérie) : l’usage du cadre et du gag dans le cadre
« Car rendre les choses spatialement et humainement "plus proches" de soi, c’est chez les masses d’aujourd’hui un désir tout aussi passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen d’une réception de sa reproduction »(« L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » in Walter Benjamin, Œuvres III, éd. Gallimard, 2000, p. 278).
Quel est donc exactement ce petit peuple intrigant qui s’agite dans Play Time et qui n’a plus rien des communautés banlieusardes ou villageoises des films précédents, « foule solitaire » (Guy Debord citant Vance Packard) pas immédiatement reconnaissable, et dont le cinéaste règle dans son film, selon le bon mot de Von Sternberg, la circulation ? L’espèce humaine elle-même, simulant sur l’air enjoué du défilé de mode, en continue représentation d’elle-même, un modèle d’humanisme sans perte ni déchet (de type donc humanoïde). « Les inculpabilisables dansent » (Milan Kundera). Ce que nous sommes, spectateurs, en regardant le film ? Un souvenir nostalgique, amusé (souligné par les ritournelles naïves chères à Tati et composées ici par Francis Lemarque et Dave Stein) et à peine ému que traînent loin derrière elles les figur(in)es du film, types modélisés et sérialisés, catégories normatives (la secrétaire, le vendeur, le patron, l’employé, etc.), c’est-à-dire la miniaturisation de ce qui n’existe peut-être déjà plus. Soit du corps auquel se substitue une image hygiéniste de celui-ci expurgé de ses organes, lavé de toute personnalité. Soit des affects dévoyés en nécessités fallacieuses de consommer pour signifier son être-au-monde, son appartenance à celui-ci, son entière adhésion à ses logiques marchandes. Soit des pulsions neutralisées par les logiques amorphes d’environnements atones et gris, sans plus aucun dehors ou bien alors rabattant tout le dehors sur eux-mêmes, n’en conservant que l’image cliché qui brillera une nouvelle fois sur les vitres des grands magasins : le monde réduit à la carte postale des monuments incontournables du tourisme planétaire.
Paris, capitale du XXIe siècle, Babel moderne et sans Dieu dont Tati est le Breughel, n’est qu’un accélérateur économique de particules infra-humaines, la super-structure de consommation comme fin du fin de la transcendance et qui se croit éternelle. « [Le] pouvoir que [le système industriel] exerce sur la croyance sociale (…) est parvenue, tacitement à dissiper l’idée qu’il est un phénomène transitoire » (John Kenneth Galbraith, Le Nouvel État industriel, éd. Gallimard/NRF, 1974, p. 410).
|
|
|
Ce qui est à l’œuvre dans Play Time est l’intégration psychologique des principes marchands d’objectivation : ici tout se vaut, « l’hyper-marchandise » (Jean Baudrillard) règne
jusque dans son annexion totalitaire de corps devenus pièces interchangeables. En conséquence il ne saurait y avoir de subjectivité susceptible de se dégager et de faire trace. D’où la nécessité
de l’existence singulière à l’écran de Hulot / Tati, sans arrêt refoulé en périphérie des cadres fortement centrés, en bordure des scènes qui se veulent les lieux de l’essentiel que Tati metteur
en scène élabore à l’opposé du geste chaplininien qui était de ramener au centre le personnage de Charlot qui prenait facilement la tangente. C’est le film en son entier qui montre sans trembler
un ordre coercitif, intériorisé et auto-régulé qui tente de se débarrasser des êtres qui lui paraissent improductifs (Hulot déjà vidé dans Mon Oncle le sera aussi dans Trafic :
ici, il ne décrochera jamais l’emploi pour lequel il avait postulé).
Mais c’est aussi une cohorte de doubles de Hulot qui à la fois affadit inévitablement en se multipliant à l’écran l’excentricité et l’originalité du seul Hulot connu jusqu’à présent comme aussi elle souligne le vœu tatien de ne plus simplement se concentrer sur un personnage devenu mythique mais de voir le monde entier comme une industrie (de moins en moins consciente de son caractère dérisoire qui donne matière à du risible) de production de gags en série. Cette dispersion du même (1) affectant la figure de Hulot a pour effet direct de brouiller les possibilités pour que ce dernier puisse marquer de son indélébile empreinte un tel univers concentrationnaire dont l’idéal villageois (même globalisant selon le mot célèbre de Marshall McLuhan) et technicisé à l’extrême se signale par l’infinité de sa mesquinerie. Seule la petitesse a des chances de grandir ici ; c’est la même indéfectible frilosité qui facilite d’autant mieux le travail de lustrage et de brillance décrété par le système.
|
|
|
Le fauteuil aérodynamique et mou reprend sa forme initiale après que l’on se soit assis dessus. Ce qui fait marque ici, c’est le charbon sur le goulot de la bouteille de vin qui signe la fraude
d’un ouvrier de l’établissement (et le maître d’hôtel, puisque c’est lui le fautif, est rappelé à sa condition d’exploité comme ceux dont il est le supérieur hiérarchique), à la bouche toute
cerclée de noir (variation d’un gag de Jour de fête) ; ce sont les dossiers des chaises du Royal Garden, son logo (une couronne à cinq branches) dont le motif s’est déposé à même la peau
des clients. Fer de marquage pour les bêtes destinées à la vente ou l’abattoir, inscription d’incarcération digne deA la Colonie pénitentiaire de Kafka, résurgence douce de l’univers
concentrationnaire auquel Tati, plus jeune, a réussi à échapper. Soit on est marqué visiblement sous le sceau de son asservissement marchand, soit on est voué à l’invisibilité, signe d’un
assujettissement plus pervers encore : au signe distinctif de consommation (la marque, la griffe) succède la marque première (et barbare comme dirait Walter Benjamin) de l’exploitation
prolétaire, celle de ne pas être vu au travail de sa propre exploitation.
Hulot partage cette condition à l’invisibilité avec les ouvriers du film, population tenace (et déjà dans Mon Oncle, elle n’en démordait pas) qui renvoie directement à celle, réelle, de Play time en tant qu’entreprise, usine de production cinématographique, et que Tati n’a au contraire jamais ignorée. On n’a peut-être jamais aussi bien filmé avec attention et avec respect la classe ouvrière dans le cinéma français. Et la manière sans atermoiement avec laquelle on essaie de la faire disparaître à grand coup de plumeaux, à coup sec de torchon. Montrer chez Tati équivaut à désigner (à dessiner, à designer) l’intolérable accepté de nous, tel qu’il n’a jamais cessé d’être, sous l’auspice du rire (et de la fonction pédagogique que lui assigne l’auteur de Parade). Le rire comme lunettes d’appoint, le rire comme garde-fou.
Espace public-espace privé : le raccord et l’échange du dehors et du dedans
« Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images (…) C’est une vision du monde qui s’est objectivée (…) Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie ; comme la négation de la vie qui est devenue visible » (Guy Debord, opus cité, pp. 04 et 06).
|
|
|
La socialité-sociabilité du film est polarisée en différents lieux de rétention qui sont toujours des lieux de servilité (employeur-employé, mari et femme dans une terrible symétrie de la domination esquissée dans Mon Oncle). De domesticité. Le social est instrumentalisé par la loi du marché qui se doit d’effacer en conséquence les propres traces (le signe de sa barbarie selon Walter Benjamin) des rapports (aliénants) de production qu’elle induit mécaniquement. Et cette mécanique n’est rien d’autre que de l’idéologie capitaliste qui, en plus de légiférer l’espace publique, a envahi dorénavant l’espace privé, en affectant définitivement le jeu de relations qui s’y jouent.
La rencontre fortuite de Hulot avec un ancien collègue de l’armée qui décide de l’emmener visiter son « home » est de ce point de vue très instructive. Si tout communique comme chez la
famille Arpel de Mon Oncle, plus rien ne se dit : les cadeaux évitent de parler avec son conjoint ou son enfant, les gadgets dont il faut déployer l’ingéniosité ou la richesse
d’invention masquent un déficit communicationnel uniquement basé sur l’épate matérielle, la TV déplace ou neutralise l’intérêt que l’on pourrait avoir pour l’autre au nom d’une incommunicabilité
prévenant une fatigue existentiel cumulée à celle de la journée passée au travail. Allant même plus loin que ce constat pas si éloigné de ceux dressés par Michelangelo Antonioni son contemporain
(qui lui rendait hommage dans un gag de L’Éclipse en 1963), Tati montre aussi que la baie vitrée du salon de cet appartement standard situé au rez-de-chaussée et donnant sur la rue
renvoie à la nullité spectaculaire d’une telle vie privée qui ne souffrira jamais de l’amincissement de son intimité au profit de la participation sans douleur du regard publique à sa
pantalonnade. Consommer, c’est aussi être des yeux consumé.
« Le verre (…) est un matériau dur et lisse sur lequel rien n’a de prise. Un matériau froid et sobre, également. Les objets de verre n’ont pas d’aura. Le verre, d’une façon générale, est l’ennemi du mystère » écrivait Walter Benjamin en 1933 au sujet de L’Architecture de verre de Paul Scheerbart (In Œuvres II, éd. Gallimard-coll. « Folio essais », 2000, p. 369) . Si la vitre permet, en soulignant la spectacularisation en cours de l’espace intime que poursuivent aujourd’hui les téléphones portables et les webcams, de renouer avec le cinéma muet (Manoel De Oliveira dans Je rentre à la maison en 2001 procédera pour certaines séquences de la même manière), elle distingue aussi cette logique de réversibilité qui voit l’extinction du lieu en tant qu’espace de durée (la demeure) pour devenir celui d’un passage de moins en moins long à pratiquer et qui ressemble de plus en plus à une salle d’attente.
|
|
|
La Ville comme antichambre ou purgatoire d’une humanité en voie de devenir ectoplasmique fait songer à une vaste fourmilière. Et justement sur ce point Alain Resnais apprit un jour que « dans la fourmilière 30 % des fourmis font mine de s’activer mais ne foutent rien d’autre que s’agiter pour donner l’impression d’abattre un travail épuisant » (in Positif, n°442, décembre 1997). On pense inévitablement au majordome du Royal Garden dont la stricte fonction est de surveillance et de représentation, le simulacre rôdé et virtuose de l’intense dévouement et de l’inlassable activité au service du client-roi. Aujourd’hui la Ville est le lieu même de ce trafic, de cette Comédie du Travail (qui est aussi le titre et le sujet du film d’un cinéaste tatien, Luc Moullet).
Reproduction-consommation : la (grande) surface et la répétitivité
« Cet immense système de sollicitude vit sur une contradiction totale. Non seulement il ne saurait masquer la loi d’airain de la société marchande, la vérité objective des rapports sociaux, qui est la concurrence, la distance sociale croissante avec la promiscuité et la concentration urbaine et industrielle, mais surtout la généralisation de l’abstraction de la valeur d’échange au sein même de la quotidienneté et des relations les plus personnelles (…) Destiné à produire de la sollicitude, il est voué à produire et à reproduire simultanément de la distance, de la non-communication, de l’opacité et de l’atrocité » (« Playtime, ou la parodie des services » in Jean Baudrillard, La Société de la Consommation, Paris, Gallimard, 1970, p.258).
|
|
|
L’humanité de Play Time est fonctionnelle, dépersonnalisée, standardisée. Elle se meut selon des trajectoires programmées dans l’imbrication supposée performante d’espaces de fonctionnalité que visite de façon impavide cet éternel étranger, ce touriste, ce vacancier qu’est Hulot, notre guide angélique, notre semblable, notre frère céleste (l’aéroport qui ferme Mon Oncle et qui ouvre Play Time), notre boussole dans l’enfer glacée de notre modernité. Il est une « velléité de personnage » (Michel Chion) qui paraît toujours en porte-à-faux là où il se trouve, éternel déplacé dont la passivité signe en dernière instance sa résistance opiniâtre à toute incorporation violente (l’armée qui sert pour deux anciennes connaissances à se rappeler à lui, l’armée comme processus d’intégration et de socialisation, comme le seul souvenir d’une histoire commune, l’armée comme vérité définitive d’un monde ordonné jusqu’à l’asphyxie, l’armée c’est déjà loin, c’est toujours là).
Révélateur malgré lui de l’entreprise d’homogénéisation totale qui se joue là, sur lui, contre lui (un burlesque est toujours un paranoïaque : c’est le monde ou lui !), Hulot est, erre, flotte, poussière archaïque d’une humanité passée que les aspirateurs (avec phares !) du modernisme, de la fureur du tout technologique, ont pour tâche d’engloutir. Si l’enrégimentement suinte de partout, Hulot passe quand même au travers des gouttes.
Même son unicité est noyée dans le flot continu de la valse de ses doubles surprises (Hulot cloné !). La seule chose d’unique ici c’est le film, grande surface profonde artistiquement, impossible à reproduire esthétiquement et qui aligne cube scénographique sur cube scénographique en démontrant la stratégie publicitaire (cette culture massifiante et itérative) qui les gouvernent. Une colonne grecque présentée dans un stand ? En fait c’est une poubelle pratique et amusante ! Même les rats ne sont ici que des simulacres de fourrure bons pour les femmes du monde (il n’y a pas d’autre animal que l’espèce humaine dans Play Time). C’est l’utile qui, rejoignant l’agréable, trace la ligne d’horizon désespérément plate d’une société vouée à être assignée aux lois de la consommation, aux valeurs suprêmes d’usage et d’échange.
|
|
|
C’est pourquoi le célèbre parapluie de Hulot, véritable extension organique, lui sert à beaucoup de choses : c’est une canne qui lui permet de ne pas tomber (mais aussi une épée de chevalier courage, des ailes d’ange qui l’empêchent de voler, etc.). A tout donc sauf à se prémunir d’une pluie imminente qui ne viendra pas, malgré le ciel qui ouvre Play Time, lourds de nuages gris. Subversion de Tati : cet objet ne se définit plus par rapport à la fonction première qui le constitue en tant que parapluie, son existence technique est emmenée par Hulot au-delà de sa stricte définition fonctionnelle. De toute façon ici, il ne pleut pas. Pire, il ne pleut plus. Il faudra attendre la fin de Trafic pour qu’un crachin promis par le parapluie de Hulot ait enfin lieu, modeste épiphanie dans un monde qui en est singulièrement dépourvu (dans ce film il n’y a presque plus d’enfants), préférant les joies calculées d’un feu d’artifice consumériste et technologique que Hulot dans Les Vacances de M. Hulot lançait (maladroitement pour lui, significativement pour nous) trop tôt, ruinant par avance l’effet factice d’événement promis par le pétaradant gadget.
Le dur et le mou : la volatilité du gag et la distribution centripète du son
« L’activité de l’ethnologue de terrain est dès le départ une activité d’arpenteur du social, de manieur
d’échelles, de comparatiste au petit pied : il bricole un univers significatif, au besoin en explorant (…) des univers intermédiaires » (Marc Augé, opus cité, p. 21-22).
|
|
|
La seule arme dont dispose Tati en tant que metteur en scène cette fois-ci, c’est la modernité esthétique qui, non pas disqualifie les injonctions et les codes institutionnalisés par ce
haut-lieu, ce parangon dur et massif de la nouvelle socialité-sociabilité (autrement dit plus efficace, plus productive, directement connectée à la grande machine de production marchande) qu’est
la Ville (Paris, cité anonyme et internationale, semblable à n’importe quelle autre métropole) mais chercherait plutôt par son formalisme pointilleux à lui faire rendre gorge, à l’exténuer en la
sur-signifiant de détails plus insolites les uns que les autres. La mollesse ontologique de Hulot (son chapeau gondolé, son parapluie flottant, son imper froissé, son visage souple, ses velléités
professionnelles) contredit par l’élasticité de son être la matérialité indestructible de structures de socialisation comme des discours rigides qu’elles contiennent. Que peut le dur lorsque le
mou, signe même de l’enfance, est si peu unifiant ?
Si Play Time est l’anti-Metropolis par son refus de tout alarmisme ou catastrophisme idéologiquement suspect, il serait plutôt une sorte de suite à The Crowd (1928) de King Vidor (mais un The Crowd sans la tragédie américaine de l’individualisme et du sujet) ou alors une sorte de Modern Times II mais dégraissé d’une dramaturgie de la violence technologique trop voyante (et la parenté des titres n’est, semble-t-il, pas une coïncidence) comme s’il avait été réalisé par un Buster Keaton dans la continuation de son œuvre (on pense à son court métrage Electrical House en 1921) (2). Comme chez ce dernier, on ne se moque des objets qu’à condition de les inventer soi-même en leur impulsant des intervalles élastiques de jeu à l’intérieur de leur codification d’usage : la critique se fait à ce prix, en mettant directement la main à la pâte. Il s’agit quand même de se faire au moins aussi intelligent que l’intelligence artificielle dont on cherche à décortiquer les mécanismes dominants, à détailler les circuits fondamentaux, à déconstruire l’idéologie qui l’habite (et la meilleure arme de celle-ci est de se cacher dans ses plis les plus fins, les plus ramassés).
|
|
|
L’enseigne lumineuse du Royal Garden est comme le symbole-clé du film, au-delà de la désignation par Tati de sa fonction programmée d’alpaguer du chaland friqué (ce qui est drôle ici est que cela marche trop bien, davantage que ce qui était vraisemblablement souhaité), quant au rapport que le cinéaste entretient avec la question du son dans son cinéma : il s’agit à bien y regarder de l’image du pavillon d’une oreille. Les multiples niveaux ou pistes sonores que Tati met en place (musique extra ou intra-diégétique, phonèmes et parlures se substituant aux classiques dialogues, bruits courts ou longs souvent difficilement localisables, etc.) affectent en profondeur l’écran, le dotant d’une troisième dimension qui donne au film son aspect cubiste ou environnemental, permettant d’abord à son concepteur une approche d’observation critique de type structuraliste, lui donnant ensuite la capacité d’accueillir dans l’immensité d’espaces ainsi déployés une forme de fourmillement qui participe au contrat ludique établi avec le spectateur.
Très souvent, le son dans la distribution significative de ses signaux affecte la visibilité du plan : on croit voir au début de Play Time une clinique, il s’agit en fait d’un aéroport.
Ainsi, le gag obtenu (dans un esprit assez proche de Jean Cocteau) dans une compréhension après coup perd de sa puissance d’instantanéité comique certes, mais au profit de l’instauration d’une
image mentale coexistant avec l’image réelle, une image virtuelle (la clinique) qui court-circuite l’image actuelle (l’aéroport) parce qu’elle en révèle une vérité enfouie. Cette odeur d’hôpital
qui ne règne pas seulement qu’à l’hôpital est aussi celle qui accompagnera le cinéma de David Cronenberg (Crash en
1996) ou un film comme Safe de Todd Haynes en 1996. La Ville comme réserve, zoo de prestige : l’espèce humaine se sait menacée.
|
|
|
C’est à peine le souvenir de la guinguette qui s’actualise temporairement lors de la surchauffe du Royal Garden, sourire à peine esquissé d’un temps que, comme le dit la chanson, les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. D’un temps survivant dans le cellophane de ses clichés. D’un autre monde possible dont l’utopie (la fête ivre d’après la fin de la lutte des classes) est furtivement touchée du doigt avant de s’enrouler dans un petit tourbillon gazeux et de disparaître, tels ces nuages ouvrant le générique.
Cette tension dialectique entre la bande-image et la bande-son (seuls en France dans les années 60 Robert Bresson, Alain Resnais et Jean-Luc Godard sont avec Tati ceux qui ont le plus travaillé cet aspect régulièrement laissé de côté dans le cinéma) redéfinit fortement la constitution même du gag devenu plus mystérieux, moins facilement localisable, gazeux ou volatile. Échappant à la vigilance du spectateur, il demande un surcroît d’attention mais dans le même mouvement, son importance se relativise : loupé, le plan n’en mourra pas malgré tout. Le gag ne se donne plus tant à voir qu’il réclame surtout que le spectateur aille le dénicher. On touche là au nerf sensible du chef-d’œuvre de Tati : si le film est drôle, c’est que le regard qui l’anime produit de la fantaisie là où celle-ci est définitivement exclue des parages.
Ce qui fait rire, c’est l’introduction en biais (en cela le son y aide beaucoup) d’un axe de vision qui ouvre la frontalité des plans et leur terne contenu au comique, mais un comique tout à fait original, dont les tenants sont du cinéaste (l’installation du gag) mais dont les aboutissants (lorsque le gag est actualisé) résident dans les images qui peuplent l’imaginaire du spectateur. Sans le regard de Tati comme première béquille et le nôtre comme seconde béquille, ce monde qui est notre monde s’effondrerait de son poids mort (un embouteillage qui ressemble à un manège, un lampadaire à du muguet, c’est moins navrant), celui de son sérieux.
|
|
|
Deux gags figurent par leur classicisme le négatif de toute l’entreprise tatienne. Quand Hulot tombe (la chute, base du burlesque et du rire selon Bergson) pendant la séquence du Royal Garden,
l’écran est si saturé de signes, est si zébré de turbulence qu’on ne le remarque même pas (ou alors cela ne fait pas vraiment rire) ; de plus l’assiette et le verre d’alcool qu’il tenait entre
les mains gardent leur contenu malgré la chute. Lorsque des ouvriers essaient de pousser dans un immeuble une cloison amovible, d’autres ouvriers en bas de la scène se fichent d’eux en mimant
pour quelques secondes un orchestre de jazz. Ces ouvriers-là sont sûrement les enfants farceurs de Mon Oncle qui ont grandi : ils incarnent, à l’instar de tel serveur ou de tel client,
la survivance résiduelle d’une volonté fantaisiste (celle simplement de faire des images autres que celles qu’on nous propose) qui a fui le monde quand ce monde-ci a progressé de plus en plus
vers un ridicule qu’il faut bien qualifier de consommé. Au sinon, personne ne s’esclaffe dans le film des travers, gaffes ou bizarreries que nous sommes certains d’apercevoir et qui nous font
rire. Le ratage même, passage obligé du classicisme burlesque, n’a plus cours ici : tout réussit, tout communique, le rire n’étant que la tentation d’un possible.
Notre joie est foncièrement seule, elle est le signe qu’elle a été amortie puis résorbée de cette société-là, nous devenons nous-mêmes le signe joyeux d’une résistance à ne pas nous laisser
absorber par de tels régimes qui nous font miroiter un gain quand ils omettent toujours volontairement la perte consubstantielle qui suit comme un ombre celui-ci. Nous sommes le monde qui
précède le monde représenté dans Play Time. Nous sommes ce monde qui, programmatiquement, cédera sa place. Nous sommes l’ancien monde et peut-être ne sommes-nous pas tout à fait prêt
pour passer, même progressivement, au suivant. Qu’est-ce alors donc qui progresse dans Play Time ? De la ligne droite des buildings à la circularité finale des trajets automobiles (c’est
comme si Tati partait, en terme de peinture, de Mondrian pour aboutir à Delaunay), du gris aluminium aux couleurs acidulées et pétillantes des dernières séquences, on aura compris que c’est du
pareil au même : le cercle souligne bien les rapports cycliques entretenus par une société de consommation qui ne veille qu’à opérer dans un faux présent déshistoricisé le retour des mêmes
schémas (d’exploitation, de domination, de production), les couleurs révèlent leur caractère artificiel : celui de faire « plus vrai » quand le vrai a définitivement laissé le champ libre à des
simulacres de lui-même.
|
|
|
Bienvenue dans l’ère de « l’hyper-réalité » (Jean Baudrillard) qui a fait son deuil heureux des anciens référents réels du monde au bénéfice de ses images. On aura saisi qu’il n’y a point ici de nostalgie, mais comme le disait Serge Daney il y a l’œuvre dans Play Time une « mélancolie active du présent », celle que contient ce brin de muguet final et qui renvoie au scénario tatien par excellence (la rencontre in extremis, ce qui arrive malgré tout à passer, à être raccordé presque en contrebande – en cela Tati se distingue d’un cinéaste tel Jacques Demy qui n’a pas cessé de montrer que le bonheur est une chose toujours, frêle, frôlée, jamais possédée, réel mais en l’état virtuel) comme à la classe ouvrière toute entière à laquelle le film implicitement est dédiée, à l’origine d’une société d’abondance (sa totale exploitation) dont elle jouit si peu (sa faible part dans le jeu de la consommation).
Conclusion (définitive ?)
« Ce besoin de donner un sens au présent, sinon au passé, c’est la rançon de la surabondance événementielle qui correspond à une situation que nous pourrions dire de "surmodernité" pour rendre compte de sa modalité essentielle : l’excès » (Marc Augé, op. cit., p. 42).
|
|
|
Excès de tout, et jamais rien de ce que l’on aimerait au fond (un peu de perte sans conséquence et sans gain, un espace sans rentabilité). Excès synonyme, c’en est le revers logique, la face inaltérable et au fond tragique, d’une « ultramoderne solitude » que le film de Tati, dans l’extraordinaire légèreté de sa vision de la « surmodernité » (même si son matériau est lourd), rend cent fois plus prégnante que la chansonnette d’Alain Souchon à partir de laquelle on aura tiré la célèbre expression. Et le rire qui la révèle est la politesse d’un Tati gentleman qui souhaiterait unir en une seule puissance libératrice aristocratie et démocratie : le meilleur du peuple, c’est tout le peuple qui jouit en commun et sans hiérarchie ni accumulation (le rire ne se possède pas) de sa désignation ludique.
Notes :
1) Mais ce sont également toutes ces silhouettes en carton, tous ces mannequins qui dans le fond du plan renchérit sur une indifférenciation entre l’homme et sa fonction sérialisée, à l’instar du traitement visuel de la masse fasciste dans The Great Dictator (1941) de Charles Chaplin.
2) On notera qu’historiquement Play Time est le dernier film qui, à la suite des œuvres précédemment citées (mais on aurait pu mentionner aussi Sunrise de F.W.
Murnau, influence incontestable du film de Tati), est la recréation construite et enregistrée sur film d’une ville en soi. En 1981, Francis Ford Coppola avec One from the Heart
appliquera la destitution du matériel classique (le décor bâti) au profit de la vidéo sans trace et des effets spéciaux, ouvrant la voie avec Georges Lucas au tout-numérique qui règne en maître
dans le cinéma américain contemporain.
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...

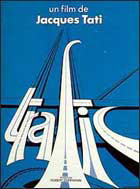





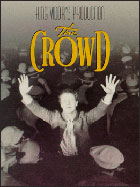

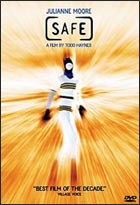



Écrire commentaire