Jean-Luc Godard cité à comparaître
une lecture critique de Passés cités par JLG de Georges Didi-Huberman
(éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 2015)
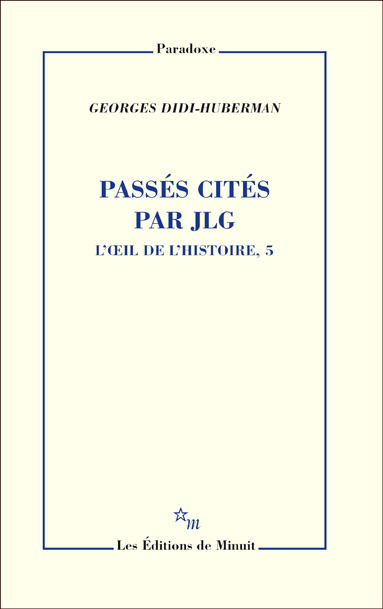
« Or, n'est-ce pas le montage qui, dans un film, prend d'abord en charge la monstration des différences ? Ce qu'on ne peut pas voir, il faut donc le monter, afin, si possible, de donner à penser les différences entre quelques monades visuelles – séparées, lacunaires –, façon de donner à connaître malgré tout cela même qu'il reste impossible de voir entièrement, cela même qui reste inaccessible comme tout » (Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 2003, p. 172)
« Unissez les extrêmes, et vous aurez ainsi le vrai milieu » (Friedrich Schlegel cité par Georges Didi-Huberman, Passés cités par JLG. L'Œil de l'histoire, 5, éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 2015, p. 170)
Comprendre comment les images relèvent moins de prises de parti que de prises de position, c'est apprendre des méthodes, pratiques ou stratégies déployées par ceux qui les auront montées afin de plonger dans l'œil de l'histoire et, comme le fit le rasoir en ouverture de Un chien andalou (1929) de Luis Buñuel et Salvador Dali, en couper en deux le globe afin de relever l'image des opprimés que l'écriture de l'histoire imposée par les oppresseurs occulte. Cinq volumes de la série ouverte intitulée L'Œil de l'histoire proposent un examen minutieux des procédures de montage spécifiquement adoptées par divers penseurs, qu'ils soient artistes ou philosophes : Quand les images prennent position en 2009 avec Bertolt Brecht et Walter Benjamin, Remontages du temps subi en 2010 avec entre autres Samuel Fuller et Harun Farocki, Atlas ou le gai savoir inquiet en 2011 avec Aby Warburg, Peuples exposés, peuples figurants en 2012 avec entre autres Pier Paolo Pasolini et Wang Bing et désormais Passés cités par JLG. Ce dernier ouvrage se démarque largement de ses prédécesseurs, notamment en ceci qu'il se focalise sur le travail d'un cinéaste reconnu comme l'un des plus importants mais aussi comme l'un des plus susceptibles de critiques, au-delà des effets d'idolâtrie que son œuvre susciterait généralement chez nombre de ses laudateurs. L'humeur critique, parfois acide, quelquefois acerbe, ne cesse pourtant de trahir des convictions et des prises de position en elles-mêmes critiquables tant elles révèlent des prises de parti obérant la lucidité analytique de celui qui disait vouloir soumettre à son regard une œuvre elle-même saturée d'énergie critique. En effet, l'exégète force inhabituellement le trait, l'herméneute tort quelque peu l'argument, il fait quelquefois un sort au socle commun de la discussion rationnelle ou de l'objectivité critique afin de citer à comparaître un artiste qui se sera fait fort de tenter l'impossible en redressant quelques torts (par exemple, l'éternité de l'art pour les vaincus et en relève des archives historiques du mal radical caractérisant les vainqueurs). La prise de position critique se réduit alors au fil des pages en une prise de parti idéologique soutenue par des partis pris argumentatifs particulièrement discutables. La lecture n'en aura été que plus paradoxale, contrite par les impasses (inhabituelles chez cet auteur) de la lecture critique proposée, renforcée par ailleurs dans le désir d'y répondre sur quelques points de l'argumentation parmi les plus problématiques.
1) Pas les auteurs,
les œuvres
Georges Didi-Huberman (appelons-le ici, sur imitation de celui qu'il critique, GDH) ne cessera jamais d'y insister tout au long des 200 pages de son ouvrage : le geste cinématographique godardien balancerait entre des positions inconciliables, il serait mu par un balancement irrésolu entre des oppositions résistant à toute relève après coup ou toute tentative d'unification synthétique. Entre « un geste de respect » et « une posture irrespectueuse », entre des « passés pensés » et d'autres « passés dépassés », entre un « acte de référence » et un « acte d'irrévérence » (p. 15), les films de Jean-Luc Godard (on l'appellera forcément ici JLG), en ce qu'ils sont soumis à une méthodologie citationnelle faite de récolte et de récolement, de recollage et peut-être même de « racolage » (p. 16), balancent. Le mouvement de balancier étant ramassé dans la contradiction logée au sein de l'autorité : le « rejet de l'autorité » se dédoublerait toujours déjà en effet d'un « appel à l'autorité » (idem). Du coup, la citation godardienne se comprendrait selon deux perspectives distinctes, pour ne pas dire opposées et opposables : tantôt comme « parade », tantôt comme « parure », la première induisant une pratique de la sous-exposition et la seconde une tactique de la surexposition (p. 26). Il en irait ici d'une opération de séduction (le mouvement de balancier pourrait ressembler à celui d'un fessier semblable à celui de BB dans Le Mépris en 1962), un coup dans le rejet de l'autorité (c'est une parade), un autre dans son appel (c'est une parure). La citation inscrite dans cette stratégie de balancier induit, en raison d'un primat accordé à la raison dialectique, de rompre avec tout dialogue ou dialogisme (la citation coupe court et fuse). Et, dans la foulée qui est une fusée, de réfuter le principe aristotélicien de non-contradiction : il est vrai que la proposition « de l'une deux choses » est bel et bien préférée à la proposition « de deux choses l'une » (p. 28). Mais, bizarrement, GDH subordonne cette préférence du Deux (comme division de l'Un) à l'Un (comme choix déqualifiant le Deux) sous le régime d'une « parole paralogique » (idem). C'est que la « logique autre » désigne ici le travail de la contradiction (que l'on devine déjà intenable pour l'auteur) opposant une « désautorisation de tout ce qu'il cite » et une « réautorisation de soi-même » (p. 30). On se demandera alors comment de tels éléments d'analyse, balançant entre l'attitude compréhensive et la posture offensive, et qui sont censés renseigner sur la méthodologie godardienne, informeraient partiellement au moins sur la méthode adoptée par GDH lui-même dans sa lecture critique. Lui qui, philosophe et non pas artiste, s'appuie sur l'univocité des citations des auteurs qu'il mobilise afin de consacrer classiquement sa propre autorité. Mise en question chez le cinéaste qui cite en réécrivant irrévérencieusement la citation (par exemple littéraire) et en la dissociant de son auteur de référence, l'autorité ne l'est jamais chez GDH qui conteste chez JLG que la mise en question relève d'une stratégie compliquée – et dont la complication témoignerait déjà d'une duplicité – consistant à faire revenir par la fenêtre une autorité mise à la porte des citations dissociées de leur auteur. La montage comme mise en relation qui consiste à démettre en provoquant la disjonction induit le moment de la mise en crise de l'autorité de l'auteur (les citations, en tant qu'elles sont pour lui « désautorisées », se trouvent de fait provisoirement « désidentifiées »). On rappellera opportunément ici que ce dernier a historiquement participé à la consécration de la « politique des auteurs » en la trahissant des années plus tard par le privilège accordé aux œuvres plutôt qu'aux auteurs. De son côté, l'autorité traditionnelle et incontestée du critique analysant la manie citationnelle du geste cinématographique godardien consiste à ne jamais s'extraire de la pratique consistant précisément à indexer l'autorisation sur l'identification (des références et des auteurs). L'identité, l'artiste monteur et dialecticien la divise quand son lecteur critique identifie la stratégie compliquée de celui qui joue la carte de la « désautorisation » pour mieux refonder sa propre autorité. Le premier désire esthétiquement et politiquement la désidentification, le second veut seulement identifier les ressorts cachés d'une autorité faussement contradictoire et pleine de perversité. Le premier serait plutôt anarchiste, le second plutôt policier.
2) Confondre :
amalgamer, juger ou les deux à la fois ?
Citer le passé, c'est citer à comparaître dans un procès qui est celui de l'histoire elle-même, les passés cités ne valant qu'à « porter plainte contre les états présents de l'injustice » (p. 33). Mais, là encore, la logique autre – autrement dit la contradiction non assumée parce qu'elle serait impossible à l'être comme telle – divise la citation (à comparaître) entre deux positions inconciliables, une position constative (« sa façon de dire vois là », p. 37) et une position impérative et prescriptive, impérieusement performative (« voilà », idem). On se souvient pourtant que la lecture déconstructrice des travaux de John Austin par Jacques Derrida invitait à se défaire des partages catégoriques et hermétiques entre les domaines de la constativité et de la performativité, tous les énoncés étant potentiellement ou virtuellement performatifs. Pour Georges Didi-Huberman, l'artiste du discours paralogique est «susceptible d'effets violemment contradictoires » (p. 45). Celle-ci autoriserait même une forme de duplicité, la « réautorisation » de l'artiste qui dit, démontre et prescrit (« voilà ») étant alors paradoxalement ou perversement déduite de la « désautorisation » du constat (« vois, là »). Cette duplicité se traduirait encore comme suit : d'un côté, les « points de suspension » du poème invitant à la réflexion de l'autre, de l'autre le « point final » (p. 45) de la formule que GDH identifie dans le fameux carton final de Film socialisme (2010) et qui n'appellerait selon lui aucun dialogue, invitant seulement à rompre avec tout dialogisme. Il y aurait pourtant beaucoup à dire du caractère ouvert car polysémique dudit carton, délégitimant le commentaire (mais au sens de la légende journalistique ou de la phraséologie médiatique – No Comment est aussi le nom d'un programme court et censément sans commentaire de CNN), extrayant du commentaire noté en anglais la question du comment revenant du temps grenoblois de Comment ça va (1978). Passer dessus ou à côté de ce point n'empêchera pas GDH de savoir que « le montage est une pratique, une technique, un grand art de la dialectique » (p. 50). Et, s'appuyant sur le fameux texte de Mao Tsé-Toung intitulé « De la contradiction » (1937) agité comme fétiche à l'époque du Groupe Dziga-Vertov, ce dernier rappelle que chaque situation noue avec son contraire « des relations d'interdépendance qui sont des relations de contradiction » (p. 51). Mais, là encore, il s'agit du côté du montage godardien de distinguer entre « une pratique vouée aux synthèses » (p. 52), fermée car axiomatique, et « une pratique vouée aux symptômes » (idem), ouverte car poétique. JLG balance entre ces deux rives, la première toujours déjà trahie par la seconde (car balancer c'est trahir et la trahison est un grand motif godardien). Mais la raison d'une perspective prétendument paralogique (parce qu'au fond elle ne serait pas authentiquement dialectique ou ne le serait mais qu'incomplètement), en jouant de tous les tableaux, est censé alors produire « maints effets de profusion, voire de confusion » (p. 53). Les paralogismes mènent donc tout droit vers un confusionnisme joyeux mais obscur (« J'aime bien confondre les choses » a dit une fois JLG cité par GDH) qui, voulant jouer et gagner sur tous les tableaux, « juge par confrontations réglées » comme il « joue par amalgames hasardeux » (p. 54). Confondre, c'est juger et discriminer, c'est aussi jouer et amalgamer : « de deux choses l'une » pour GDH qui veut choisir car il veut identifier quand JLG ne choirait pas en embrassant de fait les inconciliables, « de l'une deux choses », divisant pour mieux désidentifier. Le faux dialecticien qui est un vrai paralogicien cherchera alors autant à s'investir dans un « lyrisme ouvert » (p. 81) consistant à faire exploser de manière centrifuge les façons habituelles de considérer un document historique qu'à investir un « lyrisme fermé » (idem) ramenant de façon centripète toutes les souffrances du monde au sujet démiurge ou visionnaire qui s'en veut le grand organisateur proto-hégélien. Les montages ouverts de JLG, GDH s'en est pourtant largement inspiré afin de s'opposer non pas comme il dit aux contempteurs du premier mais à ses propres critiques, ceux qui dénigraient son travail à l'époque de l'exposition Mémoire des camps. Photographies de camps de concentration (éd. Malaval, 2001), ainsi que le prouve exemplairement toute la seconde partie polémique de son ouvrage majeur intitulé Images malgré tout (éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 2003). Il y a encore dix ans, le montage godardien offrait l'occasion de respecter, montrer et penser les différences. Est venu dorénavant le temps de s'en prendre aux montages fermés de certains moments de l'œuvre godardienne, GDH mobilisant symptomatiquement l'historien François Furet qui aura critiqué JLG après avoir vu ses Histoire(s) du cinéma (1988-1998) en raison du fait que ses images auraient été insuffisamment critiques par rapport aux illusions du siècle. Mais l'auteur du Passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXème siècle (éd. Calmann-Lévy, 1995) est aussi celui qui aura confondu dans ce livre-ci histoire du communisme et idéologie anticommuniste en raison d'un reniement qui vaut pour ralliement assumé à l'axiome néolibéral : il n'y a pas d'alternative, de deux choses l'une en somme, le capitalisme ultimement préféré contre le communisme. Comment peut-on alors citer l'intellectuel des ultimes amalgames (communisme = bolchevisme = stalinisme = totalitarisme / capitalisme = démocratie = fin de l'histoire) afin de confondre l'artiste qui opère justement par montages et images dialectiques afin de rendre justice aux différences que l'histoire écrite par les vainqueurs contre le souvenir des vaincus confond ou amalgame ?
3) Divisions dans le droit de citer,
inégalités dans le droit de cité
Mais le point de capiton qui est un point crucial de crispation se trouve ailleurs pour GDH. Il est temps après Bernard-Henri Lévy que ce dernier rouvre le dossier de l'antisémitisme supposé de JLG notamment en raison de ses prises de position pro-palestiniennes. Comment s'effectue donc cet énième retour sur la question juive chez JLG ? Relisant un dialogue entre le cinéaste et Marcel Ophuls, GDH en conclut que « Godard tend à confondre les choses pour mieux, dirai-je, s'autoriser à diviser les partis pris » (p. 91). Là où l'un voit à l'œuvre la confusion (en l'occurrence entre les termes juif et israélien), l'on verrait plutôt chez l'autre la puissance même de la dialectisation des termes effectivement confondus par une certain doxa, juif divisant israélien, israélien divisant juif, juif divisant arabe et réciproquement. Mais ce qui divise est aussi ce qui pour lui unifie : Israéliens et Palestiniens sont des semblables, interdépendants depuis ce qui caractérise leurs contradictions. Pour JLG, la différence, loin d'être négligée, est haussée au niveau d'une division active ayant valeur de désidentification de ce que l'État israélien voudrait justement unifier jusqu'à les confondre (hébreu, juif et israélien) pour des raisons nationales et internationales de politique identitaire en exclusion de l'autre (l'Arabe, le Palestinien) qui est le même (car, malgré tout, tous sont sémites). Si GDH précise que sa perspective critique n'est pas identique à celle d'Alain Fleischer posant pour sa part la stricte équivalence godardienne entre antisionisme et antisémitisme (p. 95), le nom juif demeure un symptôme insistant qui se sera imposé avec la célèbre séquence polémique de Ici et ailleurs (1974) où l'on voit par un effet d'incrustation et de fenêtre vidéo Adolf Hitler et Golda Meir partager le même cadre. Ce que GDH, citant à son appui un ami de JLG, Daniel Cohn-Bendit, sans contredire l'enchaînement des termes de son raisonnement, envisage déjà comme une comparaison au terme de laquelle « les Israéliens font avec les Palestiniens ce que les nazis avaient fait avec les juifs » (p. 97). C'est alors que GDH cède sur ses propres principes analytiques, forçant le trait de la contradiction chez l'autre au point de se contredire brutalement lui-même. Comparaison n'est pas raisonnable quand il s'agit de l'incomparable dirait la doxa, c'est pourtant ce que préconise la science historique quand elle s'incarne avec Marcel Detienne. Déjà, l'interrogation des procédures préférées aux opinions de JLG (pp. 98 et 100) contredit plusieurs pages précédentes consacrées de façon répétée, sinon forcenée, aux secondes plutôt qu'aux premières (pp. 90-93). Aussi, la critique de la séquence godardienne immuable selon laquelle « parler des camps nazis, c'est toujours finir par évoquer ou invoquer le conflit israélo-palestinien » (p. 100) pose quand même le problème du déni de la surdétermination historique du génocide juif dans la création de l'État d'Israël. Ce déni s'en doublera rapidement d'un autre quand, dans le rapprochement judicieux du « droit de citer » avec le « droit de cité » (p. 101), GDH cite côte à côte « le droit des juifs à s'établir en Palestine » et « le droit des Palestiniens à ne pas subir l'expropriation, l'humiliation et l'injustice » (idem), oubliant de caractériser la politique qui détermine l'existence des torts mentionnés, à savoir le colonialisme. Le droit de citer devient alors le droit de diviser un droit de cité qui, dans ses pratiques particulières, est inégalement appliqué, le droit d'établissement des uns induisant en ce cas celui d'opprimer par un régime colonial les autres. Du coup, il faudrait aussi poser que le droit légitime à s'établir en Palestine ne soit ni automatiquement ni nécessairement identique à celui des uns de coloniser le territoire occupé par d'autres. Le déni invite alors à ne pas voir que le droit des uns rompt avec le droit international et que la division entre les droits de cité autorise aussi l'utopie de fabriquer un état commun habitable par deux peuples dès lors émancipés des identités fermées et des clôtures étatiques-nationales. La disparition des Juifs pour GDH, JLG en soutiendrait même l'horrible idée. Mais symboliquement seulement (on soufflerait presque), à proprement parler sur le plan citationnel : « On s'aperçoit alors que le juif comme citation, chez Godard, a pour destin d'être cité... à disparaître » (p. 102). On s'étonnera durablement d'une affirmation aussi osée, les penseurs et artistes juifs étant abondamment cités dans les films du cinéaste quand, par ailleurs, il sait faire des distinctions (la journaliste de Notre musique en 2004 est clairement israélienne). Distinctions que lui refuse GDH, misant par un inattendu effet de balancier sur une sur-identification entre juif et israélien alors – faut-il le rappeler ici – qu'il existe aussi des Arabes israéliens. Là où JLG fait s'entre-diviser les étiquettes identitaires, notamment en raison de sa critique radicale des identifications étatiques, elles semblent demeurer pour GDH indiscutables, parce qu'indiscutées.
4) / plutôt que =
Cité à comparaître devant le tribunal érigé par GDH, JLG comparaît au fond comme étant celui dont les perpétuels amalgames inviteraient forcément à confondre antisionisme et antisémitisme chez celui qui s'est pourtant et à plusieurs reprises décrit comme un « Juif du cinéma ». GDH va dans ce sens plus loin encore quand il écrit ceci : « Naïvement et bizarrement à la fois – selon la petite musique perverse dont parle bien Alain Fleischer –, Godard a pensé que le plus beau cadeau à faire aux Palestiniens, c'était de leur offrir la Shoah et de priver leurs ennemis, par conséquent – mais contre toute évidence historique –, de cette mémoire-là. Ainsi va la possible perversité des passés cités » (p. 103). Outre le fait que GDH accorde à Alain Fleischer ce qu'il lui retirait préalablement, retenant après s'y être préalablement opposé la « petite musique perverse » des confusions entre antisionisme et antisémitisme, on cherchera en vain dans toute l'œuvre de JLG la moindre supposition d'un « cadeau » (la métaphore est en ce contexte a minima maladroite et inappropriée) en lequel consisterait le judéocide censément offert aux uns (les Palestiniens) contre les autres (les Israéliens) alors que la destruction des Juifs d'Europe s'impose universellement à tous. Et les Palestiniens ne font pas exception à cette imposition historique. Le problème étant que pour l'artiste de l'universel auquel a décidé de s'adresser désormais GDH en le vouvoyant sur un mode bien peu fraternel, le montage prescrirait « des signes d'égalité » qui serviraient la promotion de formules ou la défense de pseudo-théorèmes « d'hostilité » (idem). On doit pour la énième fois rappeler, après tant de rappels faits par d'autres, que les termes cités pour être montés ne sont chez JLG jamais sous la condition de l'équivalence mais sous celle des rapports de production et de confrontation qui sont faits d'opposition et d'interdépendance, de ressemblance et de dissemblance, d'association et de disjonction. / plutôt que =. On pourrait décrire le mouvement moins paralogique que dialectique du montage godardien en suivant de manière lacanienne la fameuse triade hégélienne : après un premier moment dévolu au rapprochement imaginaire des termes hétérogènes montés, un deuxième moment est celui du réel de leur différence radicale auquel succède un troisième moment caractérisé par la symbolisation des termes associés depuis leur manque respectif (la fiction pour le documentaire et réciproquement, par exemple). Alors que, dans la fameuse séquence moins décrite que décriée par GDH, ce dernier, au risque de la sur-interprétation symptomatique qui impose ici les apories de la mésinterprétation, fait remarquer que « Golda Meir est donc vue comme cela même que Hitler attendait, espérait » (p. 105), ratant tous les enjeux d'une division non pas en deux mais en plusieurs. Ce sont ainsi Lénine divisé en Hitler d'un côté et en Front Populaire de l'autre (les staliniens s'il en reste ont-ils hurlé au sacrilège ?), Hitler divisé en camps d'extermination d'un côté et en création de l'État d'Israël de l'autre : autrement dit, tous les personnages historiques sont des figures réellement opposables d'un pouvoir d'État symboliquement unifiable sous les aspects imaginaires de chaînes multiples de trahison, de division et d'oppression concrètes. Moyennant quoi, GDH considère pourtant que les « divisions extrinsèques » sont identifiables ici à des « divisions intrinsèques » en raison d'une radicalité se tenant « dans l'entre-deux d'une hésitation, d'une ambivalence possibles » (p. 116). Autrement dit, critiquer le sionisme, ce serait continuer la critique du nazisme par d'autres moyens historiques. L'art du montage et la dialectique de la division chez JLG, GDH les comprend donc comme une ambivalence, voire une duplicité, presque une fourberie (et s'il avait pu inclure Adieu au langage en 2014 qui comprend pourtant un refus du commandement notamment exprimé dans le champ amoureux, il aurait probablement insisté, 3-D oblige, sur son côté torve ou louche). Au lieu de viser une dynamique faite de « plurivocités » (p. 133), la division en deux imposerait un principe d'équivocité, pire d'univocité quand la séquence de Ici et ailleurs propose justement la pluralité des figures du pouvoir d'État qui sont des figures de trahison politiques des aspirations populaires dès lors qu'elles s'inscrivent dans une chaîne de production particulière : la configuration étatique, celle qui mène diversement (et cette diversité pratique induit une hétérogénéité radicale) au programme politique du communisme de guerre léniniste, au programme social-démocrate du Front Populaire, au programme d'extermination nazi, au programme de colonisation des territoires palestiniens par l'État d'Israël. La perspective défendue par GDH est caractérisée par son univocité, soustrayant les montages godardiens de ses effets disjonctifs en termes de plurivocité ou, au pire, d'équivocité. Pourtant, l'un qualifie l'autre d'« autorité équivoque » s'autorisant, en conséquence de ses amalgames et confusions, des abus (p. 150) qui auraient bel et bien à voir avec le soupçon concernant la « petite musique perverse » de l'antisionisme en ce qu'il serait donc chez lui identique à de l'antisémitisme.
5) Qui divise seulement en deux ?
Le coup des « deux frères antipodes »
Les lignes de Passés cités par JLG qui suivent, consacrées au caractère romantique du génie cinématographique godardien, sont autrement plus inspirées. Car elles sont autrement moins tributaires d'arrière-pensées politiques vouant au hors-champ le droit légitime à critiquer l'État d'Israël du point de vue dialectique, celui d'une histoire des victimes sur laquelle sa légitimité prend appui (la Shoah) qui se double de l'histoire d'une trahison de la tradition des opprimés (puisque cette mémoire n'aura pas empêché de perpétrer un tort, non-identique et singulier par rapport à celui qui précède, à l'égard du peuple palestinien). « Art de la césure », « pure parole », « suspension antirythmique », « rythme divisé » : tous les énoncés que GDH aura notamment puisés chez Hölderlin afin de qualifier l'esthétique godardienne sont particulièrement justifiées (p. 157), celle-ci étant vraisemblablement héritière de la « puissance du négatif » hégélienne (p. 165). Mais c'est aussi « le poème du poème » de Schlegel (p. 166) avec ses « fragments pour l'avenir » (p. 169). Mais ce sont encore, en héritage des œuvres de Schelling et Novalis, la prévalence de l'imagination sur les autres facultés, la fragmentation et la contradiction en support à une technique de montage dès lors « capable de réunir les situations les plus extrêmes, les images les plus antithétiques ou les pensées les plus incommensurables » (p. 167), le Witz (le mot d'esprit comme saillie significative d'une génialité fragmentaire comme d'une « bouffonnerie transcendantale ») et la théorisation immédiate des formes artistiques sous la forme de l'essai. L'art poétique est donc celui du montage des fragments les plus « antipodes » comme l'aurait encore dit Schlegel (pp. 168-171), philosophe pour qui la « trouvaille spirituelle » agissait avec sa fonction de « désintégration » des flux ou chaînes d'images habituelles (p. 169). Schlegel n'est-il pas celui qui posa également l'impératif suivant, quasi-postulat godardien : « Unissez les extrêmes, et vous aurez ainsi le vrai milieu » (p. 170) ? Pourtant, fait remarquer GDH, les « fusées oraculaires » dont JLG a été capable (p. 173) ne crèvent le plafond qu'en raison d'un moi dont l'auteur ne se départirait jamais, incapable du moindre « hors-je » (p. 174), impuissant à disparaître derrière les effets de signature caractérisant sa propre génialité. Quand bien même le groupe Dziga-Vertov aura représenté un premier moment collectif et anonyme entre 1968 et 1972. Quand bien même ses films ne sont quasiment plus signés à partir des années 1980. Quand bien même JLG n'aura eu de cesse de citer Pascal (« le moi est haïssable »), Virginia Woolf (« Dire je est le meilleur moyen que l'on a trouvé pour ne pas parler de soi ») et Léon Brunschvicg (« L'un est dans l'autre, l'autre est dans l'un et ce sont les trois personnes »). C'est que l'amateur de tennis qu'a été JLG ne voudrait diviser qu'en deux (l'un des nerfs de l'argumentation de GDH, formalisé en p. 98) au point où la plurivocité se perd en équivocité redevable des univocités des divisions extrinsèques qui cachent en fait des divisions intrinsèques. Et c'est ce sur quoi cède précisément GDH quand il s'efforcera pendant les vingt dernières pages de son ouvrage à opposer Pier Paolo Pasolini (appelons-le ici PPP) à JLG, « deux frères antipodes » (p. 179). Alors, il divisera en deux afin de critiquer l'artiste qui est censé diviser en deux et non en plusieurs et, ce faisant, il n'aura de cesse de se contredire lui-même. D'autant plus que l'usage fait par GDH de PPP est instrumental et réducteur : renversant un JLG ayant la tête en bas afin de le remettre sur ses pieds, PPP personnifie idéalement ce que l'autre incarne mais de manière ratée. Ainsi, « l'honnêteté coutumière » (p. 182) de l'un s'oppose diamétralement à l'hostilité de l'autre à son égard (qui irait jusqu'à ne jamais citer l'auteur de La Rabbia en 1963, l'auteur l'étant pourtant plusieurs fois dans Histoire(s) du cinéma, son film l'étant encore dans un passage important de L'Origine du XXIème siècle en 2000). Ainsi, le cinéaste des jeux de langages et d'images comme autant d'actes de tautologie (« ce cinéma, c'est le cinéma ») qui sont des actes de métalangage (« ce cinéma, c'est le cinéma du cinéma ») trahirait le langage des opprimés en les faisant parler « comme Hegel » comme il déconstruirait le passé parce que celui-ci serait conformiste (p. 186-188). Mais il aurait fallu discuter les contradictions du populisme en général et chez PPP en particulier, en posant dans la foulée que JLG n'a jamais été, y compris dans sa courte période marxiste-léniniste-maoïste, un artiste à vocation populiste. Mais il aurait fallu également discuter, contre le populisme pasolinien ou celui derrière lequel s'abritait le réalisateur maoïste et militant qu'était alors Marin Karmitz, de la position godardienne selon laquelle les opprimés parlent le langage aliéné que les oppresseurs ont mis dans leur bouche, quand ils ne la trouvent pas cousue sur les chaînes de montage capitalistes. Mais il aurait fallu seulement rappeler le souvenir du Mépris, éloge du classicisme enfui avec la modernité, pour vérifier la fausseté de l'assertion selon laquelle, pour JLG, le passé mérite d'être déconstruit, sinon d'être d'être détruit puisqu'il est conformiste. A la différence de PPP qui, dans ses saillies critiques à l'encontre de l'esthétique godardienne, souhaite malgré tout ne pas « faire de moralisme », GDH ne s'en sera pas privé, notamment quand il regrette qu'il « n'y a pas de corps pauvres » dans les films de JLG (p. 192). Mais y en a-t-il jamais eu chez Marcel Proust ? Et leur absence discréditerait-elle leur œuvre respective ? Ce qui est sûr, c'est que GDH n'aura rien vu, ni les immigrés de Week-end (1967), ni les Palestiniens de Ici et ailleurs (1974), ni le fou de Six fois deux : sur et sous la communication (1976), ni les clochards de Éloge de l'amour (2001), ni les Bosniaques survivants de Notre musique.
6) La belle âme
Et puis, le lecteur critique qui veut substituer à l'art dialecticien du cinéaste le confusionnisme du discours paralogique arrive jusqu'à buter la contradiction ultime, indépassable. Contradiction intenable quand, en effet, GDH croit ramasser les errements godardiens face à la fermeté des principes pasoliniens en les plaçant sous la condition définitive d'une négation dite « explétive » (p. 196). Autrement dit une « négation non conclue ni conclusive » (p. 197) qui caractérise une position flottante signalant une « discordance de l'énonciation à l'énoncé » (p. 198). Comment l'artiste à l'autorité équivoque car autoritaire, qui divise tout seulement en deux afin d'être univoque dans ses objets de division, pourrait-il alors être celui qui « nie beaucoup sans nier tout à fait » (idem) ? L'artiste du déni ou du désaveu devient alors la figure par la médiation de laquelle le lecteur philosophe disant vouloir en analyser les procédures plutôt que les opinions se désavouerait lui-même, déposant les armes après les avoir sorties et affûtées. Le « double tranchant » (p. 55) aura blessé celui qui espérait peut-être une lutte « à couteaux tirés » (p. 87) et le vouvoiement n'aura servi que le fantasme d'un faux dialogue qui se veut une vraie condamnation. On y repense alors, quand GDH évoquait à un moment la « belle âme » conceptualisée par Hegel, ne parlait-il pas de façon inavouable de lui-même plutôt que de cet autre à qui il s'adresse désespérément et qui ne lui a toujours pas répondu ? Relisons la citation, elle est en effet parfaitement éloquente : « Dans la majesté de son élévation au-dessus de la loi déterminée [historique ou juridique] et de tout contenu du devoir [éthique], [la belle âme] met un contenu arbitraire dans son savoir et son vouloir ; elle est la génialité morale qui sait que la voix intérieure de son savoir immédiat est voix divine (...) Se contempler soi-même est son être-là objectif, et cet élément objectif consiste dans l'expression de son savoir et de son vouloir comme d'un universel » (p. 130).
La citation est éloquente, mais insuffisante. Citons cette phrase de JLG que ne cite jamais GDH, et pour cause : « Ce qu’on appelle l'autre, c'est le même, comme dans le cas des Hutus et des Tutsis, et c'est pour ça qu'ils se tapent dessus. Ce sont les mêmes et ils se détestent. Les trois quarts des gens, vous et moi, on se déteste. Si on n'a pas fait d’analyse, on ne sait pas que ce qu'on n’aime pas chez l'autre, c'est soi. Par rapport à ça, Lacan faisait parfois de vrais champs contre-champs. Il était assez cinéaste » a effectivement dit un jour JLG dans un entretien donné aux Inrockuptibles et intitulé « C'est notre musique, c'est notre ADN, c'est nous ». A cette aune, et contrairement à Jacques Lacan, on regrettera donc que GDH, dans sa vaine préoccupation d'une autre musique (celle de torts à redresser préférée à la musique des champs-contrechamps montés à égalité), ne l'ait pas été assez.
Le 3 novembre 2015
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
Écrire commentaire