Des nouvelles du front cinématographique (37) : Vénus noire d'Abdellatif Kechiche
La Matrice de la race (II)
« (…) et puisque ces choses-là ont été faites, elles peuvent, à condition qu’on sache comment elles ont été faites, être défaites » (Michel Foucault, « Structuralisme et poststructuralisme » in Dits et écrits II. 1976-1988, éd. Gallimard – coll. Quarto, 2001, p. 1268).
« Je ne veux pas être celui que vous voulez que je sois »
(Cassius Clay alias Mohammed Ali)
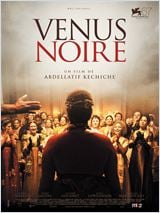
En l'espace de quatre longs métrages, Abdellatif Kechiche (né le 07 décembre 1960 à Tunis) s'est aujourd'hui imposé définitivement comme l'un des tout meilleurs cinéastes français de sa génération. Arrivé à l'âge de six ans avec ses parents ayant migré à Nice, ayant ensuite suivi des cours dramatiques au conservatoire d'Antibes, puis joué quelques rôles au cinéma (entre autres Le Thé à la menthe d'Abdelkrim Balloul en 1984, Les Innocents d'André Téchiné en 1987, Bezness de Nouri Bouzid en 1991 pour lequel il reçut le Prix d'interprétation masculine au Festival international du film francophone de Namur), Abdellatif Kechiche décide de se lancer dans l'aventure de la réalisation cinématographique. Bien lui en a pris. Que l'on en juge : La Faute à Voltaire (2000) qui reçut lors de la présentation au Festival de Venise le Prix Luigi-de-Laurentis de la meilleure première oeuvre ainsi que le Prix de la jeunesse, mais aussi le Prix spécial du jury et le Prix Jean-Carmet pour l'ensemble des acteurs au festival Premiers Plans d'Angers, le Prix spécial du jury et le Prix du jeune jury au Festival de Namur, et le Prix de la meilleure actrice pour Elodie Bouchez au Festival du film méditerranéen de Cologne ; L'Esquive (2003) auquel ont été attribuées quatre récompenses lors de la cérémonie des César (meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, et meilleur espoir féminin pour Sarah Forestier), ainsi que le Prix Lumière du meilleur scénario ; La Graine et le mulet (2007) qui reçut une moisson de prix encore supérieure (à nouveau les quatre mêmes César – c'est l'actrice Hafsia Herzi qui reçut le Prix du meilleur espoir féminin, à nouveau le Prix Lumière du meilleur scénario, mais également le Prix Louis-Delluc et l'Etoile d'or de la presse au titre du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original, enfin le Prix spécial du jury et le Prix FIPRESCI à la 64ème Mostra de Venise – et Hafsia Herzi y reçut également le Prix Marcello-Mastroianni de la meilleure actrice). Quant à la revue Les Cahiers du cinéma, elle considère La Graine et le mulet comme le meilleur film français de la décennie 2000 et le sixième meilleur film de la même décennie, toutes provenances confondues. Enfin, les 477.000 spectateurs de L'Esquive et les 830.000 spectateurs de La Graine et le mulet expriment en dernière instance la remarquable (parce que rarissime) situation d'un cinéaste qui, sans rien céder sur ses exigences d'auteur (scripts originaux, acteurs souvent non-professionnels, durée des métrages non-standards), a jusque-là obtenu systématiquement les faveurs de la critique, des « professionnels de la profession » (Jean-Luc Godard), comme du public. On peut se féliciter d'un tel consensus, surtout qu'il bénéficie à un cinéaste qui a su inventer une manière esthétique singulière (avec notamment ce principe fort de la durée comme puissance de trouble dans la représentation par l'indistinction entre le documentaire et la fiction) dont la force politique est indéniable (la durée comme épreuve pour les migrants ou leurs descendants racisés qui souffrent de vivre dans le présent de la survie). Fort de tels succès, Abdellatif Kechiche pouvait enfin s'attaquer à un récit inscrit dans une perspective historique nécessitant une économie de production plus ample qu'à l'accoutumée : Vénus noire, ce nouveau long métrage qui relate les dernières années de Saartjie Baartman qui fut exhibée sous le nom de la « Vénus hottentote » dans les foires et les salons mondains de Londres et de Paris où elle décéda le 29 décembre 1815.
Vénus noire a été montré en compétition officielle de la dernière Mostra de Venise. Le dissensus s'est substitué au consensus habituel, et cela n'est peut-être pas plus mal. Même si le nouveau long métrage d'Abdellatif Kechiche est largement soutenu par la presse la plus militante du point de vue de la politique des auteurs (Le Monde, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, Libération, et Les Inrockuptibles considèrent le film comme un indiscutable chef-d’œuvre, pendant que Charlie-Hebdo, les Cahiers du cinéma, L'Humanité, Marianne, Ouest-France, Première, La Croix et Le Journal du dimanche défendent avec des nuances l'importance d'un film qui par ailleurs divise profondément la rédaction de Télérama), le film aura reçu un accueil plutôt mitigé à Venise. Au lieu de capitaliser sur la reconnaissance et la sympathie accumulées lors de la réception des trois premiers longs métrages, le cinéaste a décidé plus courageusement de mettre en oeuvre son entreprise cinématographique la plus audacieuse et la plus risquée, car la plus radicale. Le risque, c'est d'abord comme on l'a dit une économie de production plus fastueuse, et que nécessite un récit inscrit dans une séquence historique passée. Abdellatif Kechiche a donc décidé de tourner le dos au temps présent ainsi qu'à une localisation nationale particulièrement ramassée (les quartiers populaires parisiens de La Faute à Voltaire, la cité de Franc Moisin à Saint-Denis dans le 93 pour L'Esquive, le port de Sète dans La Graine et le mulet) pour une fiction qui, adossée à la vérité historique qui en détermine le déroulement, se déploie de part et d'autre de la Manche (Londres d'un côté et Paris de l'autre), et qui s'étend de 1810 à 1815. On a parlé de fresque historique : c'est totalement faux. Le risque de surenchère décorative et d'académisme dans la reconstitution historique est formellement contourné, s'il n'est pas tout simplement neutralisé, par la radicalisation de deux principes esthétiques, à la fois spécifiques et interdépendants comme on s'en apercevra, déjà à l'oeuvre dans les précédents films du cinéaste, mais qui n'avaient jamais atteint ce point paroxystique d'extension critique. Qu'il s'agisse de la question de la durée (et Vénus noire dure 159 minutes, quand La Faute à voltaire durait 130 minutes, L'Esquive 117 minutes, et La Graine et le mulet 151 minutes) ou du régime narratif privilégié (la répétition sur le mode accumulatif d'une même séquence fondatrice – l'exhibition spectaculaire de Saartjie Baartman – bien au-delà des quelques blocs de durée filmiques étirés ponctuant, ouvrant ou fermant les trois précédents films du cinéaste), Vénus noire atteste d'un désir manifeste de radicalisation esthétique à la hauteur des enjeux politiques relatifs aux problèmes que soulève l'histoire de la « Vénus hottentote ». Le critique Eugenio Renzi a bien raison de signaler que le quatrième long métrage d'Abdellatif Kechiche consiste en l'extériorisation ou l'explicitation théorique de tout son cinéma (cf. rue89.com du 11.09.2010). C'est pourquoi ce film, le plus passionnant de son auteur, est aussi son plus retors et son plus difficile, pour ne pas dire malaisant. Loin de vouloir, comme avec L'Esquive et La Graine et le mulet, rédimer la violence fondamentalement nécessaire et légitime d'une pareil geste esthétique au profit d'une empathie toujours plus nourrie pour les personnages principaux, Vénus noire empoigne frontalement son objet en posant la question de son archéologie, comme de l'actualité des degrés de regard et des niveaux de discours qui, conjugués, ont exercé leur pouvoir pour assujettir et opprimer un être humain.
1/ Le temps naturaliste : ce qui, avec la durée, se défait

D'abord la durée. On a souvent, et à raison, comparé la manière esthétique d'Abdellatif Kechiche à celles d'augustes devanciers, essentiellement John Cassavetes, Maurice Pialat, voire Jacques Doillon ou les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne. Il est vrai que tous ces cinéastes partagent un goût semblable pour la durée comme possibilité d'atteindre, notamment lors du tournage, les marges du régime représentatif dominant, dans les zones de turbulence où la fiction et le jeu des acteurs (non)professionnels et le documentaire et la réelle présence des corps et des subjectivités entrent dans la région de l'indiscernable et de l'opaque. On pourra d'emblée comparer Vénus noire à La Gueule ouverte (1974) de Maurice Pialat : en effet, dans les deux films, il s'agit de montrer l'agonie d'une femme, et même plus radicalement, il s'agit d'indexer la longueur des séquences (des plans-séquences chez Maurice Pialat, quand Abdellatif Kechiche préfère un découpage particulièrement morcelé) sur l'expérimentation phénoménologique des spectateurs éprouvant dans leur chair le réel de l'agonie mise en scène. C'est en cela que Maurice Pialat et Abdellatif Kechiche sont des cinéastes naturalistes, et qu'ils sont tous les deux les grands héritiers de Jean Renoir lorsqu'il réalise en 1926 une adaptation de Nana d'après le roman éponyme écrit en 1880 par Emile Zola. Influencé par Erich von Stroheim, Jean Renoir met au point un long métrage d'une durée hors-normes de 150 minutes qui expose une femme (incarnée par l'épouse du cinéaste, Catherine Hessling) issue du monde populaire (elle est la fille de Gervaise et de Coupeau dont l'histoire nous est contée dans L'Assommoir), habituée des petites passes et des représentations sur les tréteaux des théâtres parisiens (elle a notamment joué les vénus sur scène), entretenue et célébrée par le tout-Paris, avant de mourir de la petite vérole dans de terribles souffrances. La durée du film, l'époque (le 19ème siècle), ainsi que les motifs du spectacle, de la prostitution, de la maladie vénérienne et bien sûr de la figure de Vénus sont également présents dans le film d'Abdellatif Kechiche. Surtout, c'est une esthétique commune – le naturalisme – qui rassemble par-delà les distinctions et les spécificités Erich von Stroheim et Jean Renoir (on aurait pu également citer le dernier film de Max Ophuls, Lola Montès en 1955, paradigme cinématographique de la femme captive d'un dispositif spectaculaire), Maurice Pialat (dont le Van Gogh en 1991 est le film qui se rapproche le plus du modèle renoirien) et aujourd'hui Abdellatif Kechiche. Et cette esthétique repose particulièrement sur une conception originale du temps. « Avec le naturalisme cinématographique, le temps fait une apparition très forte dans l'image cinématographique » explique Gilles Deleuze dans son premier volume consacré à sa philosophie du cinéma (Cinéma 1. L'image-mouvement, éd. Minuit, coll. « Critique », 1983, p. 177). En effet, « le temps naturaliste semble frappé d'une malédiction consubstantielle. De Stroheim, en effet, on peut dire ce que Thibaudet disait déjà de Flaubert : la durée, pour lui, est moins ce qui se fait que ce qui se défait, et se précipite en se défaisant. Elle n'est donc pas séparable d'une entropie, d'une dégradation » (p. 178). Tout est logique dans cette série conceptuelle reliant Flaubert et Zola, Stroheim et Renoir (ce dernier avait également réalisé en 1933 une adaptation de Madame Bovary), Pialat qui a regardé Van Gogh à partir du point d'agonie et d'épuisement de la trajectoire de son personnage éponyme, et donc Kechiche qui réalise avec Vénus noire ce que l'on pourrait dés lors nommer sa version noire de Nana.

159 éprouvantes minutes qui exposent sous différentes formes la même scène archétypale (une femme s'épuise dans une exhibition qui vaut symboliquement comme consommation par des yeux bouffés par la rageuse obscénité de la pulsion scopique), qui épuisent cette scène en la dégraissant toujours plus. Du passage de Saartjie Baartman (Yahima Torres) du bateleur hollandais Caezar (André Jacobs) au forain français Réaux (Olivier Gourmet), le premier vendant au second celle qu'il a achetée au Cap-oriental (l'actuelle Afrique du sud), des parades monstrueuses de Londres entre 1810 et 1814 aux réceptions privées de Paris, des tréteaux populaires de Piccadilly aux salons mondains et partouzards parisiens, du ridicule bricolé d'un exotisme fallacieux aux humiliations sexuelles qui finissent dans les bordels et la prostitution de rue, avant la mort par pneumonie des suites d'une maladie vénérienne en 1815, et le charcutage du cadavre par les scientifiques du muséum d'histoire naturelle sous la houlette de Georges Cuvier (François Marthouret), c'est une même logique de la réitération et de la répétition qui induisent par accumulation une dynamique de la dégradation et de l'entropie : de l'épuisement. Et le spectateur, bien davantage que lors de la projection de La Graine et le mulet, ressort essoré, véritablement exténué de l'expérience proposée par la projection de Vénus noire. C'est par le truchement de la durée des séquences, et de leur répétition accumulative que le cinéaste peut brillamment éviter les pièges décoratifs de la reconstitution historique, ici rabattue dans les lieux clos des théâtres, des salons, des bordels, des chambres et du muséum. Pas de dehors (ou presque) ici : seule règne la domination claustrophobe du dedans de l'oppression, quelles que soient ses déclinaisons sociales et formelles (savantes et populaires, prolétaires et bourgeoises). A côté du caractère entropique du temps naturaliste, se trouve aussi la question du morcellement. On a évoqué précédemment l'usage manifeste du sur-découpage des séquences chez Abdellatif Kechiche qui ainsi joue à fond la carte du morcellement et de la parcellisation. La multiplication des plans et des points de vue afférents induit la sur-affirmation du principe esthétique de la (dé)coupe dont l'ultime forme d'actualisation sera accomplie lors de la séance d'autopsie (ou de nécropsie) du cadavre de l'héroïne. Mais ce principe de la (dé)coupe se trouve relayé par un régime filmique de succession frénétique de gros plans de visages riant à pleines dents des spectacles présentés et appartenant à des personnages souvent montrés en train de boire et surtout s'empiffrer (notamment de morceaux de viandes). « Le second aspect [du naturalisme, après la question du temps], c'est l'objet de la pulsion, c'est-à-dire le morceau (…) L'objet de la pulsion, c'est toujours l'objet partiel ou le fétiche, quartier de viande, pièce crue, déchet, culotte de femme, chaussure » (Gilles Deleuze, opus cité, p 180). La consommation scopique de Saartjie Baartman comme sa fétichisation (ce sont par exemple les affiches et les statuettes à son image, témoignages archéologiques d'un merchandisingavant l'heure) relèvent d'une dynamique pulsionnelle qui détermine aussi les activités sexuelles comme de manducation et de digestion : voir en spectacle la « Vénus hottentote » (mais aussi, et significativement, la toucher, lui peloter, lui pétrir les fesses), c'est satisfaire aux pulsions les plus élémentaires et archaïques, c'est jouir d'une consommation qui est une consumation comme l'aurait dit Georges Bataille (et tout le film d'Abdellatif Kechiche est placé sous le signe du feu, notamment avec ces séquences de beuveries et de tavernes grosses de la chaleur dégagée par l'ivresse collective). C'est faire du spectacle un principe symbolique de cuisson auquel est cruellement soumise dans toute sa crudité la chair généreuse d'une femme seulement atteinte d'hypertrophie des fesses (stéatopygie) et des organes génitaux (macronymphie). Il y a donc du cannibalisme dans ce monde de chiens – autrement dit ces êtres humains qui s'avilissent en avilissant l'objet de leurs obscènes plaisirs, et qui du coup ressemblent aux personnages horriblement défaits des peintures de Francisco de Goya (pour la seconde partie française) et surtout (pour la première partie anglaise) de James Ensor. Dans le domaine de l'art cinématographique, il n'y aurait peut-être que chez Ingmar Bergman que l'on trouve pareille débauche de visages ainsi convulsés, retournés, vrillés par un rire démoniaque (et n'a-t-il pas lui aussi mis en scène une femme agonisante dans Le Silence en 1963 et surtout dans Cris et chuchotements en 1972 ?).
2/ Thermodynamique du pouvoir et résistance subjective par la fatigue
La réitération cumulative et épuisante de la même séquence tout aussi fondamentale que fondatrice et la démultiplication des plans de coupe qui rejoue sur le mode perceptif propre aux spectateurs du film l'ivresse des spectateurs de la fiction projetée représentent comme les deux bords d'un même épuisement qui, du coup parce qu'il est partagé, établit moins de manière classiquement empathique que de façon davantage phénoménologique une communauté esthétique entre l'héroïne et les spectateurs. Avait-on d'ailleurs remarqué à quel point la fatigue légitimement ressentie par la « Vénus hottentote » ressemble pour beaucoup à d'autres fatigues mises en scène par le cinéaste : celle du jeune Krimo dans L'Esquive celle également de Slimane Beiji (Habib Boufares) et de Rym (Hafsia Herzi) dans La Graine et le mulet. C'est une véritable pensée de cinéma en termes thermodynamique que celle d'Abdellatif Kechiche, avec sa dialectique de l'énergie en phase d'accroissement extatique et de surchauffe, puis de dégradation entropique et d'épuisement, avant une relance prochaine du cycle. Et la longueur des séquences soutenue par le déploiement des situations (très souvent collectives, et carburant à l'interaction chez ce cinéaste) est puissamment déterminée par le couple énergie/fatigue. La fatigue aurait alors à voir, au-delà de la seule vision thermodynamique consacrant l'énergie du pouvoir à capturer les corps et capter les regards, à cet « infini paradoxe » soulevé par Roland Barthes, ce « processus infini de la fin » qui résiste à tout codage, « inclassée, donc inclassable : sans lieu, sans place, intenable socialement » (in Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978), éd. Seuil/IMEC, coll. « Traces écrites », 2002, p. 41-42). Tous les personnages fatigués du cinéma d'Abdellatif Kechiche, qu'ils soient d'ascendance migratoire et postcoloniale comme dans les trois premiers films du cinéaste, qu'il soit émigré-immigré issu du monde colonial comme dans La Graine et le mulet ou comme dans Vénus noire le produit quasi-direct de l'esclavagisme, et surtout qu'ils soient communément tous racisés, partagent une fatigue qui manifesterait de manière paradoxale et symptomatique à la fois la lourdeur incorporée de torts historiques et sociaux passés, vécus ou hérités, et rendus invisibles dans l'espace public (français) en raison de leur illégitimité ou de leur faible problématisation, comme la résistance passive mais réelle à un ordre (post)colonial qui assujettit au bénéfice des dominants du système raciste les dominé-e-s racisé-e-s. C'est la puissance du neutre qu'exalte la fatigue, et que Roland Barthes retrouve dans les écrits de Maurice Blanchot (par exemple L'Entretien infini, éd. Gallimard, 1969), et que nous analysions dans Nathalie Granger (1972) de Marguerite Duras. C'est cette même force de neutralisation des oppositions binaires, des antinomies de la pensée occidentale, et des arraisonnements au nom de la modernité qui est aussi l'autre nom de la pensée occidentale – le « phallogocentrisme » déconstruit par la philosophie de Jacques Derrida et qui, selon lui, conjugue les motifs symboliques de la viande, de la domination masculine et de la centralité de la présence et de la parole pleine (toutes choses qui déterminent les dispositifs spectaculaires d'exhibition au sein desquels est incorporée l'héroïne).La fatigue comme résistance passive, comme amortissement par le dedans (dans les corps) des injonctions et des catégorisations venues du dehors, et comme étouffement relatif de la violence des pouvoirs en exercice, à laquelle Roland Barthes associe le silence (opus cité, p. 49-58) qui accompagne aussi les personnages d'Abdellatif Kechiche, taiseux comme l'est Saartjie Baartman (mais aussi têtue que l'âne bâté de Au hasard Balthazar de Robert Bresson en 1966), représentent par conséquent deux formes du neutre comme puissances et intensités : résister au travail et aux ordres du discours le prônant. La fatigue de l'héroïne (même si elle est constamment sommée de bouger et danser) et son mutisme (même si elle a tant de choses à dire à ceux qui veulent bien se taire pour l'entendre) s'expliquent parce qu'elle est une ouvrière dont la force de travail exploitée est son corps modelé et mis en mouvement à partir des discours et des représentations humiliantes de l'époque. C'est par conséquent ce partage du sensible (la fatigue du personnage principal et celle éprouvée par les spectateurs) qui, en les rassemblant par-delà l'intempestive disjonction historique des temps (le passé pour Saartjie Baartman et le présent pour nous, son inactualité qui redevient grâce au film du cinéaste notre actualité), permet de neutraliser l'autre risque grave consciemment encouru par Abdellatif Kechiche, et dont il fait également la matière même d'un film particulièrement auto-réflexif : il s'agit du voyeurisme.

Existe-t-il une différence entre le spectateur ayant vécu du temps de la « Vénus hottentote », qui jouissait de l'exhibition qu'alors on lui présentait, et le spectateur contemporain qui assiste à la projection de Vénus noire et qui pourrait profiter de pareille occasion pour satisfaire des pulsions scopiques qui auront été ces deux derniers siècles contradictoirement autant civilisées qu'entretenues ? Il y avait une obligation éthique pour Abdellatif Kechiche de tracer symboliquement la ligne de démarcation séparant les spectateurs de l'époque et les spectateurs contemporains, ceci afin de ne pas rejouer une seconde fois (en 2010) la scène humiliante vécue par Saartjie Baartman (en 1810 et après pendant cinq années). Pour neutraliser l'obscénité potentielle d'un film qui repose sur une accumulation quasi-fellinienne de spectacles obscènes s'enchaînant les uns avec les autres (Gilles Deleuze aurait alors parlé d'image-cristal et de « cristal toujours en formation, en expansion qui fait cristalliser tout ce qu'il touche » – in Cinéma 2. L'image-temps, éd. Minuit, coll. « Critique », 1985, p. 119 – sauf que chez Abdellatif Kechiche il n'y a plus expansion mais épuisement d'une cristallisation effectivement en situation inaugurale d'excroissance), le cinéaste multiplie les gardes-fous. C'est déjà la réitération accumulative – on pourrait presque parler d'exhaustion – particulièrement épuisante qui permet justement d'arracher le spectateur au piège voyeuriste en lui faisant partager l'expérience d'une fatigue éprouvée par une héroïne dont il ressent du coup la dure réalité (et ce d'autant plus que le cinéaste privilégie toujours des tournages longs et des prises de vue nombreuses ayant pour objet d'épuiser également autant ses acteurs que les potentialités d'une séquence). De ce point de vue-là, Vénus noire apparaît comme une excroissance monstrueuse, comme le dépli protubérant et effrayant de la séquence de danse du ventre de la fin de La Graine et le mulet qui montrait avec une force esthétique renversante la souffrance de Rym qui prolongeait celle de Hafsia Herzi (et l'on sait que celle-ci dansait malgré l'épreuve réelle d'une blessure produite lors du tournage). De la même façon, la multiplication dispersive des plans et des points de vue institue une vision tourbillonnaire et déstabilisatrice qui bouscule constamment la perception du spectateur ainsi empêchée de se figer dans la posture voyeuriste. Encore mieux, Abdellatif Kechiche inclut dans l'espace de la scénographie, à l'encontre des conventions représentatives régissant l'imagerie pornographique, les perspectives qui sont habituellement absentes de ce registre de la pulsion scopique qui s'est déplacé ces dernières années du cinéma à l'Internet en passant par la vidéo. En effet, les points de vue du metteur en scène ou du producteur (Caezar et Réaux) – à l'instar de ce qui réussit Laurent Bonello avec Le Pornographe (2001) –, mais aussi ceux des autres spectateurs, parce qu'ils sont inscrits au coeur de l'espace de la scénographie exposant de manière conséquemment critique les exhibitions de la « Vénus hottentote », neutralisent la solitude fantasmatique requise pour la jouissance tranquille de ce type de représentation. Ainsi, Vénus noire n'est pas, ne peut pas être un film spectaculaire et obscène. Il s'agit bien plutôt d'un film qui met en scène sur dans une perspective radicalement critique les modes diversifiés d'un même régime spectaculaire et obscène ainsi présenté dans son caractère archéologique, et dont généalogiquement plusieurs formes représentatives sont issues : des zoos humains de l'époque coloniale aux spectacles exotiques de Joséphine Baker en passant par les spectacles montrant de plantureuses femmes originaires d'Afrique subsaharienne et usant de leur fessier comme d'un instrument de plaisir au service des hommes (de la danse appelée Mapouka provenant de Côte-d'Ivoire à l'exhibition parfois pornographique des « Black Booties » dont on retrouvera des avatars dans les genres musicaux hyper-virilistes du Gangsta Rap aux Etats-Unis et du Ragga Dancehall en Jamaïque et dans les Antilles). Enfin, le meilleur moyen de résister à la réification pornographique d'un être comme ici subordonné à un dispositif de pouvoir à cheval sur les rapports de domination de race et ceux de genre est de lui conférer cette subjectivité qui marque la résistance à l'assujettissement dont elle est la victime.
3/ La femme faite de la main d'hommes. Généalogie d'une image : Galatée, Pandora, vénus, nanas

Il faut alors bien percevoir le caractère foucaldien de Vénus noire, ce qui lui assure une très nette originalité en regard du tout-venant de l'industrie du cinéma (français ou non d'ailleurs). En effet, n'est-ce pas Michel Foucault qui a parlé d'« archéologie », s'agissant d'une coupe horizontale et historique des divers mécanismes articulant différents événements discursifs et savoirs locaux aux pouvoirs existants (cf. Les Mots et les choses, éd. Gallimard, 1966 – rééd. Coll. « Tel », p. 398) ? Et de « généalogie », comme méthode de désassujettissement des savoirs historiques en les faisant jouer contre une instance théorique unitaire qui prétendrait vouloir les hiérarchiser, les filtrer, les classer, et les ordonner (cf. Dits et écrits, éd. Gallimard, 1991, vol. 3, texte n° 193) ? Et ici, comme on vient de commencer à le comprendre, la même séquence d'exhibition spectaculaire de la « Vénus hottentote » permet le déploiement d'une vision archéologique et généalogique à partir de laquelle peut mieux être vu et connu (selon des déterminations structurales communes qui n'effacent pourtant pas des différences formelles réelles) un certain nombre d'objets culturels d'hier et d'aujourd'hui, des numéros dansés de Joséphine Baker à Big Joy (1984) du peintre Jean-Michel Basquiat, des poupées callipyges (par exemple la série des Nanas, particulièrement Black Nana) de Niki de Saint Phalle aux géantes maternelles du cinéma de Federico Fellini (ou encore récemment les danseuses charnues de New Burlesque dans Tournée de Mathieu Amalric), en passant donc par les danseuses de Mapouka et de Ragga Dancehall. Comme sont exprimés de façon manifeste les rapports étroitement structuraux liant des espaces, des pratiques et des discours spécifiques : la salle de spectacle et le salon mondain, la cour de justice et l'amphithéâtre académique, l'article de journal et le bordel. Michel Foucault avait justement avancé le concept d'« épistémè » dans son ouvrage Les Mots et les choses pour désigner un ensemble de rapports liant différents types de discours et correspondant à une époque historique donnée. L'esthétique durative et accumulative – littéralement exhaustive – propre à Abdellatif Kechiche vise précisément à montrer le caractère épistémique d'un même scène archétypale (au sens où elle est archéologiquement fondatrice) qui se décline dans les champs de la scientificité (avec les naturalistes français) et des plaisirs populaires (avec les bateleurs, les forains, leurs animaux et leurs monstres), de la justice (avec les acteurs anglais de la cour de justice) ou de l'église (avec le baptême de Saartjie devenue Sarah) et des plaisirs mondains et grands-bourgeois (avec les promoteurs libertins d'un certain libéralisme sexuel). A chaque fois, nous avons bel et bien affaire à des dispositifs de pouvoir qui servent techniquement à produire des sujets (autrement dit à assujettir des individus). Et ici, ce sujet, c'est la « Vénus hottentote », objet d'études et de récits (du texte scientifique à la chanson populaire en passant par l'enquête journalistique et la prière du prêtre), modèle vivant pour dessins, tableaux, affiches et statuettes, chair à spectacle pour riches comme pour pauvres, corps symboliquement violé, puis physiquement et à répétition pénétré, que les effets conjugués d'une maladie vénérienne et de la pneumonie vont littéralement crever, vider, épuiser. Mais, en même temps qu'il y a relations de pouvoir, il y a toujours des formes de résistance au pouvoir, comme l'avait fait remarquer Michel Foucault : « Elles constituent l'une pour l'autre une sorte de limite permanente, de point de renversement possible (…) En fait, entre relations de pouvoirs et stratégies de lutte, il y a appel réciproque, enchaînement indéfini et renversement perpétuel » (in « Le sujet et le pouvoir » in Dits et écrits, opus cité, vol. 4, texte n° 306). Nous avons donc aussi affaire ici à Saartjie Baartman, une subjectivité non plus seulement victime des discours qui s'exercent sur elle, mais capable d'une parole et de désirs qui la sauvent de la plus totale réification. Ainsi, le point de vue du cinéaste se distingue radicalement (ce faisant, il se préserve des effets des pouvoirs des dispositifs qu'il montre) des points de vue qui se sont alors, et de manière multiple, exercé sur le corps de Saartjie Baartman, tout en sachant exposer (sans se brûler) dans toute sa lumière la plus crue la violence des différents dispositifs et régimes de discursivité qui ont plié et modelé, pétri et pénétré l'héroïne, ainsi que le caractère moderne (archéologique autant que généalogique) d'une scène fondatrice (humilier publiquement une personne doublement dominée, parce que femme, et parce que racisée) dont il semblerait que nous ne soyons pas encore sortie.

On pourra également mentionner un autre piège que sait contourner ou (on le dira en forme de clin d'oeil pour l'auteur de L'Esquive) esquiver le cinéaste, précisément parce qu'il le considère frontalement et l'empoigne sans ménagement, avec un regard où se côtoient l'auto-réflexivité et l'auto-critique. C'est la référence discursive et mythologique au récit de Pygmalion, très souvent associée par les journalistes et les critiques à Abdellatif Kechiche lorsque l'on met en avant sa capacité à trouver et valoriser les jeunes actrices inconnues, talentueuses et prometteuses (Sara Forestier pour L'Esquive, Hafsia Herzi pour La Graine et le mulet, la cubaine Yahima Torres dans Vénus noire). En ce sens, on peut alors légitimement considérer les personnage de Caezar et de Réaux, véritables Pygmalion étant tout à la metteurs en scène, producteurs et acteurs de leurs propres spectacles, comme des projections monstrueuses et négatives du réalisateur-même. C'est que le mythe de Pygmalion, raconté par le poète épique Ovide dans le livre 10 des Métamorphoses, est un récit archétypal mettant en scène sur l'île de Chypre un sculpteur voué au célibat parce qu'il est révolté par la conduite vicieuse des Propétides (les femmes chypriotes), et amoureux d'une statue d'ivoire qu'il a lui-même créée (elle ne sera nommée Galatée qu'à partir de la Renaissance) et qui s'anime grâce au pouvoir de... Vénus. Discours extrêmement marqué par les représentations patriarcales (l'homme littéralement « fait » la femme à l'aune de son idéal féminin), le mythe de Pygmalion et de Galatée, quand il est par exemple relu par le dramaturge irlandais George Bernard Shaw dans sa pièce Pygmalion (1914) qui sera adaptée au cinéma avec My Fair Lady (1964) de George Cukor, est paradoxal puisqu'il se conclut alors par la séparation de la "créature" déçue par son propre "créateur". En ce sens, Caezar et Réaux (à l'instar du phonétiste Henry Higgins chez George Bernard Shaw) prolongent non plus dans le registre mythologique mais bien dans la matière sociale et historique dont sont faits les mondes humains la figure de Pygmalion dressant leur Galatée (la « Vénus hottentote ») à partir d'un idéal (faire du profit à partir des clichés racistes à l'époque en voie de formation et de cristallisation) auquel doit être soumise la personne réelle (Saartjie Baartman, ainsi proche de la fleuriste Eliza Doolittle dans la pièce Pygmalion). On rapprochera également le mythe de Pygmalion de cet autre mythe fondamental de l'antiquité grecque : Pandora, la première femme créée sur ordre de Zeus (Héphaïstos l'a fabriquée à partir de l'argile, Athéna lui a donné le souffle de vie, Aphrodite la beauté, Apollon le talent musical, Héra la jalousie, et Hermès l'art du mensonge et de la persuasion) pour se venger des êtres humains qui ont bénéficié du feu volé aux dieux par Prométhée, et qui fut l'épouse du frère de ce dernier, Epiméthée. "Pandora est l'oeuvre de la techne, de "l'art" d'Héphaïstos qui l'a fabriquée comme on fabrique une statue" explique Jean-Pierre Vernant (in Pandora, la première femme, éd. Bayard / BNF, 2006, p. 85). De Pandora à Galatée en passant par la "Vénus hottentote", on a toujours affaire à la symbolique de la fabrication d'une femme pour des hommes en liaison avec le divin. Et ce moulage est un dressage ou un modelage qui est un assujettissement violent symboliquement, psychologiquement, et physiquement tant il peut prendre la forme coercitive de la contrainte. Alors que Abdellatif Kechiche travaille à ouvrir des espaces de valorisation symbolique à des actrices débutantes embarquées dans des films difficiles et audacieux afin qu'elles puissent ensuite vivre leur vie et continuer à travailler dans une autonomie qui ne doit alors plus rien à leur précédente collaboration. Bien sûr, le cinéaste occupe forcément la position classiquement dominante de l'artiste dans une relation au sein de laquelle les femmes sollicitées comme actrices peuvent apparaître à l'autre bout du rapport comme de la matière à manipuler et pétrir. Mais il s'agit d'une collaboration d'où émerge tout ce qui a douloureusement manqué à Saartjie Baartman : la reconnaissance de ses talents, l'autonomie et la maîtrise d'une trajectoire professionnelle manifestant la positivité de « processus de subjectivation » (Michel Foucault) moins passivement subis qu'activement désirés. Pourtant, dans les intervalles de la chaîne spectaculaire qui enserre le corps de l'héroïne, il y a un visage et des silences, des regards et des paroles, une distance et un jeu (exactement comme chez Joséphine Baker) qui disent et affirment qu'une subjectivité a existé, retorse et volatile. Et il faut impérativement voir et entendre cela, malgré toutes les amnésies et les réifications, dont l'une des ultimes actualisations aura été le moulage de plâtre du corps de cette femme, le squelette et les bocaux contenant ses organes génitaux et son cerveau qui auront été exposés au Musée de l'Homme à Paris jusqu'en 1976, et qui auront été récupérés par le gouvernement sud-africain présidé par Thabo Mbeki pour être inhumés le 09 août 2002 dans sa province natale du Cap.
4/ La mise en scène de la sauvagerie et l'éthique de l'ensauvagement

« L'acteur éthique ne joue plus le rôle de relais des êthos spectaculaires. Une exposition éthique fait irruption dans le déroulement réglé du spectacle, elle ne joue pas le jeu du décor, du dressage et de la mise en scène de soi, elle court-circuite les boucles mimétiques et casse les typologies. Une exposition éthique n'opère pas une simple critique du spectacle de la réalité, elle en sape de l'intérieur les conditions de fonctionnement et donc de possibilité. Elle introduit au coeur des mécanismes spectaculaires de domestication la plus discrète et la plus redoutable sauvagerie, celle de l'indéterminé » (Olivier Razac, L'Ecran et le zoo. Spectacle et domestication, des expositions coloniales à Loft Story, éd. Denoël, p. 211). Saartjie Baartman (et Yahima Torres qui l'incarne fabuleusement), telle qu'elle est vue et considérée par Abdellatif Kechiche dans son film Vénus noire, est-elle cette « actrice éthique » dans un film valant alors comme « exposition éthique » au sens de l'auteur de L'Ecran et le zoo, actrice qui peut court-circuiter les chaînes spectaculaires des catégories et des typologies qui stigmatisent, parce qu'elles enferment les individus assujettis dans une forme d'altérité synonyme de minorité et de domination ? On aura remarqué le vocabulaire explicitement foucaldien employé par Olivier Razac qui ne se contente pas seulement de traiter des « zoos humains » et de leur possible descendance généalogique (cf. par exemple, Zoos humains. De la vénus hottentote aux reality shows [sous la dir. de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Eric Deroo et Sandrine Lemaire], éd. La Découverte, 2002). Si les zoos humains ont été historiquement précédés par les cabinets de curiosités du 16ème siècle et les « freak shows » du 19ème siècle, c'est l'époque coloniale qui historiquement sur-détermine en dernière instance des exhibitions spectaculaires qui avaient alors pour double objet de magnifier la puissance des nations colonisatrices et de consacrer la hiérarchie raciale des différences selon laquelle les « Blancs » allaient considérer avec curiosité les « Nègres », « Jaunes » et autres « Arabes » qu'ils dominaient alors (par exemple lors de l'exposition coloniale internationale de Paris de 1931 qui a servi de base au roman de Didier Daeninckx, Cannibale, éd. Verdier, 1998). Si la seconde guerre mondiale allait représenter un terme à l'économie des zoos humains qui avaient du point de vue de leurs promoteurs satisfait aux exigences commerciales et idéologiques de valorisation de l'empire coloniale, c'est le début du 19ème siècle qui, marquant l'expansion mondiale de l'économie capitaliste, allait voir la mise en scène spectaculaire du « sauvage » connaître son envol commercial. A l'époque de la « Vénus hottentote », on sait qu'il y en eut des dizaines d'autres, avant elle et après elle, qui allaient hanter l'imaginaire occidental (de Victor Hugo et Henri Troyat à Georges Brassens et plus récemment à nouveau Didier Daeninckx avec cet autre roman qu'est Le Retour d'Ataï en 2002). Mais si on se souvient particulièrement de Saartjie Baartman, c'est parce que le naturaliste et paléontologue Georges Cuvier a utilisé sa dépouille pour prouver et vérifier son discours de la différence et de la hiérarchie des races qu'il défendait alors, et auquel il voulait donner du crédit scientifique. On pourrait dire à la manière de Claude Lévi-Strauss de cette dernière qu'elle représente à son corps défendant le « péché originel de l'anthropologie » qui est cette discipline ayant longtemps reposé sur une conception scientifiquement infondée de l'existence de la pluralité des races, et dont les travaux auront connu une descendance politiquement criminelle et génocidaire jusque parmi les peuples européens (Juifs, Tsiganes, slaves) dans le courant du terrible 20ème siècle. Oliver Razac rappelle tout cela, en même temps qu'il s'attache dans une perspective foucaldienne à insister sur la question éthique du souci de soi, comme « une sorte d'aiguillon qui doit être planté là, dans la chair des hommes, qui doit être fiché dans leur existence et qui est un principe d'agitation, un principe de mouvement, un principe d'inquiétude permanent au cours de l'existence » (Michel Foucault, L'Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981-1982, éd. Seuil/Gallimard, 2001, p. 09, cité par Olivier Razac, op. cit., p. 195), et surtout comme possibilité de déjouer et neutraliser les dispositifs de domestication des corps exhibés (dans les zoos humains hier, dans les émissions de télé-réalité aujourd'hui) et de dressage des regards posés sur ceux-ci. Quand Saartjie Baartman joue et chante une berceuse qui calme les ardeurs de la foule furieuse de jouir du spectacle de la sauvagerie ainsi mise en scène, quand l'héroïne est capable d'accompagner harmonieusement avec son instrument à cordes le violoniste présent pour un concert dans un dîner mondain, quand elle danse et qu'elle suscite une troublante fascination, quand elle réclame à son metteur en scène qu'elle ne veut plus être touchée par le public, quand elle explique aux juges de la cour où a été traduit Caezar sous prétexte de l'obscénité amorale de ses spectacles qu'elle s'exécute de son plein gré parce qu'elle est payée pour cela et qu'elle est une artiste, quand elle regimbe devant les naturalistes qui veulent la mesurer sous toutes les coutures (et, refusant qu'on lui palpe les parties génitales, elle se décide à palper celles de Georges Cuvier lui-même à la grande surprise de ses confrères), quand elle a un rapport sexuel avec Réaux qui n'est pas subi mais désiré, eh bien elle s'expose comme un « acteur éthique » dont les intempestives décisions déçoivent ou surprennent les dispositifs, les discours et les regards (y compris ceux des spectateurs de Vénus noire) qui avaient pour objectif de substituer au réel d'une subjectivité résistante le fantasme d'un cliché conforme aux attendus normatifs du pouvoir auquel il échoit. Ce faisant, Abdellatif Kechiche offre à son personnage une matière éthique et subjective qui autorise aussi à distinguer le film en tant qu'exposition cinématographique de spectacles obscènes des avilissantes exhibitions qu'il montre sans se confondre avec. A la différence sauvage historiquement codifiée et configurée par des pouvoirs souvent dominés par le regard d'individus concentrant trois systèmes de domination et d'oppression spécifiques (parce que ce sont des hommes, des bourgeois, et des « blancs »), s'oppose l'ensauvagement éthique d'un personnage fictionnel soutenu par son metteur en scène de cinéma afin de redonner du jeu, de la subjectivité et de l'actualité à une figure ayant réellement vécu, et qui apparaît désormais dans toute la force de sa contemporanéité.
Cette éthique de l'ensauvagement et de la résistance subjective se voit, dans l'ouvrage d'Olivier Razac, mise en relation avec la distanciation brechtienne à l'oeuvre dans le théâtre épique conçu par le dramaturge allemand. « Le critère éthique d'exposition fait référence à un travail de comédie mais ce n'est pas celui de l'acteur "classique" qui entre dans la peau d'un personnage. Dans la réalité spectaculaire, cela s'appelle mentir, dire le faux comme si c'était le vrai (…) Le jeu éthique serait plutôt une manière de dire le vrai comme si c'était faux, de dire vrai en montrant que l'on est en porte-à-faux avec soi-même. Cela ressemble au travail d'un acteur épique, tel que Brecht le définit » (ibidem, p. 208). C'est comme si, dit d'une autre façon, l'éthique de l'ensauvagement, afin de contrer les effets d'identification mimétique à des normes représentatives (éthiques ou morales, journalistiques ou comportementales, spectaculaires ou commerciales, humanistes ou racistes, scientifiques ou religieuses) imposées par des pouvoirs quels qu'ils soient, donnait davantage de jeu et instillait du trouble au sein du « paradoxe du comédien » cher à Denis Diderot selon lequel l'acteur et le personnage qu'il interprète ne devaient pas se mélanger dans la perception du spectateur (la distinction entre « jouer d'âme » et « jouer d'intelligence », la seconde proposition ayant la faveur du philosophe rationaliste, est au coeur de son essai publié à titre posthume en 1830). On l'a déjà souligné, mais l'emploi par le cinéaste de la durée (des métrages, des séquences, comme des tournages) induit d'accéder aux marges ou aux confins éprouvants (pour les acteurs comme pour les spectateurs) d'une région esthétique où entrent en extrême coalescence le documentaire et la fiction. On croit avoir affaire à une stricte fiction, mais il s'en dégage des effets de captation documentaire qui traduisent le trouble ou la souffrance des acteurs permettant l'actualisation d'un récit ainsi empêché de se figer dans la reconstitution historique. Les personnages de la fiction croient avoir affaire à une sauvageonne, mais certains (et significativement ce sont le plus souvent des femmes) s'offusquent de l'humiliation qui l'avilit (parce qu'elles reconnaissent dans ce miroir déformé et déformant qu'est ce type de spectacle leur humiliation propre ?), ou sont bouleversés par ses réels talents. L'acmé de cette logique, qui représente la pointe la plus élevée du caractère auto-réflexif de Vénus noire, réside dans la séquence du procès de Caezar, peut-être la séquence la plus passionnante du film d'Abdellatif Kechiche. D'abord, remarquons – comme souvent chez Abdellatif Kechiche – le choc des régimes de discursivité, l'antagonisme des discours, la conflictualité des énoncés et des savoirs qu'ils recouvrent. C'est sur une base discursive présentée comme humaniste par des représentants d'une institution dite « amie » de l'Afrique que Caezar est traduit en justice pour avoir prétendument malmené et humilié son "esclave" Saartjie Baartman (alors que la traite est interdite en Angleterre depuis 1807, et ne le sera par la France qu'en 1848). Or, cet humanisme est soutenu par le registre politique de la mission civilisatrice qui diminue quelque peu la portée désintéressée de la récrimination. Ailleurs, l'agencement discursif du libéralisme et du contractualisme qu'il consacre sur le plan juridique et à partir duquel s'établit la défense de Caezar s'affronte avec un régime moins moderne et plus traditionnel (car adossé sur la religion chrétienne) qui est celui de la morale. Les contradictions de la société anglaise de l'époque se trouvent ici particulièrement intensifiées : elle tranchera pourtant en faveur des habits neufs du libéralisme contre les vieux vêtements de la morale chrétienne. En même temps, s'agit-il seulement en face des liens unissant Caezar et Saartjie Baartman d'une libre association mercantile ? La colère, qui a pu succéder aux plaisirs de l'exhibition, et qui exprime les différents affects que le peuple peut publiquement exprimer à l'occasion de la scène sociale où il se trouve (la salle de spectacle populacière ou la cour de justice bourgeoise), se manifeste aussi à partir de justifications moins humanitaires que racistes, notamment dans le refus d'entendre la profession de foi de l'héroïne selon laquelle c'est au nom de l'art qu'elle a abandonné son pays d'origine pour suivre en Europe Caezar. Peut-on ignorer les protestations de cette dernière, qui ne veut plus être touchée par les mains baladeuses du public, et qui marque de plus en plus une fatigue que seule la consommation de tabac et d'alcool semblerait pouvoir pallier ? Est-elle consentante et volontaire dans une exhibition qui, tantôt est considérée comme une fiction dont ne sont pas totalement dupes le peuple des tavernes et des foires de Piccadilly comme les riches habitués des salons mondains parisiens, tantôt est vue comme la forme ultime de dégradation d'un être humain par un autre ?

C'est alors que l'avocat de Caezar avance un argument qui, un peu plus d'un siècle plus tard, aura pour définition scientifique le déni, au sens où l'ethnologue et psychanalyste freudien Octave Mannoni lui donnait avec cette formule devenue classique : « Je sais bien, mais quand même » (cf. Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre scène, éd. Seuil-coll. « Points », 1969). On rappellera qu'Octave Mannoni fut l'un des premiers critiques scientifiques du colonialisme (avec son ouvrage intitulé Psychologie de la colonisation,éd. Seuil, 1950), mais dont les limites dans l'analyse ont montré selon Aimé Césaire (cf. Discours sur le colonialisme, éd. Présence africaine, 1955) et Frantz Fanon (cf. Peau noire, masques blancs, éd. Seuil, coll. « Essais », 1971 [1952 pour la première édition]) la pénétration des clichés racistes au coeur même du point de vue défendu par Octave Mannoni. Donc, le déni, autrement dit « le mode de défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante » (Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis, Vocabulaire de psychanalyse, éd. PUF-coll. « Quadrige », 1967, p. 115), a été repris par Christian Metz dans son ouvrage d'analyse structurale du cinéma, Le signifiant imaginaireen 1977 (éd. Christian Bourgois, 1983), afin d'éclairer la position clivée d'un spectateur (de théâtre ou de cinéma) qui sait bien qu'il a affaire à une représentation, mais qui y croit malgré tout, seule condition (imaginaire) pour assurer l'efficience symbolique de la mise en scène d'une fiction réclamant donc moins crédulité que croyance. On retrouve ici le dispositif de la mise en abyme que l'on peut ailleurs retrouver chez Abdellatif Kechiche, de la pièce de Marivaux Les Jeux de l'amour et du hasard dans L'Esquive à la danse finale de La Graine et le mulet, tous films ramassés par Vénus noire qui pousse par conséquent le plus loin la réflexion sur le spectacle comme superposition du réel et de sa représentation, et comme dispositif de pouvoir auquel n'échappe pas l'art du cinéma. Ce qui ne se nommait alors pas déni à cette époque, et qui pourtant détermine les positions mouvantes d'accusateurs publics qui croient puis ne croient plus puis croient à nouveau avoir affaire à une représentation, manifeste la troublante mobilité de sens relatif à un espace représentatif (les exhibitions de la « Vénus hottentote ») qui relève à la fois et en même temps de la fiction fabriquant de l'imagerie exotique à l'artificialité explicite, et de l'oppression réelle au nom de la fabrication des clichés racistes de l'époque. Le gag étant ici que Caezar, qui a bénéficié de la plaidoirie de son avocat sur le mode de la fallaceuse confusion entre réel et représentation, se plaint ensuite de la chanson qui le moque dans une taverne, Réaux hurlant alors à ce denier qu'il ne s'agit là justement que d'une chanson. C'est la vérité esthétique et politique du projet du cinéaste : un spectacle se coltine avec la matière réelle soutenant ses principes de représentation. Enfin, le déni ne travaille-t-il pas les paroles d'une femme qui, divisée entre différentes instances discursives selon lesquelles elle est la vénus hottentote et Saartjie Baartman, Sarah la baptisée et la femelle représentant le chaînon manquant entre les humains et les singes selon le naturaliste Georges Cuvier, veut insister sur une relative liberté que tout le monde veut lui soustraire, mais qui existe aussi sur le mode du consentement et de la contrainte ? Comme dans le récent film de Benoît Jacquot intitulé Au fond des bois et inspiré d'un fait divers ayant eu lieu dans la campagne provençale française de 1865, Abdellatif Kechiche met à l'épreuve la pensée individualiste moderne héritée notamment du cartésianisme, et qui constitue le soubassement de l'idéologie libérale et du juridisme bourgeois définitivement établis durant le 19ème siècle, en montrant les limites aporétiques relatives à un discours du type de celui de la « servitude volontaire » conceptualisée en 1549 par Etienne de La Boétie. Comme le note l'économiste Frédéric Lordon dans son ouvrage Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza(éd. La Fabrique, 2010) qui souhaite « combiner un structuralisme des rapports et une anthropologie des passions. Marx et Spinoza » (p. 10), la pensée de La Boétie vaut mieux que la formule qui l'a rendu célèbre. Puisqu'il est difficilement concevable de vouloir ce qui est indésirable, il paraît plus tenable de considérer que « les véritables chaînes sont celles de nos affects et de nos désirs. La servitude volontaire n'existe pas. Il n'y a que la servitude passionnelle. Mais elle est universelle » (p. 35). Cette servitude passionnelle qui structure la relation de Saartjie Baartman avec ses patrons successifs, au nom des profits des seconds et du prestige artistique (même mineure ou dévoyée) désirée par lapremière. Cette servitude passionnelle aussi, qui détermine sur le plan non plus seulement interindividuel mais collectif les rapports jamais perçus comme tels entre les dominants et les dominés, qu'il s'agisse des hommes et des femmes en fonction de la question du genre, ou bien que l'on ait affaire à des individus racisés par d'autres en fonction de la question raciale.
5/ L'exhibition de la différence sauvage et la production de l'altérité monstrueuse

Bien sûr, face à Vénus noire, comment ne peut-on pas ne pas penser à L'Énigme de Kaspar Hauser (1974) de Werner Herzog, Elephant Man (1980) de David Lynch et, avant lui, Freaks (1932) de Tod Browning ? Ces références sont assumées, et montrent dans quelle généalogie cinématographique le film d'Abdellatif Kechiche prend place. La mise en scène et l'exhibition spectaculaire de la différence comme manifestation d'une altérité pathologique et monstrueuse sont particulièrement bien saisis par les films de Tod Browning, Werner Herzog et David Lynch, le film du premier bénéficiant de la présence réelle de « monstres » ainsi qu'on les qualifiait à cette époque (nains, manchots, homme-tronc, etc.) pendant que les films du deuxième et du troisième s'inspirent de faits divers réels (respectivement à Nuremberg en 1828 et à Londres durant les années 1880). Et Freaks, L'Énigme de Kaspar Hauser et Elephant Man insistent, comme le fait à nouveau aujourd'hui Vénus noire, sur la subjectivité réelle d'individus dont les difformités physiques induisent selon les grilles normatives d'alors tantôt la bêtise pour les personnages du film de Tod Browning, tantôt la débilité pour le héros du film de David Lynch, tantôt une bonne sauvagerie originelle pour celui de Werner Herzog. La cruelle vengeance collective orchestrée par les personnages de Freaks, le meurtre du héros éponyme de L'Énigme de Kaspar Hauser et le désir d'intégration bourgeoise et de distinction, culturelle de John Merrick dans Elephant Man accomplissent la subtile perversité politique de films qui visent ainsi à neutraliser les effets de pouvoir liés aux discours de la morale apitoyée et de la charité qui, en s'exerçant sur les corps capturés dans une altérité monstrueuse, instruisent la reconduite de rapports de domination symbolique. Vénus noire s'inscrit sans l'ombre d'un doute dans cette généalogie cinématographique, en même temps qu'il lui apporte deux éléments concourant à établir sa propre spécificité esthétique : car le personnage exhibé est une femme racisée, deux fois donc victime d'une oppression qui relève à la fois de la domination de genre et de la domination raciale. Si Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique (éd. Gallimard, 1961) de Michel Foucault a montré de quelle manière le grand enfermement des fous dans l'hôpital général de Paris sur décret royal de 1656 constitue une sorte de rupture épistémologique à partir de laquelle fonctionnera la division sociale et symbolique du normal et du pathologique, et si cette division se trouvera ensuite reproduite dans les cirques et les zoos humains, c'est qu'il est question sur le plan « biopolitique » – autrement dit des pouvoirs qui vont jusqu'à investir la vie elle-même comme le dit Michel Foucault (dans Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, éd. Gallimard/Seuil, 2004) – de la production de la différence comme monstruosité à partir de laquelle constituer des hiérarchies sociales, des grilles normatives, et des rapports de domination, d'exploitation et d'oppression qui leur sont corrélatifs. « Le mystère de l'Autre se trouve résolu. L'Autre c'est celui qui a le pouvoir de distinguer, de dire qui est qui : qui est "Un", faisant partie du "Nous", et qui est "Autre"et n'en fait pas partie ; celui qui a le pouvoir de cataloguer, de classer, bref de nommer » écrit Christine Delphy dans son texte « Les Uns derrière les Autres » (in Classer, dominer. Qui sont les "autres" ?, éd. La Fabrique, 2008, p. 19). Et il y avait de sérieuses déterminations sociales et historiques pour que cette chercheuse au CNRS et militante féministe écrive cela, elle qui a vu les conséquences concrètes du racisme lorsqu'elle a étudié aux États-Unis au début des années 1960 à l'époque du mouvement des droits civiques, qui a ensuite participé à fonder le MLF entre 1968 et 1970 comme à conceptualiser le système patriarcal en tant qu'il recouvre l'exploitation des femmes par les hommes dans l'espace domestique, et qui depuis les années 2000 avec plus de systématicité, s'est attaquée au racisme français dans ses rapports avec le (post)colonial. « (…) "l'altérité" naît de la division hiérarchique, elle en est à la fois le moyen – évidemment les inférieurs ne font pas les mêmes choses que les supérieurs, sinon à quoi ça servirait que quelqu'un commande – et la justification » (op. cit., p. 21). L'altérité est donc cette catégorie épistémique qui inclura le fou et le difforme, le malade et l'homosexuel (gay ou lesbien), la femme et le racisé, toutes identités socialement construites (et souvent sur un mode spectaculaire) afin de construire dans le même mouvement l'identité de ceux qui sont « les Uns derrière les Autres », les dominants, des individus bénéficiant du capitalisme parce que ce sont des bourgeois, bénéficiant du sexisme parce que ce sont des hommes hétérosexuels, bénéficiant du racisme parce que ce sont des « Blancs ». L'altérité, pour être totalement opératoire comme concept et comme pratique, induit des processus de transformation des individus afin qu'ils ressemblent tantôt aux « Uns », tantôt aux « Autres » (et l'exhibition spectaculaire de la différence sauvage avec la « Vénus hottentote » puis dans les zoos humains aura été un dispositif privilégié de construction et d'exposition de l'altérité). « L'altérisation produit donc une altération des personnalités des dominé-e-s [en même temps que] l'altérisation altère aussi les dominants – personne n'est telle qu'elle le serait si la domination n'existait pas – mais en sens inverse ; elle crée des personnalités dominantes » (op. cit., p. 30-31). Et c'est toute la beauté de Vénus noire de montrer tout à la fois l'exhibition spectaculaire de la « Vénus hottentote » comme un dispositif de production de division hiérarchique et de production d'une altérité monstrueuse, l'altérité vécue comme une altération physique et psychique qui participe à comprimer et diminuer l'énergie vitale de l'héroïne, et les processus d'« altérisation » auxquels n'échappent pas les dominants filmés dans toute leur monstruosité (on a précédemment évoqué le caractère effrayant et bergmanien des gros plans de visages), parce qu'ils sont eux-mêmes durablement affectés par la production des images de l'altérité.

Elephant Man, L'Énigme de Kaspar Hauser et Freaks représentent trois incontournables chefs-d'oeuvre auxquels se confronte vaillamment Vénus noire, dans le même mouvement où il problématise originalement la question de la production spectaculaire de la différence comme altérité monstrueuse à partir des questions des rapports de race comme de genre. Mais, comment ne peut-on pas ne pas aussi songer à King Kong (1932) d'Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper, comme au film de Marco Ferreri de 1964, Le Mari de la femme à barbe ? Le premier film appartient encore pleinement à l'époque coloniale, quand le second envisage de manière critique la sortie de l'ère coloniale comme l'entrée dans l'ère postcoloniale. Si King Kong est une fiction spectaculaire qui traite de l'exhibition spectaculaire d'un singe géant arraché de sa jungle natale et projeté sur les scènes newyorkaises, Le Mari de la femme à barbe raconte sur le mode comique les aventures d'un homme (Ugo Tognazzi) qui décide d'utiliser la pilosité faciale abondante de son épouse (Annie Girardot) afin d'en faire un spectacle payant, la seconde jouant devant les badauds une quasi-guenon quand le premier interprète un chasseur de l'époque coloniale qui a réussi à la capturer. C'est l'ambiguïté du film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, qui repose implicitement sur l'homologie structurale entre les exhibitions foraines d'animaux sauvages et les zoos humains qui dominaient les expositions coloniales de l'époque (et King Kong est aussi un avatar plus ou moins conscient ou volontaire du « nègre » issu de son obscure tribu africaine), mais qui en même temps ouvre un bel espace pour déployer de façon émouvante la subjectivité affectée du monstre, et qui enfin se conclut sur le caractère littéralement catastrophique de l'exhibition du grand singe. On pourrait alors dire d'une certaine manière que Vénus noire éclaire crûment les ambiguïtés de King Kong, en même temps qu'il en extériorise le contenu idéologique : l'Africain, tel qu'il est exposé dans ce dispositif de pouvoir qu'est l'exhibition spectaculaire servant la production de la différence sauvage et de l'altérité monstrueuse, est victime d'une « altérisation » qui est une animalisation visant à le déchoir de la communauté humaine. Quant au film de Marco Ferreri, extrêmement en avance pour son temps, il met en relation les questions apparemment séparées de la domination masculine et de la domination raciste (tout en montrant l'origine coloniale d'un certain racisme et sa persistance post-coloniale), comme il révèle les obscures homologies structurales que partagent racisme et sexisme. C'est au cœur des ténèbres où ne se distinguent pas encore totalement le sexisme et le racisme que plonge aussi le film d'Abdellatif Kechiche, avec un courage politique et une fureur esthétique introuvables ailleurs dans le cinéma français. C'est la brûlante et exténuante contemporanéité de Vénus noire, qui montre une travailleuse subordonnée à l'exhibition des clichés racistes de l'époque, et dont la fatigue ou le silence comme stratégies de résistance ont été incorporés à d'autres clichés qui ont la peau si dure qu'un parfumeur milliardaire (Guerlain) a encore récemment à la télévision rappelé à la mémoire (post)coloniale de son auditoire la légendaire paresse des « nègres ». C'est la furieuse actualité d'un film qui montre ainsi et tout à la fois l'archéologie des dispositifs spectaculaires qui continuent encore aujourd'hui de produire les visibilités (pornographiques, par exemple) de la domination masculine et raciste, comme une subjectivité qui a été victime d'une altérité logée dans son corps (une femme aux formes hypertrophiée, une « Noire » qui ressemble à une guenon), et dont les racisés actuels (et particulièrement les femmes) sont les descendants historiques, les héritiers généalogiques. La sociologue Nacira Guénif-Souilamas, qui évoque avec raison « l'érotisation et la prédation sexuelle qui accompagnèrent toute l'histoire coloniale » dans son texte « La réduction à son corps de l'indigène de la République » (in La Fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, éd. La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2005, p. 202), rappelle que « l'ordre patriarcal [a été] au service colonial » (p. 200), avec la mise en place d'un « gouvernement des corps » (idem) dont la persistance post-coloniale induit que, « dans la partition sexuée de l'indigénisation contemporaine, l'homme est assigné à un réduit hétérosexuel où il loge l'expression d'une violence contre soi et l'autre ; et la femme est offerte sur le marché ouvert, concurrentiel et "racialement" mixte, de l'érotisation » (p. 204). En cela, et malgré les réticences de l'historien Pascal Blanchard relatives à l'insistance de la question sexuelle dans le film d'Abdellatif Kechiche (cf. l'excellent supplément spécial Trois couleurs publié par le réseau des cinémas MK2 afin d'accompagner et soutenir un film... produit par Marin Karmitz - et particulièrement l'entretien avec Pascal Blanchard, p. 18-27), Vénus noire expose le corps martyr et matriciel au sein duquel auront convergé les faisceaux du pouvoir colonial et de l'ordre patriarcal, du racisme et du sexisme, et dont les rayons brûlent encore les consciences et les représentations actuelles. Et, ce faisant, le cinéaste peut ainsi renouveler le naturalisme cinématographique (l'usage multiple de la durée, le morcellement du découpage, le trouble documentaire brouillant la fiction, et la netteté du numérique HD jouant de la proximité sensible avec le filmé sont les principes de ce naturalisme pour aujourd'hui) à partir d'une critique radicale du naturalisme pseudo-scientifique ayant concouru à forger l'épistémè de la modernité occidentale.
C'est encore le chercheur en philosophie et en sciences politiques Olivier Le cour Grandmaison qui, dans son ouvrage intitulé Coloniser. Sur la guerre et l’État colonial (éd. Fayard, 2005, surtout p. 60-94), montre preuves à l'appui (avec des extraits de la littérature de l'époque, chez Montesquieu, Tocqueville, Maupassant, Zola, Loti, etc.) que les registres discursifs et spectaculaires de la dépravation, de l'animalisation et de la bestialisation étaient ensemble à l’œuvre afin de désigner, catégoriser et enfermer dans une altérité stigmatisante les indigènes alors colonisés (et particulièrement les femmes algériennes). En même temps que la dégradation symbolique des colonisés, corrélat de leur extermination physique, servait également de masque à la plus terrible hypocrisie de la part des promoteurs de la civilisation des nations prétendument inférieures qui savaient aussi jouir dans les territoires colonisés de la plus totale impunité sexuelle, loin des normes de la civilité en place (au moins publiquement) dans la métropole colonisatrice. Au moins publiquement en effet, puisque Vénus noire expose jusqu'à l'épuisement et le dégoût les libertinages privés de riches mondains partouzards que l'exhibition obscène de Saartjie Hottentote excite au plus haut point. C'est enfin la philosophe d'inspiration foucaldienne Elsa Dorlin qui, avec le bien-nommé La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, éd. La Découverte, coll. « Textes à l'appui / Genre et sexualité », 2006), explique que l'histoire de l'établissement du concept de race croise en Occident l'histoire de la construction (notamment médicale) de la différence sexuelle. En effet, les discours de la médecine qui structurent les manuels rédigés dans le courant du 17ème siècle, et tels qu'ils sont lus dans le texte et comparés par Elsa Dorlin, ont servi de base épistémique pour les premiers naturalistes qui, partis étudier les populations indigènes des Amériques et des Caraïbes, ont pris pour modèle les énoncés médicaux de la différence sexuelle pour théoriser la différence raciale. La production discursives des « tempéraments de sexe » auraient selon elle précédé et déterminé cette autre production discursive que sont « les tempéraments de race », les racisés étant comme les femmes des individus soumis à des constitutions physiologiques faibles et pathogènes. La nation française moderne forgée à l'époque de l'esclavagisme et du colonialisme serait par conséquent le double produit du racisme et du sexisme. Et si l'on a insisté sur la radicalisation des enjeux théoriques entreprise par Vénus noire, c'est précisément qu'il se déroule à une époque qui appartient à la même séquence épistémique que Voltaire (cf. La Faute à Voltaire) et Marivaux (cf. L'Esquive) : la modernité occidentale illuminée par la philosophie des Lumières. « Il s'agit donc d'un schème cognitif et discursif qui participe d'un dispositif de pouvoir. La fabrication d'un tempérament de race sur le modèle d'un tempérament de sexe sert non seulement l'idéologie esclavagiste qui se développe au cœur des Lumières européennes, mais aussi un rapport de force éminemment violent, une domination plantocratique précaire, à l'oeuvre dans les colonies françaises » (p. 230). Saartjie Baartman exhibée sous la forme de la « Vénus hottentote » appartient bien à cette lignée de « corps mutants » (p. 66), femmes dépravées et lubriques (l'héroïne résiderait sur le versant chaud et humide, masochiste, pendant que Jeanne, la compagne de Réaux jouée par Elina Löwensohn, se situerait plutôt sur le versant froid et sec, sadique) soumises aux divers dispositifs de pouvoir (du spectacle forain à la leçon des naturalistes à l'académie, des journalistes aux médecins, des juristes aux représentants de la morale chrétienne) afin qu'elles collent aux catégories normatives qui relèvent d'abord d'une pensée sexiste avant d'avoir été retraduite lors de la période coloniale en pensée raciste. Et si Vénus noire commence avec la leçon de Georges Cuvier en 1815 pour se clore par la préparation de cette leçon, formant ainsi un vaste cercle narratif au centre duquel brille la « Vénus hottentote », c'est pour pratiquer une incise au sein du discours scientifique d'alors, et y déceler les couches d'une même logique épistémique et spectaculaire (la différence monstrueuse exhibée, l'altérité féminine et raciale que l'on domine en jouissant d'elle) qui traverse toutes les formes discursives et tous les milieux sociaux européens, jusqu'à contaminer le discours scientifique lui-même ainsi révélé dans son caractère de spectacle dont les bases fallacieuses produisent de surcroit une croyance inébranlable, à l'opposé de la mobilité de regard des spectateurs populaires de Londres ou mondains de Paris. Les images d'archives avec lesquelles se clôt le film d'Abdellatif Kechiche, ultime aboutissement documentaire d'une fiction qui a travaillé à convertir l'inactualité particulière de Saartjie Baartman en nécessaire et universelle actualité, peuvent être alors perçues à partir de cette force de bouleversement que la fiction aura su réintroduire dans ces images, un peu à l'instar du final de Valse avec Bachir (2008) d'Ari Folman. A l'opposé, la manière dont le cinéaste relativise quelque peu l'emploi de telles images en les inscrivant à la gauche du générique-fin défilant peut aussi induire la terrible continuité, documentaire et contemporaine, d'une mise en scène spectaculaire du retour au pays natal sud-africain d'un sujet toujours captif, Saartjie Baartman, et ce au profit symbolique d'un Etat tout juste sorti de l'Apartheid (à l'image de ce que fit Nelson Mandela avec la Coupe du monde de Rugby en 1995, et que relate Invictus de Clint Eastwood en 2009). Quand on sait enfin que les restes de Saartjie Baartman ont été exposés au Musée de l'Homme jusqu'en 1976, que l'Afrique du sud a demandé à la France la restitution légitime de sa dépouille, et qu'il a fallu huit années pour que la France réponde positivement à cette demande, on se dit qu'un long chemin reste à faire afin de s'émanciper définitivement et collectivement des rapports de domination raciste et sexiste.

Il était donc attendu, et même impératif, que l'on nomme ce texte consacré à l'un des films français les plus importants de ces dernières années d'après l'ouvrage d'Elsa Dorlin : La Matrice de la race. Alors, pourquoi ce II ? C'est que La Matrice de la raceétait déjà le titre de l'analyse critique consacrée à un autre grand film français vu cette année : White Material de Claire Denis écrit avec la participation de l'écrivaine Marie NDiaye. D'ailleurs, la question du déni était déjà largement envisagée dans ce film, et nous la retrouvons à nouveau et logiquement aujourd'hui. C'est dire à quel point les rapports de domination de genre et de race s'appuient sur une logique inconsciente du déni (« Je sais bien, mais quand même ») qui structure également les discours des personnes qui peuvent affirmer leur volonté d'émancipation libertaire de tous sans exclusive, en même temps qu'elles ont le plus grand mal à admettre l'objectivité de l'exercice de la domination dont elles profitent passivement (« à leur corps défendant » aurait dit Michel Foucault). Avec ces deux films, nous tenons là les deux bouts d'une pensée de la domination à la croisée du racisme et du sexisme. Que nous ayons affaire à l'allégorique récit de la femme « blanche » (Isabelle Huppert dans le film de Claire Denis) qui exploite dans un pays africain déchiré par la guerre civile une plantation de café, et qui, de fait parce qu'elle est exploitée par les hommes de sa famille (beau-père, ex-mari, enfant), échappe aux exactions commises tout en y participant elle-même parce qu'existe une obscure reconnaissance entre les indigènes racisés et elle. Ou bien que nous soyons en présence de Vénus noire, avec son héroïne qui s'accroche jusqu'au bout à une « éthique de l'ensauvagement » (Oliver Razac) afin de se préserver des processus d'« altérisation » (Christine Delphy) ou de « mutation » (Elsa Dorlin) qui en aliènent la subjectivité au profit de la production spectaculaire, et tout à la fois sexiste, raciste et coloniale, d'une différence sauvage dont les effets continuent de s'exercer dans notre société postcoloniale. Eh bien, dans les deux cas, ce sont de grandes affirmations, esthétiques et politiques, concernant des puissances de vie qui n'ont de cesse de résister, hier, aujourd'hui, et demain, aux dispositifs de capture subjective propres à des biopouvoirs qui continuent encore et encore d'opérer au nom de la prétendue différence des races et des sexes.
Mercredi 3 novembre 2010
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
Écrire commentaire