|
Texte tiré de : http://www.objectif-cinema.com/pointsdevue/0778.php
SYNOPSIS : D'abord, il y a Basile Matin, un jeune gars qui a rêvé de Faftao-Laoupo, le symbole de l'avant dernier sommeil...
Maintenant, il sait que s'il dort encore, il va mourir et le problème, c'est qu'à son âge, on aimerait bien avoir toute la vie devant soi. Ensuite, il y a Igor, un autre jeune
gars qui travaille un peu et fait également des études... Mais il n'a pas d'argent et il s'ennuie. Alors l'histoire de Basile, même s'il n'y comprend pas grand chose, l'intéresse
diablement. Enfin, il y a Johnny Got. Un peu journaliste bénévole, un peu détective et pas mal voyou, il s'intéresse beaucoup aux histoires qui ne le regardent pas... Et celle de
Basile le passionne...
|
QUAND A L’EFFORT SUCCEDE LE (RE) CONFORT
Du moyen métrage Du Soleil pour les Gueux en 1999 au long Pas de Repos pour les Braves aujourd’hui, ce qui a changé, ce n’est pas seulement la longueur du
métrage bien sûr, ni que les gueux soient (devenus, mieux, enfin reconnus comme ce qu’ils n’ont jamais cessé d’être, à savoir) des braves dont le repos ne connaît aucun bain
de soleil amollissant. Ce qui a changé, c’est le paysage guiraudien : avant on ignorait son existence sur la carte du cinéma ; maintenant que l’on pensait découvrir
de nouvelles régions, on nous fait en fait (un peu, beaucoup) le coup du tour opérateur en terrain conquis.
|
|

|
|
|
Le « processus d’individuation » (Gilbert Simondon) qu’Alain Guiraudie met en branle dans son nouveau (et très attendu) film avec le
personnage du jeune Basile Matin avec une énergie et une conviction certaines n’a pas pour seules finalités de déconstruire la linéarité narrative habituelle ni de jouer avec
les conventions amidonnées de quelque film de genre que ce soit. Il ne s’agit pas ici de sous-estimer le ludisme affiché et insolent avec lequel le cinéaste se lance à
l’assaut d’une certaine idée du cinéma français (comme du cinéma tout court) afin de permettre de lui ouvrir des accès inconnus jusqu’alors, d’en dynamiser en conséquence la
mécanique, d’en ventiler le plus de possibles… possibles ! Evoquer les noms des cinéastes Jean-Luc Godard, Luis Buñuel, Luc Moullet ou F.J. Ossang, des écrivains Raymond
Queneau, Boris Vian, Albert Cohen, Lewis Carroll est juste mais insuffisant pour rendre compte à la fois de la singularité du film de Guiraudie comme des limites inhérentes à
sa présente entreprise filmique.
Il s’agit de comprendre pourquoi la virtuosité du film semble marquer le pas d’une volonté artistique qui ne sort pas de la clairière, certes touffue, d’un imaginaire
adolescent inventif mais en recul réel par rapport au puissamment transgressif et politique Ce vieux rêve qui bouge en 2001. Le problème de Pas de Repos pour les
Braves, qui affirme moins à l’instar des œuvres précédentes qu’il confirme seulement un potentiel cinématographique réel, est d’être une œuvre moyenne. Très exactement le
moyen terme, à moyenne distance entre la pure mythologie inventée dans le court métrage La Force des Choses (1996) et Du Soleil pour les gueux d’un côté et, de
l’autre, du complet réinvestissement d’un lieu (commun) complètement désaffecté (l’usine couplée au désir des ouvriers de Ce vieux rêve qui bouge) au sens propre comme
au sens figuré.
|

|
|
|
|
Si Guiraudie s’amuse avec un plaisir certain des « vases communicants » chers aux surréalistes André Breton et Philippe Soupault afin que le réel s’habille des étoffes
évanescentes du rêve et que le rêve apparaisse plus réaliste que le réel, il use de vases identiques afin que certains acquis stylistiques de sa veine la plus bariolée et la plus
délurée (fantaisiste mais pas absurde) soient reversés du côté des œuvres qui s’inscrivent dans un territoire plus prosaïque, diminué sur le plan du mythe comme tout simplement du
récit, avec immédiatement pour premier problème d’atténuer la vitalité des deux veines par leur immixtion pas toujours heureuse. Pas de Repos pour les Braves n’est ni aussi
original que Du Soleil pour les Gueux, ni aussi politique que Ce vieux rêve qui bouge. Un peu l’un, un peu l’autre, guère plus. Guère mieux, le croisement opéré ici par ce (moyen)
long métrage ne valant jamais l’addition des qualités des deux moyens (métrages) précédents (on constaterait même une entropie).
L’application systématique avec laquelle Guiraudie mouline des bras (et brasse du vent, certes frais, mais cela demeure du vent) en citant intégralement tous ses courts et moyens
métrages indiquerait que celui-ci commence déjà à ressasser, à piétiner, à tourner en rond (à l’instar du protagoniste) dans un auteurisme étriqué et narcissique qui a pour
désavantage de ralentir lourdement l’œuvre de défrichage d’un territoire cinématographique pourtant parmi les plus singuliers que le cinéma français ait donné ces dernières années
(d’où nos sévères critiques). On est alors moins dans l’invention à proprement parler que dans la citation, la redite (même si) ludique, la reprise (même si) parodique et
loufoque, moins dans une modernité défricheuse que dans un post-modernisme un peu desséché.
|
|

|
|
|
Si bien que, aux deux tiers du film, l’arbitraire dont use Guiraudie afin de tordre les conventions narratives et les codes intrinsèques aux genres dont il emprunte les corridors
(le fait divers, le film d’aventures, le western, le film noir, le naturalisme français, le film fantastique, le kitsch homo…) ne surprend plus du tout à force de vouloir tout le
temps surprendre et donc finit par lasser. Aucune nécessité ne paraît sous-tendre de pareilles déviations, bifurcations ou retours en arrière, si ce n’est la logique d’un rêve qui
s’étiole et meurt, faute de pouvoir toujours tenir…éveillé le spectateur. Mulholland Drive (2002) de David Lynch, modèle (plutôt que référence) contemporain évident que s’est
choisi Guiraudie, est encore loin (et ce n’est de plus pas vraiment pas le meilleur film du cinéaste puisqu’il souffre exactement des mêmes problèmes que le film de Guiraudie).
L’accumulation frénétique, vitaminée, de micro-scénarii visant à doper le récit d’une subjectivité ballottée à l’intérieur d’elle-même et en rupture avec son monde ne sauve jamais
l’affaire ; au contraire, elle précipite un désintérêt croissant à mesure que le film roule, sans d’ailleurs pouvoir retrouver l’allure initiale. C’est toute la question du
rythme : celui pratiqué par Buñuel, atonal, convient aux replis caverneux de l’inconscient (en terrain lisse, la rupture frappe) quand l’action requise par les genres
auxquels Guiraudie fait énergiquement appel épuise la mollesse propre au rêve, biseaute par la vitesse les saillies que sont les discontinuités irrationnelles.

|
|
|
|
Au final, c’est l’impression d’une enfilade marabout de ficelle de courts métrages virtuels, souvent passionnants en soi (la partie « Village-qui-vit
et Village-qui-meurt » par exemple, avec ce beau personnage, récurrent chez Guiraudie, du vieux qui se donne à aimer et que l’on aime parce qu’il n’a plus rien d’autre à
offrir), comme si le cinéaste les avait gardés sous le boisseau sans jamais les avoir réalisés (on sait que le scénario est issu d’un roman que l’auteur a écrit il y a plusieurs
années de cela sans l’avoir jamais édité) et qui ne trouvent pas toujours le moyen d’être soutenus ensemble par la mise en scène. Pour aller plus loin, on regrettera également que
se greffe sur le disparate du récit un relâchement conséquent du point de vue de la forme, moins ferme qu’auparavant, la rigueur de géomètre tatienne ou straubienne des cadres
fixes et des plans longs ayant été le plus souvent remplacée par des recadrages souvent incertains et des mouvements chaloupés, exécutés en steady-cam que rien ne justifie… Si ce
n’est une économie un peu plus étoffée, autorisée par le succès d’estime (et amplement mérité) recueilli à la suite de la sortie des courts et moyens métrages, et sur laquelle
Guiraudie s’appuie afin de rassurer des financiers qui ont misé sur lui tout en rassurant également la poignée d’aficionados que celui-ci essaie visiblement de garder fidèle, à
l’image du troupeau de chèvres appartenant au berger-guitariste de folk-punk (eh oui !) du film. Qui, dans un beau plan, joue pour elles au moment de la traite (on a alors la
furieuse envie de boire ce lait et d’en apprécier la saveur particulière, surtout quand on connaît la façon artisanale dont on le produit).
Le
tournant toujours difficile du long métrage, s’il paraît mal négocié (pour reprendre un des motifs d’un film zébré de dérapages carabinés), peut aussi signifier que Guiraudie
a décidé de pratiquer une purge quant au trop-plein de récits qui peuplent son imagination fertile. Il semblerait même que le cinéaste ait réalisé là son dernier film adolescent,
en cela conforme à la trajectoire du personnage principal, projection à peine stylisée de Guiraudie lui-même. « Le processus d’individuation » vise dans Pas de Repos
pour les Braves à établir que la volonté nécessaire d’arrachement (représentée par une image littérale – les habitants d’un village entier abattus au fusil de chasse) du
milieu d’origine devenu amorphe (cf. le clin d’œil à l’usine AZF de Toulouse), dévitalisé en termes d’actions à vouloir entreprendre, de récits à vouloir raconter, de mythes à
vouloir instaurer, oblige ce même milieu à subir, de par l’extraction même, un infléchissement subjectivé sévère de ses lois physiques, conséquemment plongés dans différents bains
méta, bains révélateurs et colorés que sont ceux que représentent les genres. Pour que, main dans la main, une symbolique archaïque à la Jung (la farandole bergmanienne
d’où surgit le mythe de Faftao Laoupo que narre Basile dans le premier plan du film, en tout point programmatique) et une praxis combinant morale de l’action et éthique faite
corps (exemplairement le personnage de Johnny Got avec son allure de Daniel Auteuil jeune et provincial) puissent converger, fusionner.
En s’individuant, Basile induit aussi la redynamisation mythologique d’un espace voué à la désertification, à l’extinction. On ne s’arrache
pas aussi facilement du cœur de ses origines sociales (et quand on s’en arrache, tout paraît alors unheimlich comme disait Freud, étrange, c’est-à-dire plus du tout
comme à la maison dans une traduction littérale) : les nains de jardin, la « Fuego » rouge, le Guignolet, L’Huma, le bonhomme de neige, la sapin de Noël, le rock
du samedi soir, les surnoms foireux entre copains, les couleurs fluo, la B.D. participent d’une culture populaire, habituellement évincée en province des représentations
dominantes mais qui ici fait retour, accompagnée des restes d’un cinéma de genre (moribond en France) dont la présence vaut aussi pour être parasitée par cette culture-là.
L’étrangeté vaut dans les deux sens, d’abord de voir aujourd’hui un cinéma de genre, dont le déclin neutralisé est décliné au pluriel, et surtout encore possible à l’intérieur
d’un cadre culturel populaire, ensuite de voir également et dans le même temps des lambeaux de culture populaire ragaillardir le cinéma de genre, quel qu’il soit. Le Tarn devient
alors, le temps d’un film, le centre d’un monde qui s’est considérablement rapetissé depuis cinq siècles de mondialisation (on devrait parler plus justement d’occidentalisation du
monde et Guiraudie en livre une version à l’occitane : « l’occitanisation du monde » !).
|
|

|
|
|
Ce goût prononcé pour l’art mineur (explicité par Gilles Deleuze concernant la littérature) chez Guiraudie lui fait pour le coup partager plus d’une
affinité avec l’auteur (cyniquement mésestimé par tous les « professionnels de la profession » : producteurs comme critiques) du récent et tonifiant Le
Furet, Jean-Pierre Mocky. En 2003, le seul intérimaire aura été vu chez Mocky et le seul étudiant-surveillant (c’est le personnage d’Igor qui se demande comment il peut vivre
avec seulement 5000 balles par mois) chez Guiraudie : la précarité qui en France concerne plusieurs millions de personnes n’aura dans le cinéma français été identifiable que
dans deux films seulement (il y a une bataille idéologique à mener ici).
C’est parce que Mocky et Guiraudie (on aurait pu ajouter le nom de Jean-Claude Biette) sont eux-mêmes des précaires du cinéma dont l’existence (minoritaire en terme idéologique,
majoritaire en terme économique) est encore plus fragilisée avec le recul financier de Canal Plus et surtout avec la pseudo « réforme » inique du régime de
l’assurance-chômage des intermittents du spectacle signée fin juin 2003. C’est un cinéma typique de l’amateurisme, au beau sens du terme : cela se voit sur l’écran, Guiraudie
s’amuse, et cette joie enfantine qu’induit tout bricolage pris en charge comme tel et jamais dénié réjouit (la précarité, Guiraudie en rend compte, en joue, la combat ou bien s’en
sert pour en faire une force et il ne se plaint jamais). Cela ne doit pourtant pas empêcher de noter un relatif statisme de l’esthétique guiraudienne (le labyrinthe dans le film,
c’est aussi le symbole de cela, d’un piétinement réel), de ses ambitions formelles et politiques qui ne (le, nous) font pas plus avancer, en-deça des pas de géants que
représentent les plus stimulantes œuvres qui précédent Pas de Repos pour les Braves.

|
|
|
|
Après s’être extrait brillamment des sentiers battus lors de ses précédents films, il faudrait que Guiraudie, désormais prisonnier de son paysage mental,
apprenne alors à sortir de ses propres sentiers devenus comme des gonds et surtout, contrairement au personnage de Basile, ne jamais vouloir rentrer à la maison (puisque de
maison, on le sait, de John Ford à Manoel de Oliveira, il n’y a plus). Repeindre avec des couleurs acidulées Regain de Jean Giono ou lacérer par des riffs punk les scènes
de bistrot méridionales (très belles, très fluides) de Marcel Pagnol, c’est bien, c’est marrant, c’est frais, c’est jeune. Repenser la question de la parole contrecarrant tout
effet de naturalisme (incroyable est la précise et précieuse netteté avec laquelle on s’exprime chez Guiraudie : il n’y a que chez Eric Rohmer pour entendre parler
aujourd’hui le français comme cela mais, à la différence de ce dernier, ce sont les classes dépossédées qui parlent ainsi et aussi bien que les classes possédantes), reposer la
question du corps et du territoire, c’est-à-dire de la trajectoire au cinéma (d’autant plus quand le territoire est français), avec pour horizon Buster Keaton, c’est mieux.
D’accord pour boire un diabolo avec le cinéaste (même si on regrette l’importance trop grande laissée au sirop), mais on aimerait bien que la prochaine fois des liquides plus
« spiritueux » se substituent au soda pétillant, que les couleurs franches succèdent vraiment aux couleurs seulement pimpantes et que, sans n’avoir plus à être obligé de
prouver la pétulance de son savoir-faire, Guiraudie aille voir ailleurs s’il n’y est pas plutôt que d’aller voir, comme ici, s’il y est déjà, s’il y est toujours (et il y n’est
visiblement que trop bien).
La chanson est pourtant bien connue : “Hit the road Jack and don’t you come back no more”
|
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
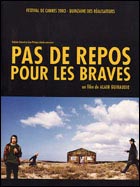






Écrire commentaire