|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.................................................................... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USA 2003 : Comment ça va (avec les images de la douleur ?)
Le film de Roger Avary comme celui de Spike Lee propose chacun à sa façon, non pas en marge ni hors de la forteresse hollywoodienne mais juste en retrait, dans un souci partagé
mais différemment traité de prise de champ et de distanciation effectuées au cœur du système, de regarder leur pays névrosé (The Rules of attraction) ou convalescent
(25th Hour) pour en garder une image, en sauver quelque chose qui tiendrait d’une croyance dans un réel retrouvé (2). De quel morceau palpitant issu de
quelles ruines agonisantes s’agit-il donc ? Une image qui est un regard in extremis partagé pour Avary, un corps et un regard qui in fine se réconcilient chez
Lee. Si le premier examine à la loupe les conditions post-modernes d’une possible re-lecture vivifiante d’une série d’images congelées dans leur statut consommé de clichés
arrêtés, le second préfère se donner le temps d’une prise de conscience pétrie de douloureuses contradictions à l’échelle individuelle qui trouve écho, à la fois dans sa propre
trajectoire de cinéaste qui n’intéressait plus depuis longtemps en pouvant désormais interroger ses errements personnels, et dans le destin d’une ville – New York – après la
catastrophe dont la violente inscription (Ground Zero) dit la permanence et la fragilité tant politique qu’ontologique qu’elle induit
The Rules of attraction surfe avec une franche virtuosité sur une esthétique archi-contemporaine de la déréalisation dont les principes formalistes plongent directement
dans une problématique de la réapparition possible d’un réel saisissable dans des images qui n’auraient plus seulement que leurs seuls codes à reproduire. Ce que, soit dit en
passant, rate non sans bravoure le gélifié Far from Heaven de Todd Haynes, trop compassé dans une stricte obédience au modèle sirkien décrété. S’attaquant à
l’iconographie d’un sous-genre récent hollywoodien, le teen movie, dénué de toute aura et de tout prestige mais représentatif des orientations idéologiques récentes (la
doxa du jeunisme et son corollaire immédiat, à savoir un consumérisme à tout crin et sans limite), que déjà Wes Craven avec Scream (1996) soumettait à une réflexion
maniériste autour du film d’horreur adolescent emblématisé par Halloween (1978) de John Carpenter, Avary opère moins une distorsion à la manière d’un Lynch (Twin Peaks
(3)) qu’un éclatement narratif valant pour une déconstruction du genre. Ce qu’il fit pour le sous-genre plus classique du film de casse (en cosignant le scénario de Reservoir
dogs (1992) de Quentin Tarantino et en réalisant à son tour Killing Zoe en 1994) et pour le film noir avec Pulp Fiction (1994) de Tarantino toujours, il le
fait dorénavant avec le teen movie genre American Pie dans son deuxième long métrage après huit ans d’absence des écrans et des travaux alimentaires pour la télé
(4).
Le film de Avary ainsi arrive à tracer une originale asymptote de type anthropo-technologique qui décrit en quoi la vie de quelques étudiants WASP de la Nouvelle-Angleterre se met de plus en plus à ressembler à une bande vidéo porno ou gore, voire à The Night of the living dead (1968) de George Romero (à tous égards œuvre matricielle de tout un pan du cinéma américain actuel). Vision asymptotique qui induit obligatoirement un espace, même si celui-ci se voit continûment diminuer sans pourtant jamais cesser d’exister, où le réel et le simulacre ne se rencontrent pas dans une mutuelle absorption qui signifierait leur néantisation à tous les deux et que n’ont de cesse de décrire depuis vingt ans des penseurs tels Jean Baudrillard ou Paul Virilio. On s’explique le narcissisme jouisseur et généralisé de l’entreprise, acteurs et concepteurs compris, qui, après coup, se trouve pleinement justifié. C’est parce qu’est pleinement investi cet espace-entre, véritable champ magnétique produit par ces deux pôles que sont positivement la vie et négativement sa réification visuelle et publicitaire, et que le cinéaste envisage ce champ d’attraction comme du désir circulant, même mal, entre les fragments de son récit-puzzle, que The Rules of attraction impressionne durablement et peut émouvoir.
Jouant du zapping, de la fonction « rewind » du magnétoscope (comme l’avait déjà fait Michael Haneke avec Funny Games en 1997) et des effets de désensibilisation produits par l’abus de cocaïne mais appliqués à la narration du film, le cinéaste réussit à être l’agenceur/séquenceur d’un dispositif plastique en quatre dimensions, chacune de ces dimensions étant un des quatre protagonistes du récit (Sean, Paul, Lauren et Victor), qui multiplie les possibilités de connexion ou d’embranchement sans qu’aucun de ceux souhaités par les personnages n’ait pourtant lieu. The Rules of attraction, s’il s’apparente à une sarabande grotesque lorgnant du côté des pantins pop et des masques grimaçants de A Clockwork Orange (1971) de Stanley Kubrick (cf. les reprises techno ou rap des classiques de Bach, Beethoven et Verdi témoignent de cette influence), se trouve être en fait une élégie mélancolique nimbée d’une réelle sensibilité, en cela très proche de Bande à part (1964) de Jean-Luc Godard (la visite au Louvre en quatrième vitesse se voit substituer chez Avary par une série d’haltes dans les capitales européennes filmée en caméra numérique hyper speedée et en débit recto tono d’une blancheur monocorde qui fait penser à une compression de César). Ce n’est plus le monde qui fait selon les termes d’un mauvais scénario bande à part mais mon plus proche (voisin de chambre, camarade de classe, copain ou copine) dont la vie est un film déjà vu cent fois, qui n’est pas raccord avec le mien et ne le sera jamais. L’utilisation de l’arrêt sur image avec agrandissement photographique et du split-screen participent logiquement d’un éloignement de tout accord d’objectivité, de tout consensus, au profit d’une subjectivité hypertrophiée, en roue libre et en circuit clos, accusant l’éloignement de sa propre expérience vécue dans une image qui n’est déjà plus redevable d’un moi particulier mais d’un réservoir commun d’icônes et de fétiches. « Typical » comme disent les protagonistes du film pour lesquels tout semble déjà avoir eu lieu, tout paraît être gagné par avance. La mascarade sarcastique et bouffonne qu’incarne une bande de dealers plus déjantés que ceux du compère Tarantino coule (la surchauffe visuelle, la neige remplaçant la cocaïne) et laisse ainsi s’épancher un fort sentiment nauséeux de tragique existentiel.
Réussissant la vraie première sitcom d’auteur ou adulte que Matthieu Kassovitz feignait mollement de représenter dans Assassin(s) en 1997 ainsi que la première adaptation d’un
livre de Bret Easton Ellis (à oublier l’épaisse transposition cinématographique de American Psycho d’il y a deux ans), Avary sait forcer l’intériorité d’images
subordonnées à la mécanique de leurs codes (sur laquelle d’ailleurs le cinéaste renchérit avec une outrance et une virulence assez rares) en multipliant les voix-off qui valent
autant comme preuve d’une déréalisation et d’un détachement décrits plus haut que la preuve aussi que des vies et des espoirs se jouent ou meurent là, chacun de leur côté, tout
juste les uns à côté des autres (6). C’est le suicide d’une jeune fille, le seul pied de sa courte vie, suicide filmé comme un shoot ou un happening, et dont personne ne saura
rien (on pense ici particulièrement aux travaux de la vidéaste suisse-allemande Pipilotti Rist qui ont aussi influencé David Lynch). C’est un soirée étudiante « fin du
monde » qui n’est que le lieu, excluant toute acmé ou résolution dramatique que le spectateur désirera en vain, de trajectoires simultanées qui ne sont décidément jamais
arrivées à se croiser, comme autant d’asymptotes relancées exponentiellement vers l’infini. Le drame se situe résolument ailleurs.
LES IMAGES DE LA REALITE
« Il y a cinquante ans, le grand homme d’État et poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor, appelait le monde à venir au « rendez-vous du donner et du recevoir ».
Les Américains savent ce qu’ils peuvent donner. Mais y a-t-il quelque chose qu’ils aimeraient recevoir ? » Immanuel Wallerstein in L’autre Amérique : les
Américains contre l’état de guerre
La confrontation est un beau sujet, et il n’en est pas d’autre dans 25th Hour. C’est d’abord Monty qui veut recueillir un chien abandonné par ses propriétaires au bord
d’une route alors que l’animal grogne sur tout ce qui tente de s’approcher de lui. C’est ensuite Monty toujours qui se livre, devant un miroir et dans une réminiscence de Taxi
Driver (1978) de Martin Scorsese, à l’exercice un peu forcé mais politiquement incorrect et bien sûr célinien en diable de haine déversée à l’encontre de toutes les
communautés composant la mosaïque new-yorkaise ainsi que de ses proches (7). C’est enfin son ami et prof de lettres Jacob (Philip Seymour Hoffman) auquel Monty remettra son chien
avant de partir en prison et qui ne peut affronter du regard le désir que suscite chez lui une de ses étudiantes qui en retour le nargue de ses plus perverses minauderies. Mais
c’est également Monty qui évite le regard de celle, Naturelle, avec qui il partage ses derniers moments de liberté, pensant à tort qu’elle l’a donné à la police. C’est enfin
l’autre meilleur ami de Monty, trader (encore !) aux origines irlandaises à l’instar de ce dernier, au nom significatif de Slaughtery (le massacrant !) (8), qui jalouse
maladivement l’amie de celui-ci et auquel Monty demandera de lui frapper le visage pour ne pas apparaître désirable pour les durs de la prison.
Les boursouflures et les fioritures ne sont pas toujours évitées mais encore une fois elles vont dans le sens d’une puissante dialectisation des discours ambiants. Lee lui-même,
accompagnant au plus près son personnage comme hier John Huston regardait Montgomery Clift dans The Misfits en 1960 (9), semble en conséquence vouloir se retirer d’une
ancienne posture « communautarisante » que Malcolm X en 1994 avait exemplairement, et ce jusqu’à l’ambiguïté, représentée. Posture qui dans sa version
intégriste a pu donner tant les fondamentaliste protestants américains que Ben Laden. On n’a pas semble-t-il insisté sur l’ambiguïté dont se nourrit la nouvelle phase de l’œuvre
de Lee, ce qui le rapprocherait de Orson Welles mais aussi de Jean-Luc Godard. La trahison par la petite amie, au-delà de tout jugement moral, n’était-elle déjà pas
l’aboutissement de A bout de souffle en 1959 ? Les faux-raccords lyriques font formellement bégayer les embrassades typiquement américaines de femmes et d’hommes élevés dans
l’idéologie la plus mensongère qui soit, celle d’un « tous ensemble » qui trouve dans « la croisade du bien contre l’axe du mal » professée par Bush sa
véritable résolution. Ce que filme le cinéaste, avec l’attentat du 11 septembre dans le rétroviseur, c’est le sol qui se dérobe sous les pieds de personnages ni meilleurs ni pires
que d’autres, c’est un socle de certitudes qui vole en éclats et qui prouve à quel point l’attentat peut servir de salutaire catalyse, de nécessaire catharsis. Do the right
thing, certes mais qu’est-ce qu’une « bonne chose » au vu d’un tel contexte ?
Dernière réussite, et non des moindres, d’un film gorgé comme un œuf de dires au risque de trop en faire : celle de représenter un dealer qui a vécu son activité comme parfaitement raccord avec l’apologie de la réussite individuelle promue par le néo-libéralisme actuel, à l’instar du couple du dernier film de Abel Ferrara, R’Xmas (2001), et qui se voit reprocher par son ami, golden boy travaillant à Wall Street à la captation frauduleuse de la valeur produite par les travailleurs américains (d’Enron ou de Worldcom par exemple) et spéculant sur le maintien des chiffres du chômage, sa petite fortune bâtie sur le malheur et la dépendance d’autrui ! Autre vingt-cinquième heure : celle des pros du boursicotage. Autre Ground Zero : Wall Street. L’attentat du 11 septembre aura été cette éraflure dont les stigmates (drapeaux, photos) et les récurrences symboliques parcourent tout le film de Spike Lee, du chien blessé recueilli par Monty à son visage tuméfié à la fin, crevant l’abcès d’un pays gâté de trop d’autosuffisance, croyant en son inébranlable puissance. La baudruche dégonflée, les images de Spike Lee recueillent la poussière de ces états (d’Amérique) de vide pendant que les corps titubants du film gonflent de tristesse, de désir, de rage, d’orgueil. Et qu’un hors-champ menaçant (la prison pour Monty, la guerre en Irak pour nous) ne cesse d’enfler alors qu’un autre (Wall Street) n’est toujours pas prêt de descendre de sa tour d’ivoire et d’apparaître pour ce qu’il est, un autre ballon de baudruche que la raison aurait dû déjà crevé.
LES IMAGES, LE REEL
Il y a du manque dans les images de ces deux films, et ce à tous les niveaux formels comme à tous les étages de la narration : des Twin Towers aux shoots, des certitudes aux désirs, jusqu’aux corps et aux images elles-mêmes qui n’ont plus qu’à batailler contre la facticité comme base de départ pour accéder, par leur propre « absentement » (Jean-Luc Nancy), au sens lui-même. C’est une humanité qui manque à ce qu’elle n’a pas réussi à devenir, à savoir une réalité. Ce vide qui œuvre au cœur de ces images offre en retour à celles-ci de ne pas seulement être le reflet mimétique de ce qu’elles dénoncent. En sus, elles valent aussi pour être le rendu visible de ce qui rate dans les circuits d’une économie totalitaire qui, dominant le monde entier, inclut les dominants eux-mêmes, étudiants WASP, traders, profs, trafiquants. Le paradis promis par les dogmes du consumérisme et du néo-libéralisme est révélé dans sa nature même de simulacre, de drogue de synthèse, d’artefact. Far from Heaven… So close to Irak.
Notes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...



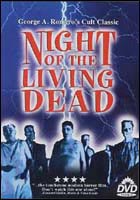




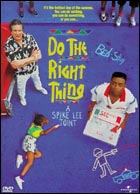


Écrire commentaire