"L'Homme sans passé" (2002) d'Aki Kaurismäki
It's a Wonderful World

SYNOPSIS : Un ouvrier soudeur débarque dans la grande ville d’Helsinki avec l’espoir de décrocher un emploi. Ses plans de carrière se trouvent compromis quand au détour d’un square, il croise trois malfrats qui le volent et le frappent, le laissant inconscient et dans un sale état. Miraculé, il se réveille sans aucun souvenir de son identité.
Texte tiré du site : http://www.objectif-cinema.com/analyses/132.php
« Nous existons encore. Mais ce n’est qu’un demi-succès. »
(Ernst Bloch, Héritage de ce temps, coll. « Critique de la théorie », 1978)
M., interprété par cette svelte et impavide armoire à glace qu’est Marku Peltola, arrive par le train du soir. Il s’endort avec sa valise au bout d’un banc éloigné des
grands axes urbains d’Helsinki. Trois loubards littéralement surgis out of the blue d’on ne sait quel hors champ le frappent et le laissent pour mort, sans oublier de le dépouiller de tous
ses biens (et peut-être le plus précieux, non tant son identité sociale que sa mémoire intime). Déclaré physiquement irrécupérable puis trépassé dans l’hôpital qui l’a recueilli, M. se réveille
soudainement, se réajuste son nez brisé et prend la fuite…pour atterrir un peu plus tard, réfugié d’entre les réfugiés, dans un bidonville constitué vaille que vaille en rive de la capitale. Tout
cela n’aura pris que quelques plans crayonnés d’un trait sûr. Il essaiera et réussira, malgré le dénuement matériel qui le frappe lui et tous ceux qu’il côtoie dans le bidonville, à refaire sa
vie sans l’aide d’un passé qui de toute façon ne correspond plus avec ce qu’il est devenu et ce à quoi il aspire désormais.
A la lecture du synopsis du nouveau film d’Aki Kaurismäki, acclamé à juste titre lors du dernier festival de
Cannes, on comprenait rétroactivement que, peu ou prou, le cinéaste finlandais avait toujours raconté la même histoire. Réduite à sa plus simple expression, elle n’est rien d’autre que celle d’un
sursis, exemplairement théorisé dans le scénario de J’ai engagé un tueur en 1990 dans lequel Jean-Pierre Léaud luttait contre un fatum de film noir que désigne le titre et qu’il
avait lui-même programmé dans un geste terminal de désespoir. La délégation par le personnage de son suicide (le tueur à gages) et sa reprise en main face à l’implacable mise en branle de cette
machine de mort avaient la nette vertu de démontrer que sous le masque pince-sans-rire du pessimiste lucide se cache aussi un incurable optimiste, un tendre opiniâtre.

Cette lutte équivalait à la fois, du côté du personnage, pour un ressaisissement de soi vital qui prenait la forme d’un amour à préserver comme, du côté du metteur en scène, pour le souci constant de n’obéir passivement ou aveuglément ni aux diktats de son scénario ni à ceux des grands récits quels qu’ils soient (mythiques, littéraires, idéologiques, cinématographiques)… Même s’il ne peut en faire l’économie pour une œuvre qui regorge moins d’adaptations littérales que de variations littéraires (Dostoïevski dès son premier film avec Crime et Châtiment en 1983, Shakespeare au moins deux fois avec Hamlet goes business en 1987 et Ariel en 1988). Parce que justement c’est une œuvre qui ne pratique pas l’amnésie. De l’affiche de L’Argent de Robert Bresson, présente dans Au loin s’en vont les nuages en 1996, à la photographie du regretté Mätti Pelonpäa, acteur et ami disparu de Kaurismäki, dans ce film-ci, nombreux sont les signes de cette évidence.

Cette tension qui prenait donc la forme sursitaire (retarder le moment où il faut rentrer à la maison et ressortir maman du placard, en gros réintégrer le circuit :
c’est le récit de Tiens ton foulard Tatiana en 1994) était au cœur du cinéma de Kaurismäki. Jusqu’à Juha, tentative la plus radicale du cinéaste à ce jour. Ce film limite de 1999
invalidait complètement la continuation du principe kaurismäkien de sursis en vigueur dans le reste de l’œuvre (une mort à la Stroheim, implacable et sordide, emportait le personnage) qui, chez
Hans Christian Andersen, a par exemple donné le conte de La petite Marchande d’allumettes (une allumette craquée pour quelques secondes de combustion de vie et de rêve chaleureusement
entremêlés, jusqu’à ce que la boîte soit vide, synonyme d’une mort victorieuse après avoir été tant repoussée) qu’évidemment le cinéaste ne pouvait pas ne pas avoir lu (il en réalisa une lecture
personnelle avec La Fille aux allumettes en 1989, l’un de ses plus beaux films). Juha consignait alors jusque dans sa forme même (image en noir et blanc et bande-son quasi muette),
via l’énième adaptation du classique parmi les classiques de la littérature finlandaise de Juhani Aho (Mauritz Stiller en fit une adaptation cinématographique en 1921 intitulée Johan à travers
les rapides), la conclusion d’un cycle. Le sursis prit donc fin au moment où le cinéaste joua à fond le rôle du fidèle adaptateur (du gentil toutou si l’on veut puisqu’il aime tant les chiens
et la fidélité qu’ils incarnent, et dire cela n’a strictement rien de péjoratif) dont le réel talent fut de vérifier l’actualité/acuité du récit de Aho, de voir s’il marchait toujours même plongé
dans un régime représentatif contemporain, comme de boucler (le cercueil d’)un siècle de cinéma.
L’Homme sans passé conte dorénavant l’histoire d’un retour, plus précisément d’une résurrection, orientant probablement le
cinéma de Kaurismäki vers une nouvelle direction. Résurrection qui trouve ici son idéal contrepoint dans la figure de l’amnésie qui frappe le héros à la suite de son agression (il recouvrira la
mémoire en fin de film) et qui accuse une pluralité de niveaux de sens, comme on commence à s’en rendre compte. Du passé faisons table rase comme le dit un vers de L’Internationale
d'Eugène Pottier. Autrement dit : il y a bien un passé (celui de la crise domestique et du chômage pour M.), il y a bien un présent qui ne cesse de durer (celui de la misère des
laissés-pour-compte du capitalisme) mais cela ne doit pas empêcher d’aller de l’avant. La perversité du dispositif de Juha était justement de montrer la rigoureuse inutilité, voire la
vanité du strict retour des formes, telles quelles, d’un cinéma muet bel et bien achevé mais dont les leçons (ce que Paul Virilio a nommé un jour « le grand héritage ») attendent d’être toujours entièrement tirées, vanités conjointes de celle du protagoniste du film dans son
refus archaïque et tragique de toute modernité (l’émancipation de sa femme et son départ à la ville, même si cela prenait la forme la pire de l’exploitation - la prostitution). En ce sens
l’amnésie ici ne sera donc pas l’opérateur d’un passé à rattraper, d’un retard à combler ou d’un sursis dont il faudrait jouir avant qu’il ne cesse, mais la possibilité accomplie pour un être de
se refaire en mieux.

Histoire exemplaire. C’est d’ailleurs l’exemplarité du récit qui touche le plus dans L’homme sans passé : sa (relative) linéarité n’a de sens que pour la
rectitude qu’elle implique et pour la mise en valeur de ce seul souci, celui de toucher en plein cœur de l’expérience humaine. L’identification ne s’effectue alors que là, non pas grâce à la
facilité d’une expressivité dans le jeu des acteurs dont le cinéaste s’est toujours prémuni à juste titre, mais dans la reconnaissance émue que ce qui se trame là nous interpelle, nous concerne,
nous regarde. Un peu comme dans Le Pianiste de Roman Polanski dans lequel on peut aussi trouver des échos insistants de la philosophie d’Emmanuel Levinas basée sur la nécessité de poser
autrui comme lien qui me reconduit (quand je n’y suis pas ou plus) au monde. Le héros kaurismäkien (dé)choie souvent, mais pour toujours se relever (et ce redressement semble conquis et définitif
au vu de L’Homme sans passé). S’il plie, comme le dit une fable célèbre de La Fontaine, il ne rompt pas. La droiture, et physique et morale, l’une ne marchant pas sans l’autre, c’est aussi
le réel sujet de films aussi différents que leur importance est indéniable : Ouvriers, Paysans de Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet, Highway de Sergueï Dvortsevoy, Le Bassin de J.W. de
João Cesar Monteiro, Je rentre à la maison de Manoel de Oliveira.
Conséquence : le sujet moral du cinéma physique de Kaurismäki (qui pourrait prendre pour titre entier le couple paradigmatique que
proposait Simone Weil et dont la tension règne partout chez lui : La Pesanteur et la Grâce) a naguère été, est encore et sera toujours la dignité. Quelle que soit la réussite de son
expression, de ses réalisations. Cette esthétique du maigre, du peu, du chiche (à prendre également dans le sens de « et si
» : et si représenter un fragment dérivant de la misère humaine occidentale - un bidonville à Helsinki -, bien évidemment dégraissé du misérabilisme
qui est intrinsèque au sujet, pouvait nous réconcilier avec le monde et, pourquoi pas, avec l’idée de bonheur sur terre ? Chiche ?) noue une foncière solidarité entre un film
comme « trouvé à la ferraille » (pour parler comme le Jean-Luc Godard de Week-end en 1967) et des bouts d’humanité en train de se bricoler des jointures de (sur)vie.

Ce rafistolage est tout autant induit par le métier de M. (il réalise qu’il a été soudeur) qu’il appartient à l’univers d’un homme encombré d’objets hétéroclites et
improbables (voir ou revoir sur ce point le documentaire que Guy Girard a consacré en 2000 à Aki Kaurismäki pour la série Cinéastes de notre temps, mais également Tiens ton foulard
Tatiana et son héros, un garagiste à la Godard) et admiratif jusque au bout des ongles du cinéma de Robert Bresson (« Ce qui se passe
dans les jointures » insistait ce dernier dans ses Notes sur le cinématographe, Gallimard, Folio, 1988, p. 30). Rafistolage,
résurrection, amnésie : le cinéma de Kaurismäki, à l’instar de celui de Resnais, Duras, Garrel, Suwa, à l’image de tout le cinéma moderne, vient
ontologiquement après coup. Après l’explosion, la mort, l’oubli : chaque plan kaurismäkien inscrit dans le fragment d’espace ainsi élu par le découpage un présent mat et lourd d’une onde de
choc qui dure encore (l’après seconde Guerre mondiale, l’épuisement des idéologies révolutionnaires, la crise économique), un manque ou une absence qu’il ne semble pas pouvoir seul formuler ou
combler. D’où le statisme et le mutisme généralisés dans son œuvre.
Cette reconquête, même malingre, même ténue, d’une intégrité (physique, morale, sociale, politique, artistique) bafouée ou brisée prend
donc dans L’Homme sans passé la forme d’une amnésie temporaire. Celle-ci possède au moins trois significations différentes et complémentaires dans le film.
Diégétiquement d’abord : si le film emprunte certains de ses éléments figuratifs aux codes du film noir (le costume lamé
du héros, le hold-up à la carabine, le suspens identitaire, l’avis de recherche, les ruelles sombres et mal famées, mais aussi des bandages et un plan en caméra subjective qui clignent
explicitement de l’œil du côté des Passagers de la Nuit de Delmer Daves avec Humphrey Bogart), il se pose aussi comme l’antithèse de ce type de film (par exemple Somewhere in the
night de Joseph Mankiewicz et sa quête échevelée du recouvrement d’une mémoire traumatisée par la guerre et ouvrant directement sur une perception bergsonienne du temps). Premier décalage
opéré subtilement par le film (et il y en a d’autres) : cette amnésie n’appelle à sa suite ni poursuite ni corrélativement suspens, Kaurismäki n’étant fondamentalement pas un cinéaste de
l’action mais plutôt de la dédramatisation (même si son film implique forcément, en tant que mise en scène d’un récit, une dramaturgie concrète). On a parlé d’ontologie plus haut et pour parler
comme Jean-Paul Sartre, chez le cinéaste finlandais, l’existence précède l’essence. Prédominerait l’être-là plutôt que l’Idée.

Politiquement ensuite : on imagine très bien (la stratégie est identique en France ou aux États-Unis) que les autorités finlandaises ont
volontairement tiré un trait sur ce pan d’humanité que filme le cinéaste, comme échoué au bord de l’eau lourde des ravages du capitalisme, chômage hier (Au loin s’en vont les nuages),
paupérisation aujourd’hui. Et le constat est déjà ancien : « La privation de travail, en même temps qu’elle constitue pour le
chômeur une régression sociale, engendre, au bout d’un certain temps, "une sorte d’intoxication" qui exige une complète réadaptation. La privation prolongée du travail est véritablement une
menace pour la santé mentale de l’individu » (Georges Friedmann, Le Travail en miettes, Gallimard, coll. « Idées », 1964, p. 234). La dédramatisation vaut également pour l’orientation de la logique
représentative à l’œuvre dans le film : questionner moins cette réalité que le regard que l’on porte sur elle. Deuxième décalage : la nécessité de la stylisation kaurismäkienne,
induisant une distanciation synonyme de décence et de pudeur, n’entre en conflit avec ses propres principes de frontalité et de sèche exposition que pour pouvoir produire un axe de vision en
biais ressortissant autant de la visibilité originale de ce monde que de notre perception schématique de celui-ci.
Artistiquement enfin : on avait fini par oublier Kaurismäki lui-même et de le compter parmi les
plus grands cinéastes contemporains vivants (Juha n’avait guère attiré l’attention, ou alors de pure politesse). Revenant de l’oubli dans lequel l’avaient cantonné son silence (presque
quatre ans et quelques velléités de suicide évaporées dans l’alcool) et l’industrie cinématographique (une distribution au compte-goutte), son cinéma têtu et tenace, borné et solitaire, reparaît
pour nous dire que son horizon de toujours, L’homme sans passé en atteste, est celui de l’utopie communautaire. Et l’air fordien que le film arbore en fait un vague cousin, finlandais et
contemporain, des Raisins de la Colère (1940) de John Ford.


Et ce rêve d’un être-ensemble, justement récompensé (par « les professionnels de la profession ») d’un Grand Prix et d’un Prix de l’interprétation féminine à Cannes à Kati Outinen, probablement suivi d’une bonne carrière commerciale, est assez
réjouissant. « Il arrive encore souvent que les petites gens se lèvent de table rassasiés. Ils y arrivent parfois, tout au plus, et
difficilement. » (Ernst Bloch, opus cité) Le succès permettra peut-être enfin à Kaurismäki, après vingt ans de résistance à
bricoler un peu de cinéma dans son coin, d’être pour une fois rassasié, lui qui s’applique tant pour chaque film à mettre en scène de chiches repas comme s’il s’agissait là de plantureux festins.
Il pourrait alors commencer à ressembler à Claude Chabrol si, d’avoir connu la faim et de continuer à boire, on ne s’en
remet peut-être jamais : « Mais celui qui touche un maigre salaire n’échappe jamais au calcul et il fait rarement des
bonds. » (Ernst Bloch, op. cit). D’être à nouveau vivant et prêt au combat plutôt que sursitaire d’une existence dont de toute
façon on a déjà été dépossédé, c’est privilégier l’instant pointu et décisif - le kaïros - à la viscosité de la durée. A y regarder de plus près finalement, ce tabassage est
paradoxalement une manne pour le héros. Et la douce pluie qui mouille ses vêtements permet aussi à son modeste potager de se fortifier.
On notera en conséquence que la mise en scène kaurismäkienne semble s’être désormais assouplie, relâchée, désamidonnée (après cette cure de rigueur que fut Juha). Plus cool, elle
ouvre grand ses plans aux espaces clairs et ouverts (ce n’est pas encore du cinémascope, mais on y vient) ; elle laisse traîner ces mêmes plans au gré de quelques travellings au bord de
l’eau (parfois tournés au steadicam), les agrémentant de furtifs fondus au noir et de recadrages discrets qui adoucissent les jointures prévues par le découpage. Cette mise en scène demeure
malgré tout profondément vissée sur trois ou quatre principes de fer et invariants :
- un statisme des postures et des scènes délibérément anti-naturalistes (comme on le dit très clairement dans le film, « l’école dramatique, c’est en face ! »), qui déplait au public français lorsque le cinéaste l’est aussi (Choses secrètes de Jean-Claude Brisseau) mais l’amuse, éloignement géographique oblige, lorsque le cinéaste est finlandais (c’est aussi la limite d’un art qui veut, comme d’ailleurs les derniers films de Shohei Imamura, faire œuvre populaire : le pittoresque) ;
- une colorisation pastel, à la Douglas Sirk, des espaces du quotidien soumis à une théâtralité de pure cinéma, volontairement
artificielle ;
- une poétisation souvent loufoque des dialogues (entre le surréalisme et la langue fleurie de Queneau) dont l’énonciation monocorde et vive (presque à la Howard Hawks) camoufle intelligemment la surprise que constitue un tel texte déclamé dans de telles situations (Kaurismäki ne capitalise pas sur ses
dons d’auteur). A ce propos, Charles Tesson parlait très justement dans sa critique de Au loin s’en vont les nuages d’une forme originale d’« humour syncopée » (Cinémathèque n°11, 1997, p.04 à 15).
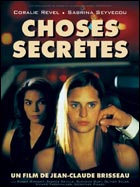
Kaurismäki ménage ainsi et de mieux en mieux au sein de chaque séquence de son film une triple approche simultanée (aucune n’empiétant sur l’autre puisqu’elles sont indissociables, toutes fondues dans le même regard, celui du metteur en scène). A savoir un comique à froid du genre de Buster Keaton (à équidistance du cinéma de Kaurismäki, nous trouverons donc celui de Takeshi Kitano et celui d’Elia Suleiman), un lyrisme inspiré des mélodrames de Douglas Sirk mais tenu sur un mode mineur et plus discret (bien que la bande son soit comme souvent, sur le versant musical, abondante), enfin une opération de réduction minimaliste et d’abstraction découlant directement de l’œuvre de Robert Bresson, on l’a dit, mais aussi de Yasujiro Ozu (clin d’œil : M. mange japonais dans un des derniers plans du film). Ce qui a pu influencer Akhtan Abdykalikov pour son film Le Singe. Autre clin d’œil ? : M. croise sur un chantier des ouvriers kirghizes, Kaurismäki reconnaissant ainsi chez Abdykalikov ce que ce dernier a précédemment reconnu chez lui.
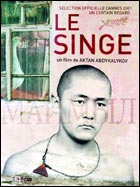
Et tout cela donc pour produire quoi, si ce n’est un épuisement sensible du sens commun que chaque scène contient potentiellement. C’est le jeu conscient que pratique le cinéaste avec le spectateur, s’amusant des décalages (productifs d’un sens, d’une vue inédite) sur les attendus clichés portant sur la misère et sur les archétypes constituant l’ossature de référence des films de genre dont il emprunte sciemment, en les détournant pour les agencer à sa façon, nombre d’éléments. Le sens commun, épuisé par la mise en scène kaurismäkienne qui par l’entremise de ses personnages lance des propositions là où nous n’attendions que de pâles confirmations, tombe à l’égal des corps kaurismäkiens pour que se lève, à l’instar de l’esthétique rossellinienne, une autre image littéralement inattendue, forcément surprenante.
Dénuder la misère sociale et lui proposer d’autres vêtements pour qu’elle apparaisse comme jamais auparavant, digne sans cesser d’être
révoltante, mais aussi représenter un amour « at first sight » auquel on ne
peut pas ne pas croire et auquel le cinéaste donne tout son crédit (en redonnant à ce terme son sens initial de credo : c’est à la question de la croyance dans la
représentation que s’attache L’Homme sans passé) parce que le cinéaste dit à nouveau, à demi mot, à celle qu’il filme (Kati Outinen) qu’il l’aime, c’est à la fois permettre :
- que l’on puisse voir cette pauvreté ou cet amour, tous deux filmés avec les mêmes moyens et une égalité de traitement qui force le respect, tels qu’ils sont (on a déjà signalé le caractère ontologique du cinéma kaurismäkien, on le répète : n’existe chez lui que ce qui est, à un point présent – le plan – d’un temps qui dure, temps de la douleur et de l’épuisement), c’est-à-dire tels qu’on ne les avait jamais vus ;
- et que la nouvelle image obtenue, image ayant fait peau neuve, puisse mettre à jour les structures sociales répressives qui ruinent la solidité des sentiments et entretiennent la misère plutôt
qu’ils ne la combattent (Armée du Salut et ANPE comprises, mais bien sûr aussi les banques et les entreprises poussées à la faillite qui produisent une précarisation de longue durée, crime qui
profite aux sociétés de gardiennage, police privée n’avouant jamais son nom). Kaurismäki n’est donc absolument pas un idéaliste éthéré mais un réaliste forcené qui donne du style (la connaissance
intellectuelle) au regard (la connaissance perceptuelle) qu’il a et qu’il nous donne sur le réel.
« Pour peu qu’on ne se laisse pas arrêter par l’aspect extérieur, mais qu’on pénètre dans les ruelles ou la cour d’un bidonville, on aperçoit
immédiatement les signes d’une activité humaine organisée (…) Contrairement à une opinion aussi fausse que répandue, le bidonville n’est pas un tas de baraques informes et indignes de
l’homme. » (Colette Pétonnet, On est tous dans le brouillard, Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Coll.
Références de l’ethnographie, 2002, p. 61). C’est, croit-on, un peuple émietté, déclassé, déporté en bordure du pôle industriel du pays (constat de L’Homme sans passé : la classe
ouvrière de Shadows in Paradise n’est plus), sans récit ni chanson (autre constat : La Vie de Bohème ne semble même plus permise), sans théâtre ni bal, sans style ni image
autre que l’odieux discours d’une charité qui s’enquiert davantage de ce qu’elle veut, fait et contrôle plutôt que de ceux qui en font les frais (leur misère est la même, c’est juste que la mort
est un peu plus longue à venir). Et ce peuple se voit restauré (dans) ses droits, via l’action du personnage au cœur du bidonville dans l’espace diégétique du film, et via la mise en scène du
cinéaste dans l’espace esthétique qu’il a circonscrit pour son film. Celui de vivre et d’être heureux : la joie est le carburant nécessaire pour des lendemains qui, pour sûr,
chanteront.

Cette image restaurée après avoir été laminée par la coercition administrative (voir la scène hilarante, vaguement kafkaïenne, de l’avocat au commissariat) est à l’instar du juke-box récupéré dans une décharge par le placide M. Remarquons qu’il est un M. de moins en moins maudit puisque L’Homme sans passé fait doublement référence au film de Fritz Lang et à l’univers marxiste et stylisé de Bertolt Brecht dont la verve sociale et distanciée avait justement influencé ce dernier pour M le maudit. Cette image est pour, est celle d’un peuple recomposé (le protagoniste fait d’ailleurs moins penser à L’Homme invisible de James Whale qu’à la créature de Frankenstein, filmée également par Whale). Et elle n’a rien à voir avec une quelconque transcendance impliquant soumission et servilité à un pouvoir et une vérité située au-delà et sur lesquels nous n’avons aucune prise (significativement, l’Armée du Salut se met à chanter pour le plaisir de tous des tubes rocks tombés en désuétude) mais est elle-même, comme le distinguait parfaitement Ernst Bloch, transcendante (et donc non transcendantale). C’est-à-dire signifiant cette révolte qui dynamise l’être humain afin de lui éclairer les raisons de ce qui le mine en lui ouvrant les portes du possible et du futur.

Ce « transcendant », nourri d’un « pas encore » (c’est aussi le manque et l’absence que nous devinions précédemment au sujet du
plan kaurismäkien) qui signifie aussi un " pour bientôt ", ouvre la voie de l’utopie réalisatrice, " Terre promise " qui trouvait sa conjonction virtuelle au carrefour du
diptyque rock Les Leningrad cowboys go to America / Les Leningrad cowboys rencontrent Moïse (l’Amérique mythique et sa bible gravée dans le rock) et déniche son actualisation dans la
friche industrielle ré-affectée, repeuplée, ressoudée du film.
Même s’il s’agit peut-être là du récit, drapé de l’étoffe dont sont faits les rêves, d’un homme qui a cessé de vivre dans un lit d’hôpital anonyme, de l’utopie post mortem d’une ombre se rêvant
au paradis mais qui aurait aussi le pouvoir de ressusciter les cadavres. Et de faire que le réel se mette enfin à ressembler à un conte de fée promis pour demain. L’onirisme tranquille du film,
relativement proche d’un Jean Vigo pour qui poétiser le réel n’empêchait pas celui-ci de demeurer au contraire bien réel, n’aurait pas alors d’autre origine.
Cette image transcendante, instance d’un « principe espérance » (Ernst Bloch)
et de désignation non plus d’un après-coup mais d’un « meilleur après », image
vivante de cet « esprit de l’utopie » (idem) promis à souffler et
insuffler, enfler et gonfler les bannières d’une humanité qui est l’image radieuse de l’avenir de la nôtre, rencontre un mélancolique écho dans cette fin digne du cinéma de Nicholas Ray (les
personnages nous tournent le dos : leur amour, comme dans Johnny Guitar, est leur affaire ; l’avenir leur appartient et un train est là pour pudiquement nous l’affirmer) comme
dans ce blues déchirant de Blind Lemon Jefferson qui semble apaiser les personnages, prêts à relancer leur petite machine de résistance et de lutte. Ce qui finit de faire de L’Homme sans
passé le Dodes’Kaden de son auteur. Ainsi que l’un des très rares films populaires à notre connaissance qui peut supporter la comparaison, parce qu’elle est dénuée de toute ingénuité,
avec It’s a wonderful world de Louis Armstrong. Et finalement, c’est le fantôme persistant, de Frank Capra si l’on veut, mais surtout de Charlie Chaplin qui, très présent ces derniers temps (Suleiman encore, la ressortie du Dictateur), (re)vient à notre rencontre. Et participe de notre
actualité.
« Quelque chose devient autre. Venu d’en bas un choc se propage »
(Ernst Bloch, Héritage de ce temps, coll. " Critique de la théorie ", 1978).

15 novembre 2002
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
Écrire commentaire