Des nouvelles du front cinématographique (29) : Les Moissons du ciel de Terrence Malick
Le Grand incendie de l'utopie

Tree of Life, le nouveau long métrage attendu de Terrence Malick (avec entre autres les acteurs Brad Pitt et Sean Penn) était promis pour le Festival de Cannes de cette année. Mais, pour des raisons de timing (le montage définitif du film n’était pas achevé au moment de l’annonce officielle de la sélection), il n’a pu être présenté, au grand dam des admirateurs de l’un des cinéastes étasuniens les plus importants et singuliers qui soit. On peut d’ailleurs imaginer, sans guère se tromper, que la présence de ce film aurait dopé une sélection cannoise plutôt décevante (si ce n’est la Palme d’or attribuée au cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul pour Oncle Bonmee qui se souvient de ses vies antérieures dont on espère parler lors de sa sortie prévue le 1er septembre prochain). En attendant également Tree of Life annoncé d’ici la fin de l’année 2010, on devra impérativement se jeter sur la ressortie en copie neuve remasterisée de Days of Heaven (Les Moissons du ciel en français), deuxième long métrage réalisé par un cinéaste alors âgé de 35 ans, et dont l’œuvre ne compte aujourd’hui que quatre films (exception faite du court métrage Lanton Mills en 1969, et donc aussi de Tree of Life). Badlands (La Balade sauvage) en 1974, ensuite Days of Heaven, The Thin Red Line (La Ligne rouge réalisé vingt ans après, en 1998) et The New World (Le Nouveau monde) en 2005. Nous avons bel et bien affaire à une œuvre solitaire, rare, parcimonieuse, et dont les films font à chaque fois l’événement, tant parce qu’ils offrent l’expression artistique renouvelée d’une vision esthétiquement souveraine, que parce qu’ils reposent sur une économie capable de subordonner et maîtriser à son avantage les contraintes de l’industrie hollywoodienne. En ce sens, le seul cinéaste auquel on peut comparer Terrence Malick, c’est Stanley Kubrick, dont les délais entre les films, toujours plus longs, auront également témoigné d’une double volonté d’accomplissement artistique et de puissance d’indexation des logiques hollywoodiennes nécessaires à un pareil accomplissement.
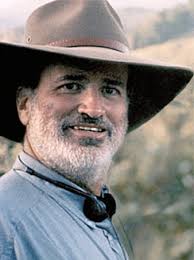
Capable de faire accepter à ses producteurs (Bert et Harold Schneider pour la Paramount avec Days of Heaven) des dépassements faramineux de budget (la réalisation de ce film ainsi que son montage ont duré deux ans, coûtant un million de dollars supplémentaire à Bert Schneider qui dut alors hypothéquer sa maison) afin de disposer du temps suffisant pour le tournage et le montage, de demander aux services promotionnels des studios d’en faire le moins possible (aucune photographie du cinéaste au travail n’est ainsi disponible), comme d’obtenir le « final cut » (le montage final préservé des interventions intempestives des producteurs et autres représentants des studios), Terrence Malick, davantage encore que Clint Eastwood et Martin Scorsese aujourd’hui, représente le parangon (ultra-rarissime à Hollywood) du cinéaste artiste, dont chaque film se propose d’être le chef-d’œuvre du genre dans lequel il s’inscrit (le road-movie dans Badlands, la guerre dans The Thin Red Line d’après le roman de James Jones publié en 1962 et édité un an plus tard en France sous le titre Mourir ou crever, l’archéo-western avec The New World d’après la légende de Pocahontas, et le film fantastique – voire de science-fiction – que devrait apparemment être Tree of Life). Avec Days of Heaven, ce sont déjà, deux ans avant Gates of Heaven de Michael Cimino (on remarquera l’homologie des titres), les ultimes feux d’un Nouvel Hollywood qui sut joyeusement alors, entre 1966 (avec Bonnie and Clyde d’Arthur Penn) et 1980, instiller une pagaille libertaire et créatrice au sein de l’industrie cinématographique étasunienne au nom de la double valorisation de la critique sociale et de la politique des auteurs. Cette époque quasi-utopique, que l’on ne cesse pas de redécouvrir ces dernières années, est celle qui permit alors à Terrence Malick, l’un des derniers grands héritiers de cette période faste, de passer – et avec quel bonheur – du journalisme (pour Life et le New Yorker) au cinéma.
1/ L’heure bleue de Nestor Almendros

Si l’on a précédemment évoqué The New World (peut-être le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre du cinéaste) en désignant le genre auquel il est censé appartenir (l’archéo-western, autrement dit l’époque initiale de la conquête de l’Amérique du Nord au 17ème siècle avec l’établissement de la colonie de Jamestown), Days of Heaven (à l’instar de Gates of Heaven de Michael Cimino d’ailleurs) représente alors la fin de l’épopée westernienne (homologue à la fin de cette autre épopée qu’aura signifié le Nouvel Hollywood), puisque le territoire n’est plus envisagé comme le plan de consistance d’une bataille à mener contre cette forme ultime d’altérité que figuraient alors les peuples amérindiens. Fin des utopies. Nous sommes en 1916 : le génocide est terminé, l’arraisonnement du territoire est accompli, l’édification des États-Unis identifiés à tout le continent américain (c’est bien là le symptôme d’un impérialisme qui s’exprime aussi sur le plan terminologique) est parachevée. L’industrialisation dont rend compte le film, qui s’ouvre sur les usines sidérurgiques de Chicago pour se poursuivre avec le moissonnage des blés au Texas nécessitant le recrutement de centaines de bras (souvent des migrants, Italiens, Chinois, en provenance d'Europe de l'est ou descendants d'esclaves, et que ramasse la citation sous forme de projection du film de Charlie Chaplin, L'Emigrant réalisé en 1917) et l’emploi de machines toujours plus mécanisées, manifeste la mainmise de la « rationalité instrumentale » (Max Weber) propre à la civilisation occidentale sur le milieu naturel environnant dont les plis et replis, à l'exception des animaux sur lesquels nous reviendrons, n’abritent plus le moindre signe de présence des peuples autochtones qui ont vécu à cet endroit-là pendant des siècles. Il faudra attendre précisément The New World pour voir, comme on ne l’avait jamais vu au cinéma, ce que pouvait signifier qu’être issu de ces peuples peu de temps avant leur rencontre brutale avec les colons anglais (et plus généralement européens). Terrence Malick, né en 1943, qui est né à Ottawa dans l’état de l’Illinois, et dont le père était d’origine libanaise, a suivi ce dernier quand il est parti travailler à Waco pour une compagnie pétrolière texane. Entre l’extraction du pétrole et les surfaces gigantesques dévolues à l’exploitation agricole intensive, le futur cinéaste a disposé du temps nécessaire pour conformer sa sensibilité perceptive à la puissance des paysages façonnés par la praxis humaine qui se sont présentés devant lui, tels qu’ils ont accompagné son enfance, et tels qu’ils ont été retraduits dans le champ des arts plastiques (surtout la peinture et le cinéma). Pour rendre compte de cette puissance d’imprégnation cosmique qui innerve tout son cinéma, Terrence Malick a fait appel à deux grands chefs opérateurs, l’étasunien Haskell Wexler (qui est né à Chicago dans l’Illinois, et qui a réalisé entre autres l’image de America, America en 1963 d’Elia Kazan et One Flew Over the Cuckoo’s Nest en 1975 de Milos Forman), et le français Nestor Almendros (à qui l’on doit les splendides vues des films les plus solaires d’Eric Rohmer, La Collectionneuse en 1966, Le Genou de Claire en 1972, et Pauline à la plage en 1984 - mais aussi Cockfighter en 1974 de Monte Hellman, autre héraut du Nouvel Hollywood, et encore Mes petites amoureuses en 1974 de Jean Eustache).

Quand on voit Days of Heaven, on se dit que la réception par Nestor Almendros de l’Oscar de la meilleure photographie pour ce film qui reçut également, entre autres, le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1979, ne souffre d’aucune contestation. Prix légitime qui reconnaît l’hypersensibilité du travail accompli par un directeur de la photographie alors atteint d’un début de cécité, et qui était alors contraint à travailler à partir des polaroïds que lui soumettaient ses assistants. Le choix de Nestor Almendros confirme le désir « auteuriste » (pour parler comme le sociologue Philippe Mary) du cinéaste, au sens où celui-ci, en sollicitant l’un des chefs opérateurs les plus affiliés à la Nouvelle Vague française (Nestor Almendros a également travaillé avec François Truffaut et Barbet Schroeder), inscrit explicitement sa démarche dans une logique pour laquelle prime le discours artistique sur les autres discours (narratif ou commercial, populaire ou spectaculaire) déterminant le champ habituel de la pratique cinématographique. D’autre part, il s’agissait de rendre manifeste, avec rigueur et minutie, de l’absence à l’époque de la fiction de toute luminosité issue d'installation électrique. Tourné en lumière naturelle, et surtout en privilégiant cette fameuse « heure bleue » (qui donnera le titre du premier court métrage de Quatre aventures de Reinette et Mirabelle d’Eric Rohmer en 1987, photographié par Sophie Maintignieux inspirée par le travail de Nestor Almendros), qui ne dure en fait qu’une vingtaine de minutes, et qui désigne cette lumière d’après la disparition du soleil et avant la tombée de la nuit, Days of Heaven se veut un film solaire pour autant que le soleil est ici sur le point de se coucher, de disparaître. « A cause de quoi la lumière » demande-t-on dans Film socialisme (2010) de Jean-Luc Godard : « à cause de l’obscurité » répond-on en toute logique dialectique. Lumière entre chien et loup, lumière des limites incandescentes du jour et de la nuit, lumière des bordures irisées du visible et de l’invisible, lumière des feux rougeoyants des cieux et du devenir-ombre des vivants : lux plutôt que lumen (pour reprendre une fameuse distinction picturale identifiant la lumière naturelle du jour opposée aux lumières artificielles de l’atelier). La lumière dans laquelle baigne Days of Heaven est, philosophiquement parlant, l’expression matérielle et physique, d’une certaine idée de l’occident (quand on sait que ce terme signifie ce qui se couche et disparaît de l’horizon – alors que l’orient désigne par ailleurs ce qui se lève) telle que le paradis étasunien, ce nouveau monde promis aux pèlerins conquis par l’esprit messianique du protestantisme (dont on voit ici les représentants bénir la moisson) nourrissant alors, comme l’a montré le sociologue Max Weber, le capitalisme naissant, devait en incarner le paradigme objectif. On sera ainsi attentif à l’enchaînement des motifs, des bouches dégueulant le métal en fusion des usines dans l’ouverture du film au soleil dardant ses puissants rayons en passant par les champs de blés qui en réfléchissent sur terre l’ardeur, des braises d'un feu de joie aux feux d'artifice en passant par les cigarettes échangées par les protagonistes, de l’invasion de sauterelles jaunes ravageant toute la récolte sur leur passage (cette invasion prolonge la fuite meurtrière des amants de Badlands, comme elle anticipe les régiments de soldats s’affrontant pendant la bataille de Guadalcanal en 1942 de The Thin Red Line) à l’incendie final des moissons en passant par les coups de feu mettant un terme à la vie de Bill (Richard Gere qui, pour son premier grand rôle au cinéma, a su brillamment remplacer au pied levé John Travolta initialement prévu), pour comprendre la pente entropique déterminant le sens esthétique de la matière filmique ici collectée.

Ce sont ainsi les réminiscences de La Terre (1930) d’Alexandre Dovjenko, de City Girl (1930) de Friedrich W. Murnau (mais aussi La Terre qui flambe en 1922 - pendant que Tabou en 1931 inspirait explicitement The Thin Red Line), et des toiles de Edward Hopper (notamment en ce qui concerne la représentation de la grande maison du propriétaire terrien posée au milieu des champs) comme de Jean-François Millet (L'Angélus en 1858) ou encore d’Edgar Degas (avec en fin de film les cours de danse dont la représentation picturale chez Degas était alors déterminée par l’existence de la photographie) qui hantent et brûlent Days of Heaven, bouleversante allégorie qui envisage le mythe étasunien du paradis terrestre (dont la culture indigène se nomme là-bas l’Americana) comme ce qui ne cesse pas d’être perdu (on croquera évidemment quelques pommes dans le film), le soleil de cette mythologie ne cessant pas de se coucher et faire ainsi l’expérience de l’obscurité et de la nuit (The Straight Story réalisé en 1999 par David Lynch, qui a d’ailleurs travaillé avec Jack Fisk, le chef décorateur des films de Terrence Malick, a encore récemment revisité cette culture dans ce qu’elle peut avoir de pétrifié, comme dans ce qu’elle peut encore, malgré son épuisement, contenir de braises symboliques). Cette perte consubstantielle est ce qui assure la mélancolie prégnante se dégageant des films de Terrence Malick, comme elle est perpétuellement vécue par des personnages (qu’il s’agisse du trio de fuyards que forment Bill, sa petite amie Abby, et sa petite sœur Linda, comme du propriétaire jamais nommé qui les accepte chez lui après les travaux des champs en croyant au mensonge de Bill selon lequel Abby serait en fait sa sœur) qui ne sont conscients du paradis temporairement habité par eux qu’à partir du moment où ils n’y demeureront plus ou en seront chassés. Et cette perte paraît souvent – et elle semble toujours chez ce cinéaste – s'accomplir sur le mode naturaliste de la prédation et de la destruction. Il faudra attendre la figure radieuse de Pocahontas dans The New World pour que cette perte soit enfin totalement assumée comme telle, et ce faisant, qu’elle puisse permettre l’ouverture de nouveaux horizons messianiques, de nouvelles utopies, de nouveaux lendemains enchantés, de nouveaux recommencements désirés
2/ Des animaux et des hommes

Tout le monde l’a déjà remarqué, un régime d’inserts animaliers rythme les films de Terrence Malick. Cette scansion animalière représente évidemment le fourmillement du vivant peuplant le milieu naturel environnant. Le bestiaire est aussi ce qui explique l’utilisation du célèbre morceau intitulé L’Aquarium extrait du Carnaval des animaux (1886) de Camille Saint-Saëns, en contrepoint des magnifiques ballades folk, enjouées, mélancoliques ou grandioses composées par Ennio Morricone. En même temps, ces inserts (ici ce sont des aigles filmés en plan large dérivant à la surface des vastes cieux, des buffles ou bisons et des daims filmés en plan moyen et que côtoient parfois au sein du même cadre les personnages, des poules d’eau ou des dindons filmés en gros plan au milieu des blés, enfin des sauterelles filmées en très gros plan jusqu’à cette extraordinaire nuée finale filmée en plan large qui, tel un nuage noir, symbolise le rêve évanoui du paradis terrestre) participent à faire respirer le récit, comme ils relativisent aussi la prééminence de l’ordre relatif au genre humain, un parmi d’autres composant la multitude (végétale et animale, terrestre et céleste, autrement dit cosmique) du vivant. En même temps, cette relativisation instruit le double mouvement paradoxal d’une reconnaissance de l’humain comme animal terrestre ainsi dépossédé de sa croyance en son fantasme de supériorité anthropocentrique (c'est par exemple cet axe filmique en pure plongée offrant dans un plan de cuisine le point de vue impersonnel des insectes sur les humains, à l'instar des volatiles de The Birds d'Alfred Hitchcock en 1963), comme d’un chiasme selon lequel l’humain poursuit son désir (cartésien) de maîtrise et de possession de la nature, au risque d’une séparation entraînant son exploitation (auto)destructrice. L’équilibre cosmique que prolongent les fondus enchaînés (pendant que les fondus au noir révèlent les puissances de la nuit engloutissant la matière visible ou en provenance de laquelle elle réémerge cycliquement) se renverse alors en désagrégation chaotique. Terrence Malick, cinéaste du « chaosmos » (Gilles Deleuze et Félix Guattari), artiste des équilibres métastables du chaos et du cosmos pour qui, comme chez Nietzsche, les déséquilibres de Dionysos sont le pendant complémentaire et nécessaire des harmonies d'Apollon. On a longtemps cru chez Terrence Malick à la domination symbolique d’un régime naturaliste (des grands naturalistes, tels Luis Buñuel et Shohei Imamura, partagent aussi un goût commun pour les bestiaires) qui serait de nature contradictoire, le cinéaste paraissant également attaché à montrer les puissances de dévoration et d’épuisement dont est capable le genre humain (c'est par exemple le parasitisme social des protagonistes, pas si éloigné de celui des sautrelles), comme à distinguer ces terribles puissances du fonds de pulsions de pronation et de prédation que partagent avec lui d’autres espèces animales. Comme si le genre humain représentait le point critique à partir duquel la pente destructrice, au lieu de participer à la perpétuelle reproduction de la même matrice naturelle et cosmique, l’emportait sur celle-ci. L’homologie structurale entre les sauterelles de Days of Heaven et les armées de The Thin Red Line, la course meurtrière des amants de Badlands (inspirée de la véritable trajectoire du meurtrier en série Charlie Starkweather) et la bêtise belliqueuse des colons de The New World semblerait avérer la cohérence de l’optique naturaliste dans l’esthétique malickienne, en même temps que le recours systématique au(x) voix-off (on y revient dans la troisième partie de cette étude) paraîtrait indiquer une spécificité de l’espèce humaine capable de penser, d'énoncer et de considérer moralement le sens et la portée de ses propres actes.

Il faut, là encore, attendre The New World pour dépasser l’apparente contradiction philosophique nouant la vision du cinéaste (l’humain est-il ou non un animal comme les autres ?) et préférer plutôt reconnaître le constat des aspirations contradictoires d’une espèce singulièrement travaillée par un double mouvement d’appartenance biologique dans les lois de la nature environnante et d’émancipation symbolique hors de cette hétéronomie au nom de la valorisation de son autonomie propre (en tant que genre auto-institué ou que création imaginaire en lutte pour son autoconstitution – pour parler cette fois-ci avec les termes de Cornelius Castoriadis). La balance métronomique de la pensée dialectique à l’œuvre chez Terrence Malick, et exemplairement dans Days of Heaven, entre le jour et la nuit, la terre et le ciel, le cosmos et le chaos, les pulsions (l’envie, le ressentiment et la jalousie) et les affects (c’est la bouleversante simplicité de ces plans montrant les personnages s’amuser comme des enfants ou bien faire preuve d’une tendresse joueuse et désarmante, et qui, filmés de loin, donnent l’impression que nous avons affaire aux acteurs eux-mêmes en phase récréative entre ou après les prises), le fantasme (le rêve d’un lieu habitable qui ne serait plus de passage, d’une demeure paradisiaque où les différences sociales ou raciales n'induiraient plus des rapports inégalitaires, d'un pays de cocagne dont l'abondance serait promise pour tous sans exception) et la réalité (l’objectivité des rapports capitalistes d’exploitation de la main-d’œuvre agricole ou des relations désirantes clivant de manière triangulaire l’ouvrier saisonnier et le fermier interprété par Sam Shepard, scénariste de Zabriskie Point en 1970 de Michelangelo Antonioni et de Paris, Texas en 1982 de Wim Wenders, par rapport au personnage d’Abby joué par Brooke Adams), le temps présent de la diégèse et le passé des commentaires dits en voix-off par la jeune Linda (Linda Manz) : tout cela renvoie in fine à la situation sociale-historique du genre humain en regard du milieu naturel environnant, et avec lequel il lui faudra toujours plus urgemment choisir entre des rapports (créateurs, car horizontaux) de composition avec lui ou alors des rapports verticaux et (auto)destructeurs d’exploitation explosive.

C’est, au-delà de la seule question du naturalisme, l’aspect véritablement moins environnementaliste (idéaliste) qu’écologiste (car politique) des films de Terrence Malick, et qui éclate définitivement avec The New World. Pour le coup, après avoir évoqué les références plastiques à l’œuvre dans Days of Heaven, on peut désormais traiter des références littéraires qui hantent ce film, de The Jungle (1905) de Upton Sinclair (pour la vision dantesque d’ouverture dans les usines de Chicago) à Grapes of Wrath (1939) de John Steinbeck (même si l’action du film se passe plus de dix ans avant la Grande Dépression, on sent malgré tout poindre la catastrophe, les nuages de sauterelles se substituant ici aux tornades du Dust Bowl qui ont à l’époque ravagé les exploitations agricoles du Middle West – et on pourrait ici également citer les travaux photographiques de Walker Evans et Dorothea Lange dont le style à la fois documentaire et lyrique concorde avec les archives photographiques montrées en ouverture de Days of Heaven), en passant par Pierre ou les ambiguïtés (1852) de Herman Melville (pour cette fratrie indécidable obligeant le couple adamique, ici comme dans Badlands, à faire incessamment l’épreuve de la Loi et l’expérience du péché originel étasunien), Mark Twain (c’est la descente ludique du fleuve des fuyards), l’école transcendantaliste étasunienne (d’Emerson, de Thoreau, et de Walt Whitman, tous trois célébrant l’identification libertaire et subjective avec les puissances naturelles du cosmos contre la massive objectivité des incorporations sociales), et même Léon Tolstoï (définitivement, après la mention précédente à Alexandre Dovjenko, Terrence Malick est le plus russe des cinéastes étasuniens, et la souveraineté de son regard, distant sans être hautain, capable de saisir dans le même mouvement l’infiniment grand et l’infiniment petit, et soucieux de rendre compte des forces qui mettent en mouvement les individus, rappelle le sens romanesque de l’auteur de Guerre et Paix en 1869). Surtout, Days of Heaven semble se présenter comme une variation moderne des Travaux et les jours, le grand cycle poétique de Hésiode composé au 8ème siècle avant notre ère. La minutieuse description des travaux agricoles se moule chez le poète grec dans des développements mythologiques au nom desquels l’histoire de Prométhée et de Pandore s’articule avec les cinq âges successifs de l’humanité, jusqu’à ce que la race de fer l’emporte sur la race des héros, et que la cité de la justice (Dikê) remporte son combat contre la cité de la démesure (Hybris). Chez Terrence Malick, l’âge de fer appartient à l’époque de l’industrialisation du pays, connexe avec ces "Orages d'acier" (Ernst Jünger, 1920) qu'a représenté alors la première guerre mondiale, et qui n’a pas épargné les campagnes. La trajectoire de Bill, qui abandonne l’usine après avoir frappé à mort un contremaître pour fuir avec Abby et Linda au Texas, et qui reproduit là-bas (et en pire) ce qu’il avait déjà commis ici (il poignardera le fermier jaloux qui avait reconnu en lui non le frère mais bien l’amant d’Abby), représente la translation d’une violence originelle et fondatrice dans un espace considéré fantasmatiquement comme vierge, alors qu’il est tout autant que Chicago le lieu d’inscription de l’exploitation capitaliste (telle que l’incarne l’assistant du propriétaire terrien qui gère les comptes, vérifie la rentabilité de l'exploitation, et redresse une main-d’œuvre parfois portée à l’indiscipline juvénile).

L’injustice qui résulte d’une lutte des classes ne s’avouant jamais comme telle, et qu’attise un circuit perverti des affects mués en pulsions mortelles (le mensonge de Bill afin de garantir le luxe d’Abby et Linda, le ressentiment du premier envers les richesses du second dont on espère secrètement la mort puisqu'il serait apparemment malade, et la jalousie du second, qui ne meurt pas comme prévu peut-être parce qu'il est amoureux, et qui ne supporte plus la reconnaissance des sentiments réels de Bill et d'Abby), débouche sur la déflagration prométhéenne de l’hybris symboliquement relayée par les ravages causés par l’invasion des sauterelles. C'est la domination symbolique du motif de l'hélice, de la reproduction du crime originel à l'outil indiquant le vent dont le tournoiement renforce la folie pulsionnelle qui ravage le personnage du fermier, telle une figure pathétique de l'expressionnisme allemand. L’incendie que l'invasion des sauterelles appelle pourrait ressembler de loin à une vengeance allégorique de la Nature brimée par le fer du capital (les animaux expulsés des champs de blés fauchés), sauf qu’il résulte objectivement d’éléments naturels excédant la maîtrise requise par la rationalité humaine, comme des contradictions divisant le genre humain en classes opposées et en individus minés par une « rivalité mimétique » (René Girard) au nom de l’amour (non-partageable du point de vue de l’ordre hétéro-patriarcal) de deux hommes pour la même femme. Le motif du paradis perdu n’a pas d’autre raison que la révélation de ce qui l’obscurcit, objectivement (l’exploitation capitaliste et la division sociale en classes antagonistes) et subjectivement (les affects dont l’impossible effectuation se renverse en passions puis en pulsions). Voilà ce qui participe à distinguer ultimement l’espèce humaine des autres espèces avoisinantes, en même temps que cette distinction ne doit pas empêcher une économie reposant non sur la séparation et l’exploitation mais bien sur la composition, et ce afin que « le vert de la terre continue de briller pour nous » (comme l’aurait dit Empédocle selon le poète romantique Hölderlin).
3/ Parler, au nom du temps perdu, pour le temps qui vient

Avant d’être cinéaste, Terrence Malick a été étudiant dans les universités de Harvard et d’Oxford. Il a même enseigné la philosophie au MIT, et traduit en 1969 Le Principe de raison de Martin Heidegger. Cette formation philosophique, si elle imprègne le geste esthétique du cinéaste, ne l’a heureusement pas poussé à neutraliser la formidable sensibilité (on pourrait même parler de sensorialité) à l’œuvre dans ses films. On pourrait même dire, en s’appuyant sur Les Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme (1795) de Friedrich Schiller, que les films de Terrence Malick représentent une parfaite synthèse entre raison sensible et raison intelligible au nom de laquelle le jeu de la sensation et de l’intellection ne conduit certainement pas à privilégier l’un des deux termes par rapport à l’autre. Il faut d'ailleurs insister sur ces nombreux plans, en marge de la narration dominante, qui travaillent à exprimer l'infinie tendresse des personnages (comme le dit Linda en voix-off, personne n'est mauvais ici, signifiant implicitement que seuls les rapports sociaux déterminent la pente négative de l'agir individuel). C'est ainsi toute une série de gestes et de caresses, de jeux et de danses, de chants et de regards subtils, entre les personnages, comme au sein du groupe social, qui participent à l'expression d'un être-là communément partagé sans effort d'appropriation (et donc de privation) quelconque. Ces gestes entendus comme "purs moyens sans fins" (Giorgio Agamben), sans autre finalité (narrative ou instrumentale) qu'eux-mêmes, ces caresses comme ouverture sans but à l'altérité et comme ouverture sans savoir à un avenir pur (Emmanuel Levinas), ces regards suspendus sur un horizon énigmatique, cette "gestique" (Jacques Rancière) trahissant la juvénilité d'adultes déjà vieillis par la modernité capitaliste et demeurant encore malgré tout des enfants qui brûlent du désir utopique : tout cela appartient à un geste esthétique impressionniste conditionnant ici autant la foudroyance narrative des ellipses qu'un régime filmique de la touche pour lequel le plan fonctionne comme épiphanie et comme caresse, touché par la grâce de qui s'expose dans un partage opposé à toute forme d'appropriation. Terrence Malick est un grand cinéaste de la philia, amitié ou amour comme communauté des égaux désirant (et travaillant à) vivre l'existence la plus digne (autrement dit la plus tendre, puisque la tendresse des gestes notamment est l'expression privilégiée de cet élan communautaire), pendant qu'Eros doublé par Thanatos rôde et menace toujours de faire basculer le désir dans le registre mortifère de la pulsion. Le paradoxe voulant que ce ne soit pas Bill, mais le fermier qui s'abandonne à cette pente funeste, le premier ayant la sublime sagesse de reconnaître l'amour d'Abby pour son rival, quand ce dernier détruit son propre amour pour elle au nom de la destruction d'un amour pourtant défunt, mais qu'il aura été incapable de voir. C'est aussi que l'ouvrier, plus facilement que le patron, peut accéder à une pensée de l'amour comme non-appropriation, alors que le second est in fine submergé par la pulsion pronatrice logée au coeur de la position sociale qu'il occupe.

On reconnaît également cette hyper-sensibilité chez Terrence Malick dans la texture référentielle (en termes cinématographiques, picturaux, photographiques et littéraires) qui, loin d’étouffer la sensibilité des plans (à l’instar d’une reconstitution historique somme toute ici plutôt minimale en regard des productions hollywoodiennes standard), se fond dans une matière filmique drainée par les mouvements molaires et moléculaires, telluriques et cosmiques, de la terre et du ciel, de la lumière et de l’obscurité, du jour et de la nuit. De la même façon, la critique de la rationalité instrumentale dont l’essence serait, selon le Martin Heidegger de Sein und Zeit (Être et Temps, 1927), de faire refluer la conscience de l’être au profit de la vacuité ontologique et inauthentique de la technique (d’où le primat accordé chez ce philosophe au langage poétique comme révélation de l’être comme étant la conscience du néant en son fondement), peut certes participer à parachever la distinction définitive entre le genre humain (dans le langage heideggerien, le seul étant ontologiquement capable de comprendre intuitivement l’être de toute chose) et les autres espèces animales (confinées dans le silence de la séparation de la saisie ontologique de l’être), comme elle peut légitimer la qualité tout à la fois poétique et philosophique de l’esthétique malickienne (en cela proche de la vision kubrickienne, cette dernière apparaissant comme plus abstraite et conceptuelle). La bande sonore des films du cinéaste traduit exemplairement cette conflictualité entre la bruyante inauthenticité dont le genre humain est la victime, comprimé par son environnement technique (le vrombissement de l’usine à Chicago et des moissonneuses-batteuses au Texas recouvre les paroles échangées, pendant que les explosions à peine perceptibles de la première guerre mondiale sont à peine masquées par une fanfare municipale lors du retour des conscrits), et le saisissement intuitif de l’angoisse propre à l’être que relaient les paroles énoncées en voix-off. On remarquera d’abord le primat accordé aux voix féminines, celle de Sissy Spacek jouant Holly dans Badlands, celle de Linda Manz dans Days of Heaven, et de Q’Orianka Kilcher incarnant Pocahontas dans The New World. Comme on notera ensuite la progressive ouverture cinématographique du champ de la voix-off (la multitude polyphonique des voix masculines dans The Thin Red Line, les voix des amants interprétés par Colin Farrell et Christian Bale relayant celle de Pocahontas dans The New World).

On relèvera enfin la relative autonomie de la voix-off dont la tâche consiste moins à décrire de manière tautologique ce que montrent les images, qu’à libérer les images de toute stricte subordination dramaturgique (c'est la force documentaire du cinéma de Terrence Malick, ainsi que sa volonté explicite de s'inscrire dans l'héritage du cinéma muet), comme à rendre manifeste les sentiments d’une subjectivité éthique qui permet ainsi d’inscrire le temps présent de l’action dans la temporalité plus vaste de la conscience réflexive (les dilemmes moraux ne cessent pas ici d'être relayés par une logique de regards adressés frontalement à la caméra afin d'inclure le spectateur dans la suture des plans et des décisions des protagonistes, surtout Bill) qui, chez Martin Heidegger, se nomme "destinalité". Ce jeu dialectique entre les bruits de la modernité et la voix intérieure d’une subjectivité qui nous parle de l’action sur le mode de son extériorité par rapport à elle autorise le cinéaste à désindexer la narration des obligations représentatives du dialogue et du champ-contrechamp qu’il appelle habituellement. Cette désindexation autorise aussi plus facilement les renvois référentiels au cinéma muet de Griffith, Murnau et Dovjenko. Et comme chez D. W. Griffith, le maître du cinéma muet qui a inspiré autant le cinéaste allemand que le réalisateur russe, les gros plans contemplatifs sur la nature environnante conservent aussi chez Terrence Malick une relative autonomie esthétique par rapport aux grandes lignes narratives des fictions inspirées des grands modèles romanesques classiques du 19ème siècle (et on avait cité précédemment Tolstoï par rapport à Days of Heaven). Loin des effets de totalisation induits par la polyphonie à l’œuvre dans The Thin Red Line et susceptibles de rendre compte des multiples façons de dire l’« univocité de l’être » (Gilles Deleuze) ou de manifester le caractère générique propre à l’être humain, les voix féminines de Badlands, Days of Heaven et The New World font entendre (progressivement – puisque l’on passe de la fragilité adolescente de l’héroïne du premier film à la gouaille enfantine de la gamine de la seconde, jusqu’à atteindre l’assurance souveraine de l’héroïne du dernier film) l’écho d’une conscience détachée du paradoxe que représentent le croisement hasardeux des contingences et des nécessités de l’existant. Mieux, c'est la voix-off qui transforme symboliquement le hasard en nécessité, le contingent en destin (cette "destinalité" est un autre moyen dont l'être humain dispose pour assurer sa spécificité en regard des autres espèces animales à partir du moment où cette spécificité ne débouche pas sur une logique de séparation et de domination). Le régime narratif adossé à la représentation des enchaînements des actions, quasiment délesté de toute motivation dialoguée (ou bien alors souvent les dialogues sont comme susurrés, dits comme en décalage avec les corps qui les émettent, paroles peut-être parfois post-synchronisées et comme émises loin des corps), se trouve par conséquent soutenu par une logique relationnelle des causes et des effets dépassant et surdéterminant l’agir individuel des protagonistes (en ce sens, l’esthétique malickienne tourne radicalement le dos à l’idéologie libérale et individualiste dominant la culture anglo-saxonne contemporaine), en même temps que cette durdétermination n'épuise en rien la richesse infinie des gestes purs de la tendresse amoureuse.

Mais aussi le recours à la voix-off ponctuant le récit de manière impressionniste avec des notations parfois générales, parfois drolatiques, permet le déploiement d’une subjectivité qui embrasse le présent des actions dans le mouvement d’une temporalité paradoxale, puisqu’elle peut à la fois renvoyer dans le passé remémoré les plans tournés (il y a là quelque chose de proustien que Tree of Life semble-t-il développera plus avant) et ouvrir à ces mêmes plans l’avenir d’une voix qui parle bien après l’accomplissement de l’action (sur ce plan-là, on peut aussi songer à The Magnificent Ambersons en 1942 d’Orson Welles). C'est d'abord ce mode fréquentatif (autre élément formel assurant le caractère romanesque du récit, et qui rapproche à nouveau Terrence Malick d'Orson Welles) pour lequel les actes s'inscrivent dans une dynamique de la répétition et de l'habitude. Ensuite, on comprend que ce qui est en train d’arriver est d’ores et déjà arrivé, en même temps que ce qui a eu lieu est compris dans un avenir qui ne pouvait, au moment même de son effectuation, que lui échapper. On avait vu que la maîtrise technique et rationnelle qu’exerce l’humain sur le naturel environnant doit affronter les divisions internes que motivent les jeux électriques de la différence de classes, de l’exploitation du travail par le capital, de la rivalité mimétique, et des intérêts et des passions, comme les assauts externes de puissances diaboliques (les insectes, le feu, la pulsion de mort) excédant l’ordre symbolique de cette domination rationnelle et technicienne. On voit désormais que la parole dite en voix-off participe à excéder le champ clos de la représentation de l’action, comme à l’articuler doublement au passé de l’action déjà accomplie et au futur de la parole accomplissant a posteriori l’appropriation éthique et subjective, "destinale", de l’objectivité de ce qui est advenu. C’est que la voix-off, ici, fait littéralement fuir l’action, au même titre que les personnages de Days of Heaven comme des autres films du cinéaste désirent toujours déserter, préférant se déterritorialiser lorsque le territoire manque ou échoue à se confondre avec le paradis tellement (et seulement) rêvé que son fantasme finit par s'évanouir en cendres sous la pluie de feu du réel. C'est pourquoi Linda, s'enfonçant dans la profondeur de champ dans le bouleversant dernier plan du film, ressemble tant à Charlot. Le nomadisme est ce dont on vient, en même temps qu'il demeure toujours ce qui vient, ce qui est à venir. "La vraie vie est ailleurs" (Arthur Rimbaud).

« L’oiseau de Minerve s’envole au crépuscule » disait Hegel : le temps, fui hors des gonds de l’enchaînement présent des actions, perdu au profit du pur présent sans accumulation de la désertion ou de la destruction, est retrouvé par la voix-off. Comme Terrence Malick a été capable, notamment avec l'aide de Nestor Almendros, de retrouver à Alberta au Canada le souvenir des terres texanes. Le paradis, parce qu’il ne cesse jamais d’être perdu, ne cesse jamais non plus d’être retrouvé ailleurs, toujours plus loin, dans l’espace et dans le temps. Bill est mort, la bouche pleine de l’eau du fleuve sur lequel glisse son cadavre criblé des balles de la police, impuissant à s’être extirpé de l’aquarium social (un verre de vin perdu dans la rivière aura signifié pour le personnage qu'il aura au moins bu quelques gorgées d'un bonheur aussi furtif qu'une ridule à la surface de l'eau). Abby disparaît quant à elle dans le train emmenant les conscrits revenus vivants de la boucherie de la première guerre mondiale. Demeure Linda, qui abandonne le pensionnat pour de nouvelles aventures avec une camarade d’occasion. Les commencements sont des recommencements, disait Gilles Deleuze qui comprenait le motif nietzschéen de l’éternel retour comme étant celui non pas du même et de la répétition statique mais bien de la différence en tant que reprise ou répétition dynamique. Et si le temps de l’utopie avortée se conjugue toujours au passé (son affect est alors la nostalgie), le futur est le temps de l’utopie désirée (et son affect est la mélancolie). Pocahontas accomplira la trajectoire balbutiante de Linda et, avant elle, de Holly : le nouveau monde, c’est une idée d’hier, mais c’est un désir projectif pour demain. Le blé de l'utopie brûle encore, sa moisson est encore à-venir : Days of Heaven réalisé par Terrence Malick, véritable Phoenix du cinéma étasunien (cet oiseau de feu mythique renaissant toujours de ses cendres), ne dit pas autre chose.
Jeudi 24 juin 2010
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
Écrire commentaire