Post-scriptum à l'adresse de deux machinistes : Soufiane Adel et Yassine Qnia
D'un certain usage - inquiet, ludique - des machines

Yassine Qnia et Soufiane Adel, ces deux-là se connaissent bien, le premier a d'ailleurs eu la bonne idée de proposer, en guise de finale à la petite intégrale de ses trois courts-métrages montée par Cinémas 93 et le Ciné 104, la projection de Sur la tête de Bertha Boxcar (2010) co-réalisé avec Angela Terrail. Marrant de remarquer comment ces deux jeunes réalisateurs, qui partagent un même souci à la fois documentaire et biographique d'inscription dans des territoires urbains périphériques (Aubervilliers pour l'un, Champigny-sur-Marne pour l'autre), envisageraient à des pôles résolument opposés le travail requis dans l'usage de la machinerie cinématographique. A un bout s'impose, pour Yassine Qnia, la question de l'efficacité dont la rutilance opératoire mène paradoxalement au désœuvrement quand, pour Soufiane Adel, le monde est celui, polaire, du désert postindustriel où passerait encore un peu d'électricité, mais dans la guise poétique d'une aurore boréale, au-delà de toute productivité. Pour l'un, les machines, indéniablement, fonctionnent (ce sont respectivement la caméra de Fais croquer, la piscine municipale de Molii, la bagnole de luxe de F430). Il y a une évidence symbolique, phallique même, de ces engins sociaux qui fonctionnent, fascinent et ronronnent. Mais c'est comme si leur ronron endormait le technicien aux commandes, au point qu'il finirait par baisser la garde, celui-ci oubliant qu'ils sont bien plus nombreux à vouloir ronronner qu'il n'y a de place disponible pour jouir de la branle industrielle et bénéficier de ses berceuses ou ritournelles. L'obsession existentielle de Yassine Qnia (qui est chez lui tout sauf une thématique vaguement littéraire), à savoir la lutte des places dans une grille ne recoupant pas celle plus diagonale du désir, se trouverait d'une certaine manière comme déplacée, voire neutralisée chez Soufiane Adel pour qui les places sont moins limitées qu'inappropriées, dépassées. La lutte des places commandée par un capitalisme industriel en crise (puisqu'il y a toujours plus de compétiteurs que de places disponibles), parce qu'elle serait toujours déjà dépassée, serait dès lors déplacée par celui qui préfère partir d'une perspective davantage tendue sur ce monde qui serait définitivement celui d'après (un désert post-industriel autrement mieux perçu que dans Le Grand soir de Gustave Kervern et Benoît Delépine, avec, en haut, des travellings latéraux sur les grosses enseignes du consumérisme de masse et, en bas, les figures fragiles de la marge sociologique). Le désert est celui des machines désactivées et des êtres désœuvrés, il est pourtant celui qu'il faut savoir habiter en y bricolant quelques branchements au principe de circuits alternatifs (les travellings latéraux seraient dans Sur la tête de Boxcar Bertha comme des portées musicales dont les lignes parallèles, en contrepoint des guirlandes de Noël déroulées par le personnage de Johnny Johnson, préfigurent les fils de couleur tramant la ceinture kabyle traditionnelle dans le premier long-métrage intitulé Go Forth en 2014).
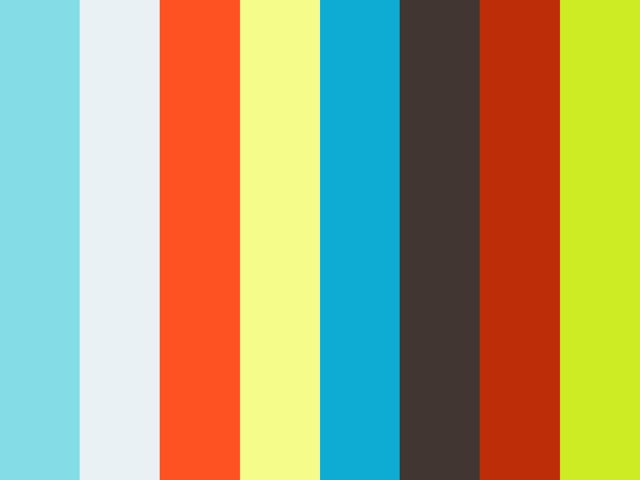
Le désœuvrement, Yassine Qnia le voit ultimement triompher dans les grippements de la mécanique sociale causés par les machinations contradictoires et excessives du désir quand, pour Soufiane Adel, il est posé d'emblée, non plus comme charge à supporter mais, littéralement, comme décharge à transfigurer (la casse très godardienne du film devient salle des fêtes à ciel ouvert pour les lucioles d'un peuple qui manque). A tel point d'ailleurs que Reda Kateb jouant Johnny Johnson, jeune acteur alors qui allait connaître la célébrité avec Un prophète (2009) de Jacques Audiard, parce qu'il est souvent filmé de loin ou de trois-quart dos, ne cesse ici d'être contrarié dans son exposition figurative. Comme si les deux co-réalisateurs avaient étrangement anticipé une célébrité dont ils savaient devoir intuitivement organiser le préalable désœuvrement. Donc, l'efficacité (narrative, dramatique) demeure l'affaire du premier, y compris comme multiplication de vitesses prescrite par la concurrence de personnages clivés entre la place qui leur incombe et celle qu'il désire au prix de toutes les transgressions (des règles de l'amitié à celle de la petite délinquance). Elle ne l'est plus vraiment pour le second, moins technicien et plus mécano pop ou brut dans le privilège diagrammatique d'un traçage de lignes qui, transversales à toute grille sociale préalable, esquissent la mince possibilité d'illumination enfantine d'un monde désenchanté (s'y manifeste une « morale du joujou » chère à Charles Baudelaire, quand la violence imperceptible des jouets intéresse davantage Yassine Qnia). On comprendrait enfin ce qui, définitivement, distingue le geste si loin si proche de ces deux jeunes réalisateurs amis quand on envisage leur rapport respectivement entretenu avec le cinéma étasunien des années 1970 (personnifié par Martin Scorsese, cité comme étant son préféré par le héros de Fais croquer et dont Boxcar Bertha en 1972 aura donc inspiré le titre du film de Soufiane Adel et Angela Terrail). Cette figure serait même en soi idéale en ceci qu'elle se sera épanouie dans l'intervalle des identités (nationale et ethnique), des économies (Hollywood et le cinéma indépendant) et des machines (de la petite délinquance de rue aux grosses machines mafieuses en passant entre autres par les montages de l'industrie aéronautique et ceux de la finance). Sauf que le Scorsese de Yassine Qnia n'est pas tout à fait le même que celui de Soufiane Adel, le cinéaste des machines sociales par où passe un désir d'arriver y compris en frôlant le pire n'étant pas parfaitement identique à celui du vieux rêve américain (qui fut aussi un vieux rêve syndical) par où passe le souvenir effiloché de la tradition des opprimés (on n'y cite pas pour rien, à côté de Joe Dassin, Walter Benjamin). On se souvient alors que Yassine Qnia s'amusait à faire l'Indien de nos imaginaires d'enfance à la fin de Go Forth où s'agitait dans une danse de Saint Guy Soufiane Adel, pour sa part déjà possédé lors de la fête organisée à la fin de Sur la tête de Boxcar Bertha. Ce sont là encore des enfants chéris dont les peu chères gamineries les amènent à vouloir planter, dans les territoires désaffectés de périphéries mal exposées (ces lieux sont moins réservés qu'ils seraient la réserve ségréguée de ces Amérindiens que seraient en France leurs équivalents colonisés), les joujoux restants d'une Amérique de l'enfance. En même temps qu'elles promettent aussi, avec la complicité décisive de parents et d'amis, la réinvention insolente et ludique d'un cinéma français pratiqué depuis des friches autrement plus habitées que son milieu – ce ventre mou où clapote l'eau tiède et aseptisée d'un social dépolitisé. Cette réinvention, c'est un rire, splendidement digne de Georges Bataille chez Yassine Qnia, c'est une danse, furieusement digne de Saint-Guy pour Soufiane Adel (c'est dire d'ailleurs combien la catastrophe est grande pour que, dans National, il se refuse à faire danser Vincent V).
Le 5 janvier 2016
Les Bonnes (2015) de Soufiane Adel

Tombé du camion
Le film, montré au Festival Côté Court de Pantin, s'appelle Les Bonnes, il dure huit minutes et il ne s'agit pas de l'adaptation la plus rapide de l'histoire du cinéma de la pièce éponyme de Jean Genet. Quoique – il faudra vérifier, cela viendra. Le geste de cinéma, esthétiquement informé par la plasticité et la conceptualité caractérisant l'art contemporain, prend au sérieux – c'est là l'un des usages de la frontalité – toutes les questions impliquées par le concept de dispositif. D'un côté, cela signifie que la proposition de cinéma dispose les éléments hétérogènes avec cette garantie intervallaire assurant à la structure filmique d'être disposée aux nécessités de l'écart et, partant, ouverte aux aléas du sens dont la pensée du spectateur s'essaye à en draguer le fond. De l'autre, le dispositif cinématographique induit une pensée critique du dispositif en tant qu'il nomme, de Michel Foucault à Giorgio Agamben (et déjà Hegel qui aura décisivement traduit par le latin dispositio le grec oikonomia), l'économie des appareillages (ou machines) diversement matériels et immatériels, techniques et discursifs consistant à la capture et au contrôle du vivant. En conséquence de quoi, le film comme dispositif met en œuvre une disposition d'éléments comme autant de prises de positions écartées – autrement dit critiques – des formes d'assujettissement relevant du domaine du dispositif. En gros, dispositif est ce qui, chez Soufiane Adel, se doit d'être divisé en deux et dialectisé : preuve en serait un film comme Les Bonnes qui, déjà, ne propose pas une adaptation littérale de la pièce de Jean Genet mais qui en retrouve par des moyens détournés – la frontalité du filmage comme confrontation ne contrarie cependant pas l'oblicité ou diagonalité du sens – la puissance de suggestion en terme de pirouette cacahuète dialectique (jamais la lutte des classes ne sera domestiquée et pas davantage dans le monde social de la domesticité et jamais l'émancipation des esclaves ne fera l'économie de l'aliénation noyautant les rapports de domination au point d'empêcher de comprendre que le maître est l'esclave de son esclave et que l'esclave est l'esclave de cet esclave qu'est son maître).
De quoi Soufiane Adel a-t-il besoin ? Les Bonnes nommerait déjà les « bonnes manières » de procéder : il faut, si le cinéaste est dialecticien, mettre en rapport depuis l'impossibilité du rapport (rien n'est mesurable avec rien, tout est incommensurable avec tout et c'est comme le dispose Marcel Detienne parce que rien n'est comparable qu'il faut justement comparer l'incomparable). C'est fou alors comme le filigrane de la « tradition des opprimés » donne aisément à voir la connivence structurale des figures de l'oppression : les femmes déshabillées par la publicité avec les femmes dévoilées de la peinture orientaliste, les racisés de l'époque coloniale avec leurs descendants de l'époque post-coloniale – et tous avec l'animal réduit par taxidermie aux signes de sa férocité. Les Bonnes accueillerait ensuite les « bonnes figures » en posant la nécessité des parents et des amis (Yacine Qnia) avec qui s'amuser à réinventer des rapports de parentalité et d'amicalité qui ne devraient plus rien à une quelconque naturalité (et ça fait bien dix ans que ce beau monde joue à délier leurs images à la fois communes et respectives de toute fixité identitaire). Les Bonnes disposerait enfin des « bonnes choses » dont il faut bien veiller à en respecter les intervalles afin de proposer la possibilité de leur agencement ou rapport : un studio de photographie et le bout gris d'une rue aveugle, un poème lu avec conviction et un vieux chant de maquisard ressouvenu, un fauve empaillé et le lyrisme spectral d'un air d'opéra, une langueur d'hier (on prend la pose comme hier les Algériennes peintes par Delacroix qui peignit aussi des tigres) et un désœuvrement d'aujourd'hui (on tient les murs comme ces blédards pratiquant cette école d'un hip-hop sur place que d'aucuns appelle le « hittisme »). Le tout serait comme une charade de gosse, à la fois ludique et énigmatique, aussi obscure qu'aveuglante – de cette inévidente évidence qui complique et dès lors renforce le désir de son énonciation.
La charade serait encore comme un diagramme nébuleux. Sur un axe, on retrouve le ton déclaratif d'une procédure politique de « désidentification », la substitution du nom de prolétaire à celui d'immigré vengeant le nom d'ouvrier remplacé dans les années 1970 par ce dernier (aujourd'hui, ces noms ont bien vieilli, le premier ayant quasiment disparu du lexique politique quand le second a reflué au bénéfice des migrants clandestins et des musulmans – c'est pourquoi, comme le Motorcycle Boy de Francis Ford Coppola, Soufiane Adel, si jeune pourtant, semble si vieux déjà). Sur un autre axe (qui serait celui emprunté par l'artiste anglais Brett Bailey concevant l'installation Exhibit B en 2014), la « désidentification » voisine avec le détournement de formes classiques de représentation (comme dans Go Forth Soufiane Adel détournait l'arme de guerre du drone afin d'en désactiver le programme de surveillance et d'en tirer des effets opératiques) en guise double d'appropriation du cliché et du retournement du stigmate (en filigrane des femmes de Delacroix qui nous regardent en sachant pourquoi on les regarde, on reconnaîtrait alors celles peintes par Manet que l'on regarde nous regarder et qui nous regardent en soustrayant de notre regard la vérité de leur regard – la vérité au sens heideggerien d'alètheia ne consistant en rien d'autre sinon en effet dans les battements infinis du voilement et du dévoilement). Sur un troisième axe, les corps de parents et d'amis posent en rappel des Algériennes peintes par Delacroix au début de la guerre de colonisation, proposant de faire lever l'archéologie d'un regard occidental qui, divisant Delacroix par Manet, conjoint non seulement l'oppression sexuelle avec la domination raciste mais aussi relève ce qu'il y a de féminin réprimé en chaque homme (la haine de l'autre, femme ou racisé ou animal non humain, devant alors se comprendre comme une haine de soi altéré). Sur un dernier axe, le poème de la terre pour laquelle une guerre fut nécessaire résonne par-delà les séries relativement autonomes des plans dans la ressouvenance volontaire ou involontaire d'un chant des maquis de l'indépendance algérienne.
Alors, l'indolence d'hier ne résonne plus seulement dans les désœuvrements d'aujourd'hui. C'est qu'il y a – de Maurice Blanchot à Giorgio Agamben encore – avec toute passivité une forme de résistance fondamentale à l'œuvre, contre l'activité imposée par les dispositifs de la domination – du fixisme pictural ou photographique à l'orientalisme et de la taxidermie à la pornographie. C'est qu'il y a enfin avec l'esthétique de l'intervalle (entre les choses afin de les mettre en rapport sans abolir leur hétérogénéité), de l'écart (comme garante des possibilités de « désidentification ») et du désœuvrement une disposition résolue à la rupture avec les dispositifs machinant la capture du vivant. Une disposition à la « désidentification » et la rupture qui se doublerait d'une disponibilité à l'attente messianique qu'il faudrait alors deviner dans les interstices, entre la tristesse des hittistes d'ailleurs et d'ici, les sourires de femmes engluées dans le celluloïd et les figements éternels du tigre évidé (le fantôme de Walter Benjamin ne passait pas pour rien faire coucou dans Sur la tête de Bertha Boxcar en 2010). Une attente messianique comme on attend le bond du tigre : que quelque chose tombe du ciel ou bien du camion.
27 juillet 2016
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...