Sauvage innocence de Philippe Garrel

Texte tiré de : http://www.objectif-cinema.com/analyses/092.php
" A cette heure tardive, il est encore assis sous sa lampe, scrutant les profondeurs de la vérité : un trop grand désir de connaissance est une faute ; et
une seule faute peut engendrer tous les vices "
(Gotthold Ephraïm Lessing, Faust, in Lettres sur la littérature moderne, 1759)
LE CINEMA POSSEDE
La vie de Philippe Garrel est un roman écrit en cinématographe. Et quel chemin celui-ci a parcouru ces douze dernières années, depuis l’anecdote autobiographique directe, comme novellisée par son transfert sur grand écran, des Baisers de secours ", en 1989 jusqu’à l’ample élégie de l’immédiatement classique Vent de la nuit en 1999. S’il y a un cinéaste qui a pris au sérieux la célèbre expression d’Alexandre Astruc, " la caméra-stylo ", c’est bien l’auteur de Un ange passe en 1975.

Après avoir traversé la couche d’ozone du cinéma commercial-narratif dès son premier film (son court-métrage de 1964, Les Enfants désaccordés, réalisé avec la
certitude de ses seize ans) pour créer dans les hautes et désertiques solitudes d’une inspiration résolument marginale de véritables ovnis cinématographiques, pour la plupart invisibles, en quête
du Berceau de cristal (1976) de leurs origines (Lumière, le surréalisme, Artaud, Bataille, et De Staël évoqué pour son suicide dans un des dialogues du film), Garrel avec L’Enfant
Secret en 1983 est revenu sur Terre et de la folie, pas indemne mais vivant. Image godardienne (la couche d’ozone de Sauve qui peut (la vie) en 1980, la place sur la Terre de
Soigne ta droite en 1987) qui sied comme un gant à un cinéaste qui a toujours considéré Godard comme son maître. Et depuis plus de dix ans, aidé en cela fidèlement par le romancier
Marc Cholodenko (et depuis Le Vent de la nuit, par la scénariste et ex-femme de Pialat, Arlette Langmann), Garrel revient sur sa propre histoire, ses propres ruines biographiques afin de
comprendre ce qui a bien pu se passer tout le temps d’une vie vécue en somnambule du présent, ce qui a bien pu arriver à lui et à tous ses amis qui ne sont plus aujourd’hui, emportés par les
reflux de la révolution (Guy Debord dont une page de Panégyrique est recopiée de la main de François, le héros cinéaste de Sauvage innocence), de l’art (l’actrice Jean Seberg, le
cinéaste Jean Eustache) et par le naufrage des drogues (la chanteuse Nico). Sauvage innocence est un film orphelin, non de la génération d’avant, celle des pères, mais de sa propre
génération, drame horizontal d’un film dont la chute brutale – sa fin – laisse le spectateur orphelin lui aussi, comme sur le carreau d’un récit insoupçonnable et plus tragique qu’il ne pouvait
l’imaginer.
Animé de la même mélancolie que Romain Goupil au moment de Mourir à trente ans en 1983, Garrel est comme lui, irrésolu à faire le deuil définitif des disparus d’après mai 68, comme
de l’époque elle-même, quand en plus il faut porter l’écrasante responsabilité (qui se double d’une culpabilité de simplement vivre, comme s’il s’agissait d’une trahison envers les morts, de la
vie envers la mort) de demeurer vivant malgré tout. En images et en sons, il écrit ainsi le témoignage ressassant (cf. Deuil et Mélancolie de Freud), à jamais à venir (" Ainsi l’on
vit deux fois. Ainsi l’on se garde de l’oubli et du désespoir de n’avoir rien à dire ", Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Folio, 19, p. 254-255) d’une vie regardée quand elle n’est
plus en soi mais hors soi, objet d’une contemplation questionnante et maladive, à jamais inachevée, in-finie.
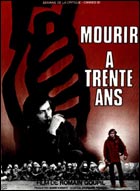
C’est une biographie récalcitrante affrontant sa propre formulation comme autant d’éclats de fictions rêvées et qui n’est pas si éloignée des expériences littéraires de Leiris ( L’Age d’homme ) ou Paulhan (" Un livre peut-il être l’équivalent d’une initiation, secret compris ? " écrivit-il à Francis Ponge le 16 octobre 1941) que l’entreprise garreliennne. Et, par les strictes vertus de la représentation cinématographique (durée palpable et sens de la vibration des plans et dans le plan, jeu ralenti et corps alourdis des acteurs, noir et blanc transcendant fantastiquement le réel et distanciant le propos, mais aussi une musique absolument anti-illustrative – les accords expressifs de piano comme au temps du muet du musicien Jean-Claude Vannier font suite à ceux plus abstraits de John Cale lors des films précédents – qui n’accompagne pas seulement les images mais les regarde également, les commente comme pourrait le faire plus classiquement une voix-off, les caressant ou les heurtant par la ponctuation participante de ses notes), l’écriture blanche, anti-spectaculaire de Garrel donne en partage au spectateur, par une opération magique de révélation (Le Révélateur, un film muet au titre parlant de 1968) qui nécessite un temps certain de repos (le temps de l’œuvre pour que celle-ci revienne réveillée, comme éclairée par la conscience de ce dormeur éveillé qu’est le spectateur), ce poids de mémoire souffrante au moment de son affranchissement, c’est-à-dire un récit à la troisième personne du singulier des universels tourments de nos existences à jamais non-réconciliées avec leur histoire.

Ce passage via l’exercice de la fiction puis de son nécessaire détachement, la projection cinématographique (littéralement, Garrel jette au devant de lui sur l’écran ce qui
le serre au dedans de lui), sauve du narcissisme l’œuvre comme il protège de cette complaisante tendance du cinéma contemporain (cf. Woody Allen) les films de Nanni Moretti qui, lui, s’est
directement confronté à la forme du journal intime. La différence entre Garrel et Moretti réside essentiellement dans le fait que le premier souhaite se guérir du passé pour mieux affronter le
présent (si son cinéma a tout l’avenir du monde pour amplifier son projet esthétique, il ne s’intéresse que très peu au temps futur) quand le second désire guérir des peurs liées à l’avenir pour
mieux, au présent, passer par les armes les fantômes du passé.
Garrel en incurable romantique qui semble toujours réaliser son dernier film, Moretti en angoissé contemporain qui a toujours l’air de réaliser son premier film, mais tous les deux restent vissés
sur leur grand sujet, une guérison possible. La Chambre du fils, cette année, ne parlait que de cela quand, par ailleurs, des œuvres récentes telles que N’oublie pas que tu vas
mourir de Xavier Beauvois en 1996, Fin août début septembre d’Olivier Assayas en 1998, Beau Travail de Claire Denis en 1999 ou encore La Traversée en 2001
de Sébastien Lifschitz, très garreliennes par l’esprit, portent toutes sur le motif même de la modernité et de son actualité : quel avenir pour la guérison ? Certitude concrète chez
Moretti, incertitude fondamentale chez Garrel.

Sauvage innocence avec son titre à la Nicholas Ray (The Savage innocents est le titre original des Dents du Diable en 1960, son film sur les
Esquimaux ; or il s’agit bien ici de glaces éternelles et de diable comme on le verra) en repasse par l’un des fils d’Ariane de l’œuvre, fil privilégié qui, expressément de Elle a passé
tant d’heures sous les sunlights en 1985 à J’entends plus la guitare en 1991 jusqu’au Vent de la nuit il y a trois ans, n’est autre que la relation
amoureuse et orageuse entre Garrel et celle qui fut sa muse et son actrice fétiche dans les films expérimentaux des années 70, la chanteuse d’origine allemande Nico. Fil a priori rompu à la suite
de la mort de cette dernière, frappée d’un arrêt du cœur en tombant de vélo à Ibiza, usée par la consommation excessive de drogues : décès dont ne s’est jamais tout à fait remis le cinéaste
– fil d’autant plus incassable en fait qu’il tire sa dureté d’acier de la mort elle-même – bien qu’ils ne vivaient plus ensemble depuis quelques années à cette époque.
Sauvage et innocent, Garrel désigne par ces deux termes qui signent sa démarche de créateur l’avers et le revers de l’étoffe dont sont faits ses films, étoffe dont l’un des fils est, nous l’avons
dit plus haut, Nico, l’étoile polaire (d’où le titre et son écho rayien), la Vénus (d’Ille) du cinéaste, l’Etoile du berger permettant aussi au spectateur perdu dans le dédale de l’œuvre de se
guider, de s’orienter parmi ses bifurcations et ses entêtements. Et l’Orient de Garrel est en général l’Allemagne, traversée par la voiture rouge de Daniel Duval dans Le Vent de la
nuit (la Hollande ici fait figure d’Allemagne décalée, troublée par le biais de la fiction à l’intérieur de la fiction). Bipolarité esthétique qui en recoupe une autre, plus
thématique : celle des vivants et des morts qu’aucune ligne de démarcation ne saurait dorénavant séparer (on retrouve Ray, effectivement pas mort, en se souvenant du mot du héros de
Bitter victory, son film de guerre de 1957 : " Je tue les vivants et je sauve les morts "). Autrement dit, il s’agit de cinéma.

Et ici, plus encore, de cinéma dans le cinéma mais, à la différence de Elle a passé tant d’heures sous les sunlights, pas sur le mode du patchwork à mi-chemin du
documentaire et de l’expérimentation, le film se regardant s’inventer ou s’abîmer sous ses propres yeux, mais sur celui plus classique du méta-film, de la mise en abyme frontalement énoncée
(ignorée, comme retardée, par Les Baisers de secours et J’entends plus la guitare alors que le personnage joué par Garrel lui-même dans le premier film et par Benoît
Régent dans le second était cinéaste). Pourtant Sauvage innocence n’est pas plus proche, malgré ce que l’on aurait pu attendre, du Mépris de Godard en 1963 que de La Nuit
américaine de Truffaut en 1973, puisqu'il ajuste ensemble l’intimité suivie de son corollaire immédiat, la trahison (dans le couple comme dans le cinéma lorsque les hommes en amour ou les
producteurs en finance se révèlent être des escrocs), du premier, et les allers et retours réel-fiction nourrissant, même mortellement, le tournage d’un film et sa petite communauté passagère de
participants (acteurs, techniciens) du second.
Pourtant, si ces trois œuvres sont nimbées d’une mélancolie prégnante, l’état profond de Melancholia du film de Garrel n’est pas celui du film de Godard (le cinéma classique qui s’en va à
l’instar des Dieux qui ont abandonné les Cieux, laissant désespérément seul sur le rivage de son être l’homme) ni celui du film de Truffaut (une certaine conception du cinéma, collective,
feuilletonesque, renoirienne mais surtout protégeant des mauvaises rencontres du réel, conception au classicisme quasi intenable désormais, et menacée à l’ère de la rentabilité reine de devenir
utopique, fictive), même s’il partage nombre d’affinités électives avec eux. Cette mélancolie est ailleurs, dans la trahison ontologique, cette soustraction de la vie réclamée par tout récit, que
fait salement subir le cinéma au réel : " Chaque fois qu’on fait un film, c’est l’enfant qu’on n’a pas " (Philippe Garrel, entretien des Cahiers du Cinéma n°204, septembre
1968), dans le rapport " intolérable " (idem) qu’il entretient avec la vie, autant dans La Concentration en 1968, qu’ici, 33 ans après. Quand le personnage de Lucie,
qu’interprète Julia Faure, meurt, elle meurt deux fois dans un jump-cut, un raccord dans l’axe qui joint son personnage avec celui de Pages arrachées au journal de Satan de Dreyer
en 1919, deux plans qui réitèrent la violence de sa mort sacrificielle, l’un pour le réel et l’autre pour la fiction (et le cinéma et la mémoire de ses martyrs : Lucie ne rappelle-t-elle
pas, écroulée, la jupe obscènement relevée en haut des cuisses, la Magnani de Rome, ville ouverte de Rossellini en 1944 ?). A bout de force, c’est une résistante de la vie qui a
lâché pour être absorbée par l’ombre du cinéma, qui a passé tant d’heures sous les sunlights qu’elle en est morte.

Quand Maurice Garrel revient dans quelques plans de Sauvage innocence, alors que sa mort fictive, dans le même rôle (le père de l’artiste), scellait Le Cœur
fantôme en 1996, on en repasse de nouveau par la comparaison avec Moretti pour avancer ceci : la mort du père une question du / au passé (il est déjà un spectre, toujours un ange
qui passe) pour Garrel quand, pour Moretti, la mort de la mère dans La Messa e finita en 1987 ou du fils, l’année dernière, est une question que l’on se posera demain. Ce passé qui
revient dans le présent des plans des derniers films du cinéaste depuis dix ans est ce principe de dévoration, ce qui mine ces plans-mêmes (on pense ainsi à Faulkner). La neurasthénie
affectant le cinéma garrelien et ses corps découle directement de cet état de fait-là. " On est toujours fatigué de quelque chose " disait Gilles Deleuze, et il s’agit toujours
d’une fatigue du présent supportant un poids de passé qui ne passe pour ainsi dire jamais.
Tel Atlas, le plan garrelien est le support fragile où se lit le dépôt de cette action (les tics faciaux de Maurice Garrel, les taches de vieillesse de Michel Subor, celles de vin sur le visage
de l’assistant réalisateur Marco), de cette pression invisible mais physiquement ressentie, par exemple lorsque, de manière assez antonionienne (l’ancien petit ami photographe de Lucie, Augustin,
parle de partir en Patagonie comme un personnage de Deserto rosso en 1964), le plan devient flou à la suite de la sortie du cadre par un personnage en continuant de durer un peu plus que
ce qu’il devrait. Flou du plan qui rend aveugles le cinéaste et le spectateur, comme une maladie de la perception qui est celle de ne plus voir un être qui puisse à lui tout seul redonner au
monde sa visibilité, sa viabilité. Durée du plan qui rend malheureux quand le monde continue sans nous, même s’il n’est plus vu de nous, sans se soucier de nos passages, monde définitivement plus
raccord avec notre regard, avec notre présence.
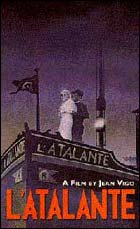
Le cinéma garrelien semble n’en avoir jamais fini avec ses démons qui puisent leur immortelle actualité dans le présent des vivants (ce sujet brûlant qu’est la drogue
auquel se confronte directement le cinéaste en montrant la chaîne mortifère qui se construit autour de l’héroïne). Le plan garrelien figure alors le lieu d’une interface par laquelle coexistent
les morts et les vivants, d’une interzone où luttent âprement ceux-ci et ceux-là, quand les premiers prennent possession des seconds (le rêve de François – son interprète Mehdi Belhaj
Kacem ressemble par ailleurs davantage à Eustache qu’à Garrel lui-même – où Carole, son ex-compagne et top-model décédée inspirée par Nico, le harcèle jusqu’à vampiriser dans le réel l’actrice
Lucie censée incarner son personnage dans la fiction que tourne François). On n’est alors pas si éloigné du Styx traversé par Charon (ou de son appropriation japonaise lors d’une magnifique scène
des Contes de la Lune vague après la pluie de Mizoguchi en 1953), quand Garrel est ce passeur naviguant le long de ses nappes filmiques (la Seine dans L’Enfant secret , la
Méditerranée dans Le Vent de la nuit, les canaux hollandais ici), amenant son spectateur comme ses acteurs (et ses actrices surtout, les belles plantes qui ressemblent au départ aux
modèles lumineux de Vermeer, Ingres ou Renoir pour finir, vidées, noircies, telles les femmes des tableaux de Redon et de Munsch, cadavres en sursis comme chez Manet), selon des mouvements
natatoires privilégiés, en " voyage dans le jardin des morts ", comme l’indiquait un de ses films datant de 1978. Les travellings, combinés avec ces plans de vélo à Amsterdam pas
amnésiques de la mort de Nico tombée de bicyclette, ont retenu la leçon de L’Atalante de Vigo en 1934 avec son couple séparé et trempé dans la sueur de nuits coupables et agitées et ce
camelot en déséquilibre sur son vélo au bord de la Seine, ainsi que de toute l’école de l’eau française des années 20 et 30, L’Herbier, Epstein, Delluc ou Renoir.
Le lit du fleuve, Le Lit de la Vierge (1972), le lit du plan : le cinéaste prend cette image à bras le corps comme le transport, la métaphore de la manière par laquelle il envisage
ses plans, ses images. Image dérivée d’André Bazin (le moulage et la nature ontologique du réalisme photographique), image empruntée par Serge Daney, le plan-lit garrelien a compris ceci :
si les corps qui l’empruntent peuvent être vierges (de cinéma : Mehdi Belhaj Kacem qui par son non-professionnalisme – l’ami Léos Carax a un moment été pressenti – met à distance son
personnage comme s’il le regardait et en était le premier étonné : cette interstice entre l’acteur et son rôle laisse la possibilité à l’histoire même de Garrel comme à la conscience du
spectateur de s’infiltrer au cœur de la machine à fictions qu’est le film ; mais aussi Julia Faure et le personnage de Lucie que joue celle-ci), le plan-lit, lui, ne l’est jamais (voir
l’amour de Garrel pour les scènes de lit, toujours pudiques et issues du cinéma de la Nouvelle Vague, notamment celui de Godard).

Le premier plan du film articule ainsi en toute simplicité une diversité de sens qui, par leur entrecroisement (le plan-lit comme œuvre de couture, de broderie subtile),
signe la pluralité et la coexistence des différents niveaux, non de lectures (le cinéaste demeure inébranlablement dans la modernité) mais de réalités et de temporalités. Ce plan en trois quart
plongée sur une voie de chemin de fer en banlieue parisienne tient ensemble et entrelace les rails des travellings de cinéma, ceux qui permirent aux trains de déportés de finir à Auschwitz (le
récit de la Hongroise Zsazsa, la copine en voie de zombification du producteur Chas interprété avec panache par Michel Subor, au sujet de son grand-père), enfin les rails d’héroïne que
sniffent Zsazsa, puis Lucie, puis son ancien petit ami Augustin, peut-être déjà Chas.
En tout cas, c’est lui qui fournit dans les grandes largesses les doses de mort et, par la bague que Jaja met au doigt de Lucie, lance cette ronde infernale qui voit François manipuler Lucie,
Chas manipuler ce dernier ainsi que Lucie et tout l’entourage du tournage, tels des cercles concentriques épuisant la vie jusqu’à ce " Death Camp " de John Cale dont les stridences
accompagnent le plan final, noir comme un tombeau. Pour Garrel, le cinéma est à l’intersection : des petits et des grands récits, devant et derrière la caméra, du réel et de l’imaginaire, du
rêve et de la réalité, du présent et du passé, de la vie et de la mort. D’où la présence récurrente et métonymique dans l’œuvre entière de bébés ou d’enfants, qui rappelle à quel point son cinéma
est gros (c’est-à-dire enceint d’images, d’affects et de récits), à quel point le grain de ses plans (le 16 mm. gonflé en 35 a souvent été, dans la pauvreté qui a longtemps accompagné Garrel, la
règle du jeu) dans la visibilité de son mouvement manifeste la réalité de cette grossesse (cf. la citation des Cahiers du Cinéma n°204 mentionnée plus haut), à quel point la réalité passée
au filtre, au tamis de ce réalisme cinématographique si particulier dans la stylisation en est comme organiquement affectée.

L’intersection, c’est aussi l’aiguille pleine d’héroïne enfoncée dans la veine du drogué qui désire avoir son " flash ", une image du réel que Garrel applique
directement à son cinéma (la piqûre qu’effectue la caméra sur un morceau du réel addict, à l’instar de Lucie, à ces prises de possession, pendant que le cinéaste François voit le soir le
résultat des prises, des " rushes " de la journée). C’est pour cette raison qu’il faut absolument associer des artistes tels Garrel et Ferrara sur l’idée confessée sur le registre de
l’intime (réalité présente pour Ferrara, passée pour Garrel qui n’a pas oublié " Opium " de Cocteau ou les livres de Michaux) que la pratique du cinéma relève d’un état de dépendance
quasi physiologique (dépendance issue de cet art envers le réel), avec la dose sévère de cruauté morbide que ce contrat implique. Mais c’est aussi le manque amoureux d’Augustin envers Lucie,
prostré comme s’il lui manquait sa dose, le manque affectif de Zsazsa qui, littéralement, se fait un shoot quand elle raconte à Lucie l’histoire de sa vie désolée (d’ailleurs, par un
curieux paradoxe d’un film qui, pour notre joie, en compte beaucoup, c’est Zsazsa qui nous fait davantage penser à Nico que Lucie ou le personnage de Marie-thérèse qu’elle devra jouer au cinéma).
En contrechamp positif, c’est le fils de Carole que rencontre François en tout début de film, tout jeune père qui prépare attentivement, et avec le même soin que Zsazsa et ses doses, le lait
chaud de son bébé.
Le cinéma pompe le réel (voir cette femme de ménage passant l’aspirateur dans le bureau d’un producteur), vampirise la vie et le résultat de cette vampirisation, de cette ponction, se lit
sur ce grand lit vertical, lit blanc d’hôpital, qu’est le grand écran. Accompagnant les corps blafards et les mines légèrement comateuses des personnages, le noir et blanc garrelien (comme celui
de The Addiction de Ferrara au titre largement explicite), entre des surexpositions lumineuses qui semblent consumer la matière vivante du plan jusqu’à l’extase de l’écran blanc final et
des fondus au noir qui, souvent, on ne sait plus très bien, ne sont peut-être pas dus à des effets de caméra et de diaphragme mais à des chutes certaines de la lumière naturelle renvoyant dans le
champ de l’antimatière ce qui vivait dans le plan, possède une force de stylisation (Raoul Coutard à la photographie depuis La Naissance de l’amour en 1993, excepté pour Le Vent de la
nuit : clin d’œil amical, le chef opérateur du film que tourne François se nomme Raoul Maître) qui puise son inspiration quelque part entre celui du Paris fantomatique et raréfié de
Pickpocket de Bresson en 1959 et celui plus prononcé et inquiétant, mais comme intériorisé par Coutard, que Karl Freund réalisait pour Murnau (la seconde heure de Sauvage innocence
et sa partie consacrée au tournage d’un film provisoirement intitulé … Sauvage innocence).

Ce peut être aussi une lumière semblable à celle de Dreyer qui accompagne un couple (encore) amoureux quand il pénètre dans un plan à l’instar de celui de Dies
Irae en 1943, ou de Renoir lorsqu’elle semble irradier d’un personnage apaisé en plein soleil d’après-midi, pendant une partie de campagne relaxante lors d’un arrêt de tournage. De
Bresson, Garrel a gardé la matérialité des portes, des escaliers et des murs qui découpent l’espace et écrasent les individus paraissant toujours fragilisés par les lieux qu’ils traversent,
malgré l’obstination de leurs desseins souvent inavouables (les marches de François et de Lucie, cette façon si caractéristique chez Garrel de parler un ton en dessous, comme pour mieux se faire
entendre jusqu’au souffle vital des acteurs eux-mêmes et qui se confond avec le murmure du vent dans les branches des arbres). En rapport à Dreyer, il opère à l’envers un miracle semblable à
celui de la lévitation de Johannès de Ordet en 1954, opération de magie noire et de sorcellerie chez Garrel quand elle était blanche chez le cinéaste danois puisque Chas apparaît
dans un plan, assis au bord d’une table écrasée par le peu de profondeur de champ et surplombant François, comme un mauvais génie flottant dans l’air. De Murnau, il reprend enfin la puissance de
trouble inhérent au cinéma en tant qu’il est une machine de vampirisation du réel. Et François, malgré son air chétif et angélique, ne ressemble-t-il pas, lorsqu'il est filmé de trois
quart dos, à Nosferatu, en quête d’une jeune fille dont la chair et le sang frais alimenteront ses désirs d’exorcisme cinématographique, afin de se débarrasser une bonne fois pour toutes du
cadavre encombrant de Carole qui hante ses nuits tourmentées et dont il croit porter la responsabilité, alors qu’il sera coupable en toute inconscience de la mort de Lucie ?
Ce que filme Garrel avec la distance amusée de celui qui déjoue les clichés accolés à son cinéma, c’est l’innocence de la perte d’innocence : ce n’est plus l’innocence qui est innocente mais
sa perte elle-même et celle de ses agents, en toute connaissance de cause (le personnage de Chas, dragon au souffle rauque, être de soufre et de cendre qui se confond avec son interprète Subor en
faisant de son artificielle posture la seule vérité, la seule réalité aux dépens de toutes les autres) ou feignant bêtement de l’ignorer (l’inconscience mortelle de François), sans même parler de
Lucie qui la perd fatalement en cours de film en ne s’en rendant jamais compte. Voilà cette sauvagerie dont parle le titre et que le film sublime dans la plus extrême douceur (le cinéma garrelien
est par essence féminin), sans rien dénier de cette violence.

A côté des trois temporalités-réalités, toutes coexistantes, que le film déploie (l’histoire de Garrel avec Nico, celle de François dans le souvenir de Carole, celle de
François avec Lucie incarnant pour son film Marie-Thérèse dont le personnage est largement inspiré de Carole), le cinéaste en repasse par le récit du " Portrait ovale " de Poe
(" C’est la vieille histoire – que Godard a reprise pour Vivre sa vie - du modèle qui meurt quand le tableau est fini. Le modèle valait mieux, sans doute, que le tableau ",
Philippe Garrel à Thomas Lescure, Une caméra à la place du cœur, Admiranda / Institut de l’Image, 1992, p.119), en ce qui concerne surtout la seconde partie et le tournage proprement dit
(le dessin de Chas représentant Lucie, mais déjà dans Topaze de Hitchcock en 1969, Michel Subor en crayonnait un autre tout aussi mortel). C’est surtout le mythe de Faust (" Le cinéma
me fait penser au mythe de Faust. Si on veut imiter la perfection de la nature, c’est perdu d’avance (…) Le cinéma ne nous rend pas les gens dont on parle ", Philippe Garrel, entretien avec
les Cahiers du Cinéma n°447, p.34), mythe littéraire popularisé mondialement par Goethe et cristallisé au cinéma par l’adaptation de Murnau dans son film éponyme datant de 1926 et par René
Clair dans La Beauté du Diable en 1950 (on voit d’ailleurs une affiche des Grandes Manœuvres du même René Clair dans le bureau du premier producteur que rencontre François) qui
irrigue entièrement le film de Garrel.
Et il faut voir les grandes manœuvres de François, habité par un fantasme nécrophile à la hauteur de celui du héros de Vertigo de Hitchcock, qui est de ressusciter une morte pour mieux
l’assassiner de nouveau et définitivement, écrivant des pages et des pages, noircissant des feuilles comme s’il s’abreuvait du sang (ses taches sur le dos) de Lucie. Si Mehdi Belhaj Kacem
rappelle par sa gracile beauté l’éternel jeune premier qu’était Gérard Philippe et qui tenait le rôle de Faust dans le film de Clair, Subor comme double méphistophélique et expansif (Chas a aussi
connu Carole) de François, personnage plus malingre, lâche et faible que lui, fait revenir dans nos mémoires par sa grandiloquence et son sens du théâtre et de la déclamation les fantômes d’Emil
Jannings du film de Murnau et de Michel Simon du film de Clair.

Ainsi, Garrel figure les deux médianes (Poe, Faust) traversant le triangle romanesque qu’il trace à partir de sa vie réelle pour que celle-ci, par un savant jeu de miroirs
(et on en voit beaucoup dans le film, Chas apparaissant même de l’un d’entre eux comme reflet fantastique de François), un palais des glaces de l’imaginaire et de la fiction, des réminiscences
cinéphiliques et des récits mythiques, s’ouvre au labyrinthe de son devenir-roman. Notons qu’il n’y a aucun maniérisme chez le cinéaste quand il appelle à lui sans rien forcer, attire plutôt
qu’il ne cite à l’envers un plan de Way down east (1920) de Griffith – un chat ouvrant les yeux quand il les fermait chez Griffith – parce que, comme chez Nicholas Ray, il s’agit bien ici
de glace, de la banquise des sentiments et du cinéma quand il fige ceux-ci dans du celluloïd, du nitrate d’argent.
N’excluant ni l’humour (la composition " à l’ancienne " de Subor, le traitement masochiste du personnage de François), ni l’aventure (l’escale en Italie pour récupérer de la drogue dont
la vente servira à financer un film fait contre les drogues : c’est comme si Garrel regardait du côté du Beauvois de N’oublie pas que tu vas mourir auquel il a participé en réalisant
un plan, quand ce film lorgnait explicitement du côté de son cinéma à lui), ni le sordide (l’overdose finale qui allonge la liste des morts fermant les films récents de
Garrel : J’entends plus la guitare et Marianne, Le Cœur fantôme et le père de Philippe, Le Vent de la nuit avec le suicide du personnage de Daniel Duval) ou
l’obscénité (de l’urine de J’entends plus la guitare aux règles tachant le lit de La Naissance de l’amour, en passant par Lucie vomissant ici : avec les canaux hollandais
et les trafics de Chas en contrepoint, le motif de la circulation est évidemment l’une des clés maîtresses du film), le dense récit que met en place Garrel montre les ultimes prolongements d’une
gueule de bois (cette sarabande masquée dansant sur un rock de Them que filme François à Amsterdam) dont les enfants de mai 68 ne se sont toujours pas remis (la pauvreté et la solitude de
François) ou alors trop bien (Chas en aristocrate cynique dont l’aventureuse existence est uniquement motivée par l’appât du gain), une fin de partie qui fait encore des victimes (les clichés sur
la révolution énoncés par le personnage de Xavier Beauvois dans Le Vent de la nuit, sur le monde du cinéma par Lucie qui lui seront fatales) et qui ne produit plus rien d’une quelconque
transmission (Le Vent de la nuit), ou alors que des trahisons (Chas avec François, ces derniers avec Lucie).

La plus grande ironie est de vouloir faire un film contre l’héroïne (avec le glissement sémantique – c’est un jeu de mot / de maux que l’on avait déjà dans J’entends plus la guitare – que cela suppose : contre la drogue, contre celle qui est morte à cause de cela et dont on ne se remet pas, contre celle enfin qui devra l’incarner au prix de sa vie) avec l’argent sale du trafic de drogue que cela rapporte à Chas qui, de plus, inonde le tournage de ses saloperies. Le pacte de nature faustienne que concluent François et Chas, le combat contre la drogue se substituant à celui contre la peste de l’histoire originale (on remarquera l’emploi intelligent de Mehdi Belhaj Kacem, a priori contradictoire puisqu’il a au moins vingt ans de moins que Garrel alors qu’il est censé le représenter à l’écran, mais c’est parce qu’il figure un nouvel avatar de Faust, celui qui a vendu son âme au diable et à l’art pour pouvoir conserver une jeunesse éternelle), conduit au sacrifice de Lucie (Marguerite chez Goethe et Murnau) sur l’autel du trafic de drogue, de sentiments, de la connaissance et de la paix intérieure que le cinéma devrait procurer à François alors qu’il n’en est rien, bien au contraire.

Pris dans l’étau d’un nouveau deuil qui s’accumule aux précédents, François est un ange aussi mortifère que celui de La Captive de Chantal Akerman en 2000 ou des
films tardifs du Lang de la période américaine tel Beyond a reasonable doubt en 1956 (voir l’irresponsabilité et la perversité de l’angélisme meurtrier chez Fritz Lang dans un article
de Michel Delahaye paru dans La Lettre du Cinéma, n°12, hiver 2000, p.66-82), qui ne veut voir Lucie que derrière une caméra et plus à ses côtés, ne la
considérant désormais non comme une personne mais que comme un personnage et s’étonnant benoîtement de ses cernes qui ne tiennent plus d’aucun maquillage mais du réel. Avec son bandeau sur le
crâne suite à ses nouveaux démêlés avec les trafics de Chas, c’est comme une nouvelle " Cicatrice intérieure " qui apparaît, ineffaçable. C’est comme si le Mal lui-même était sorti de
la malle du fils de Carole que voit François au début du film (ce fils est évidemment le pendant cinématographique d’Ari Boulogne, le fils de Nico), la " boîte aux douleurs " comme
ce garçon la nomme, boîte mythique de Pandore qui continue de prolonger la souffrance et d’accomplir la pente d’une déchéance aussi catastrophique que celle du récit de l’écrivain russe
Gontcharov de 1858, " Oblomov " (que lit pendant le tournage Lucie) dont la maladie de l’apathie contaminera probablement François après la fin du film. L’aura autour de l’héroïne –
Carole, la drogue –, certains y croient encore et s’y brûlent les ailes tels François et Lucie. Ce qui sauve pour un temps seulement Chas de la douleur, c’est que lui ne croit en rien sauf en
l’argent, toujours du côté du savoir quand il reprend une phrase du Petit Soldat de Godard en 1960 dont l’interprète principal était également …Michel Subor : " On ne dit pas
hein, on dit comment mademoiselle ".
En réalisant, par une variation faustienne abreuvée du sang du cinéma du temps du muet jusqu’à celui de Godard, ce film contre la drogue que François ne
finira peut-être jamais, sans compromission aucune ni concession démagogique (à l’instar de tous ses personnages en transit trimballant des sacs de voyage, son cinéma n’a pas le souci bourgeois
de s’installer), et en amplifiant d’une étape supplémentaire son projet esthétique plongeant par la fiction et le romanesque dans les méandres impensés, rêvés, d’une biographie revêche,
Garrel affirme que le cinéma ne résout rien mais, au contraire, entretient, sous la glace du réel, le feu inextinguible qui ne cesse de consumer de l’intérieur l’existence, dont la vocation est à
la contemplation mélancolique de cette consumation. Comme Maurice Pialat le disait lui-même dans A nos amours en 1983, la tristesse durera toujours.
16 janvier 200
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...
Écrire commentaire