|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tiré de : http://www.objectif-cinema.com/analyses/102.php
SYNOPSIS : En 1993, à New York, un couple de jeunes et riches immigrés s'apprête à célébrer Noël. Elle est d'origine portoricaine, tandis que lui est d'origine dominicaine. S'ils ont réussi professionnellement, c'est grâce au métier à haut risque qu'ils exercent : ils sont trafiquants de drogue. Au cours d'un "rendez-vous d'affaire", pendant que la femme attend son mari dans la voiture, un grand noir violent et vulgaire frappe à la vitre, côté passager. Il lui montre des papiers d'identité qui s'avèrent être ceux de son mari. Celui-ci vient de se faire enlever. Le grand noir exige une énorme rançon. Bouleversée et ne sachant à quel saint se vouer, son épouse fait le tour des collègues et débiteurs de son mari. Mais c'est Noël, les gens sont absents. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.................................................................... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LA POUDRE AUX YEUX
" Ceux qui par la cessation intime de toute opération intellectuelle entrent en communion intime avec l’ineffable lumière … ne parlent de Dieu que par négation. " Denys l’Aéropagite, Noms divins, I, 5
R’x-mas est un conte de noël, autant que pouvait l’être, il y a deux ans, même implicitement, Eyes wide
shut de Kubrick. Et avec ces deux films, c’est une vision à la Dickens qui fait retour. Stefan Zweig l’avait bien dit : " Dickens reviendra toujours de son oubli,
lorsque les hommes auront besoin de gaieté et lorsque, fatigués des tragiques tiraillements de la passion, ils voudront entendre, même dans les choses les plus effacées, la
musique mystérieuse de la poésie ". Des films dickensiens (l’esprit et non la lettre : on ne parlera pas des adaptations souvent compassées de son œuvre) et
précurseurs ? It’s a wonderful life de Capra, mais c’était après la deuxième guerre mondiale, Groundhog Day de Ramis, mais c’était il y a presque dix ans
maintenant.
Si Kubrick puis Ferrara substituent à Londres, New York comme capitale de la douleur et de la farce capitalistes, ils ne perdent rien d’un traitement vigoureux, comme au bord de la comédie paranoïaque, d’un réel soumis aux plus extrêmes zones de turbulence fantastique induits par ce réel même, foncièrement malade (c’est le réalisme kubrickien sur le mode de l’imaginaire – son New York de studio – et du plan large, c’est le réalisme ferrarien s’effectuant par l’inscription documentaire – son New York on ne peut plus réel et issu des Mean Streets scorsesiennes – et du gros plan), appelant l’implacable constat d’une accession au bonheur frauduleuse et viciée par avance, pourrie par les lois coercitives du profit et de la corruption, de l’individualisme et de l’argent.
De l’auteur des Grandes Espérances à Kubrick et Ferrara, la même vitupération critique, parée cependant des attributs distanciant du conte (cf. la représentation scolaire
et enfantine inspirée directement de Dickens qui ouvre programmatiquement R’x-mas) ou du cauchemar dans Eyes wide shut, envers les diverses formes de
l’aliénation capitaliste, formes qui font comprendre l’infléchissement notable du rapport à la violence qu’entretient le cinéma ferrarien, violence pulsionnelle, frontale et
découlant directement des corps de ses débuts jusqu’à The Addiction en 1996, moins palpable et plus insidieuse, découlant de structures abstraites et conceptuelles,
mentales ou économiques-idéologiques depuis The Addiction, film en tout point charnière, et pas seulement parce qu’on y voyait les charniers de l’Holocauste.
Ferrara, à l’inverse d’un Kubrick qui n’a jamais cessé de faire les trajets les plus grands, les plus lointains (la netteté remarquable chez lui à passer de l’infiniment grand à l’infiniment petit, à les faire se raccorder, est de nature toute pascalienne), ne met le nez que dans ce qu’il connaît et ce qui lui est le plus proche (la came, qui n’est pas synonyme de rétention ou de repli mais de circulation et d’accélération, comme figuration symbolique du rapport viscéral, de dépendance – son grand sujet – qu’il entretient avec le cinéma).
Insensiblement, deux titres ferrariens a priori disjoints se raccordent (The Funeral – Nos Funérailles en français datant de 1995, Our Christmas en anglais : il s’agit d’ailleurs des deux seuls films " d’époque " qu’ait jamais réalisé le cinéaste, le premier consacré à l’ère de la prohibition durant les années 30 et le second situé au début des années 90 juste avant l’accession à la mairie new-yorkaise de celui qui est considéré aujourd’hui comme un messie, Rudolf Giuliani), avec les thèmes communs du commerce et de ses illicites, de la famille en manque d’un disparu (le frère assassiné de The Funeral, le mari kidnappé ici) qui fait trou noir, de la mort et de la résurrection. Autrement dit, la scène traumatique – mais c’était aussi le viol de la nonne dans Bad Lieutenant, le meurtre de The Blackout, les charniers dans The Addiction – doit opérer de façon rossellinienne, par le marquage de sa fulgurance inacceptable ou incompréhensible, l’avènement ou le retour (tel Lazare d’entre les morts) de la conscience.
Le pessimisme ferrarien s’est raffermi, il a cependant gagné en élégance formelle ce qu’il a perdu en fureur primitive. Ferrara ne hurle plus, il susurre ce qui fait dans nos vies la plus petite et irréparable différence (d’où son usage insistant du gros plan) en opérant le plus tranquillement du monde la facture moelleuse, cosy, du système libéral consumériste : acheter l’espace, le réduire en temporalité malléable à merci, effacer ainsi toutes les distances et toucher absolument tout ce qui peut (et doit : c’est un mot d’ordre implicite) être absorbé par une économie capitaliste qui ne fonctionne que par l’idée de dépendance (en ce sens, il n’y pas plus proche de R’x-mas que Millenium Mambo aujourd’hui). Dépendance vécue sur le mode approprié de l’engourdissement physique et de la paralysie morale : non plus un " bio-pouvoir " (Surveiller et punir de Michel Foucault) de contrôle des corps mais ce qu’on appellera un " physio-pouvoir " de contrôle des esprits.
Nettoyant Murnau de ses oripeaux expressionnistes (non plus des oppositions mais des coexistences – le jour et la nuit –, non plus des luttes mais des interférences – la lumière dans les ténèbres et l’obscurité en plein jour, c’est-à-dire le contre-jour qui enrobe les plans ferrariens ; alors, quant à dégager une quelconque lecture manichéenne du monde avec distinction entre le Bien et le Mal à l’appui, cela n’aurait guère de sens et de pertinence pour une lecture critique de notre monde contemporain), Ferrara ne garde de l’auteur de Nosferatu que la figure du passage : passage d’états, d’affects, d’images, d’argent dans des espaces et des corps poreux et mous. Et c’est comme si finalement Ferrara préférait Vertov à Eisenstein ou Godard à Kubrick : sa contemporanéité se joue effectivement dans le fait de ne considérer l’image que comme un enchaînement et l’enchaînement que comme une image, en se demandant ce qui peut bien arriver encore à faire aujourd’hui trace ou indice. Exact voisin du philosophe Virilio, le cinéaste nous dit que tout est raccord, tout se touche, tout est connecté, tout se fond (on est passée des architectures lourdes de Kubrick aux " architextures " de réseaux et urbaines de Ferrara et de l’auteur de " L’espace critique "), dans une œuvre de réduction à l’infime de tout ce qui peut faire différence (ou distance ou ce qui sépare) jusqu’à extinction de celle-ci et par une logique de déréalisation (nous y sommes en plein dans la société du spectaculaire intégré théorisée il y trente ans par Guy Debord) qui sert de paravent glissant, de camouflage opaque à cette œuvre-là.
La mise en scène ferrarienne est caressante, elliptique, sensuelle et pointilliste, enveloppant de ses travellings vénéneux et de l’ondulant de ses cadres le programme bien huilé des trajets de ce couple yuppie et catholique au moment des achats de noël qui considère avec la même importance qu’il faut parfaire les relais de l’écoulement de la cocaïne (détournerait-on de l’argent du profit escompté ?) comme il faut à tout prix récupérer une poupée " Party Girl " que tout le monde s’arrache et que leur charmante petite fille guette pour le réveillon, poupée escomptée depuis déjà un bon moment.
En surenchérissant formellement sur cette liquidation, le filmage ferrarien se fonde sur l’emploi systématique du fondu enchaîné (effet narcotique garanti comme chez le Jarmusch hip-hop de Ghost Dog, stratigraphique comme chez le Lynch urbain de Mulholland Drive, fantomatique comme dans les deux derniers films de Carpenter,Vampires et Ghosts of Mars), du gros plan au bord de l’indiscernable (par exemple, la tôle noire de la voiture du couple sur laquelle se reflètent les architectures de la ville semble s’allonger, couler, pâte modelée par la caméra) et de la sensation de flottement et d’apesanteur procurée par une narration relâchée et distendue et une bande-son à la fluidité toute synthétique, rehaussée de quelques boucles chaloupées du compositeur attitré du cinéaste, Schooly D.
Un filmage qui épouse en somme les rythmiques et les modulations d’un tel socius environné par la drogue, avec pour résultantes la sensation qui dorénavant prévaut sur
le sentiment, la sensualité sur la sensibilité dans une effet de léthargie, au bord du stade létal définitif, rappelant les vagues noires d’encre de The Blackout. Ce
qui a pour effet de contaminer par le doute (le motif ferrarien du vampirisme – encore Murnau –, de la perceuse de Driller Killer aux morsures de The
Addiction) tout ce qui passe dans le champ de vision de la caméra de Ferrara : lorsqu’une calèche pittoresque emmenant toute la petite famille lors d’une balade en
ville passe devant le célèbre musée Guggenheim, on en vient à se demander subitement mais légitimement si l’argent qui a servi à son édification est totalement propre. Mais
l’argent par effet de contamination est toujours sale, même blanchi, même si on dit qu’il n’a pas d’odeur.
Ce processus mis en branle qui est un dispositif de pure vision va jusqu’à affecter dans son entier le décorum clinquant de Noël (l’incroyable plan, qu’on n’ose à peine imaginer pouvoir être tourné en France, du prêtre dans l’église qui participe au trafic) comme si, effectivement, il ne s’agissait que d’un décor sans fond (se souvenir de la fête macabre qui concluait Angel of Vengeance en 1981), pur simulacre dégoulinant de lumière qui n’est plus celle, métaphysique, du soleil mais celle, matérialiste, de l’argent comme l’écrivait Jean Douchet à propos du dernier Kubrick (cf. " Aventure et cinéma ", Conférences du Collège de l’Histoire de l’Art Cinématographique 2000-2001, p.60), à l’image des cheveux blonds platine de l’héroïne, comme blanchis par l’argent de la cocaïne, et très probablement brune à l’origine.
Ferrara n’aura donc pas fait le remake de Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel en 1993 sur simple commande hollywoodienne : le commerce
déshumanisant les corps, les vidant de leur substance morale, est la seule vérité, et le simulacre son masque d’invisibilité (les tableaux représentant des visages de clowns,
la poupée réclamée par la petite fille et à laquelle ressemble de plus en plus sa mère sont les signes patents qui ponctuent la démonstration ferrarienne). Il faut la
persistance des clivages sociaux, c’est-à-dire essentiellement raciaux, mais dont la frontière est pour le moins protéiforme (Dominicains contre Noirs – alors que ce sont des
acteurs italiens, Drea de Matteo, Lillo Brancato Jr. et le fidèle Victor Argo qui jouent les membres importants de cette communauté hispanophone dont certains dans l’ombre des
rues ont la physiologie black ! – plutôt que classiquement flics contre truands), pour dire ce qui résiste de l’amenuisement en cours de toutes les différences, ce
nivellement, cette homogénéisation qui font la structure idéologique du capitalisme dont le seul réel souci est l’exploitation comme logique de pouvoir.
Ce documentaire seulement induit par la fiction minimale qu’est R’x-mas renvoie également aux méthodes de tournage de Ferrara qui privilégiera toujours les parlures aux mots, la captation des affects et la vibration des corps à la mécanique du rôle à interpréter (la féline Drea de Matteo, comme le montrent certains objets ou tableaux ornant les murs des appartements luxueux – au nombre de deux, l’un pour la famille, l’autre pour le travail – du couple, rappelle la Madonna de Snake eyes, aussi sexy mais plus musculeuse que pulpeuse, plus marquée par la vie aussi ; quant à Lillo Brancato Jr., il ressemble à une version juvénile, nounours et poupine de De Niro), avec ce rapport direct et immédiatement palpable avec la vie de la rue new-yorkaise (Ferrara est le seul aujourd’hui à filmer aussi justement la communauté black, toujours laissée à l’écart des richesse de la ville : c’est cette acuité sociale qui fait rageusement sens).
Par le motif du kidnapping comme ultime stade de la marchandisation des corps clivés en tant qu’objet (motif récurrent du cinéma des frères Coen), Ferrara espère donner une leçon salutaire à son couple, leur ouvrant la porte des responsabilités et le choix d’opérer un choix vital. Si chercher une poupée au marché noir égale à chercher à libérer son mari en payant le prix fort, l’homme a donc troqué sa condition d’être conscient pour la liberté infantilisante de ne jamais plus vouloir être libre, pour un devenir amorphe de pantin, de marionnette pas si différente de ces jouets de noël.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 janvier 2002
 Des Nouvelles
du Front...
Des Nouvelles
du Front...



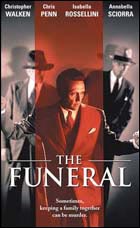



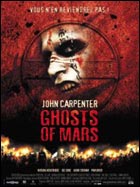




Écrire commentaire